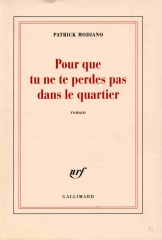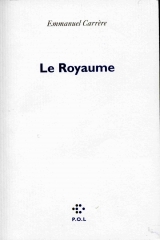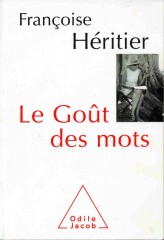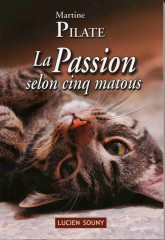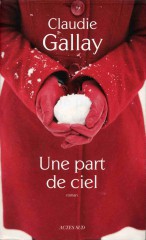29/12/2014
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
Sans surprise, le thème du dernier roman de Patrick Modiano concerne la quête du passé, l’histoire personnelle que le personnage central, Jean Daragane, n’a aucune intention d’exhumer au départ. Cet alter ego de Modiano, un écrivain un tantinet misanthrope, est dérangé au cours de sa sieste (et du cours de sa vie) par un curieux appel d’un inconnu qu’il pressent comme une menace. Il se rend néanmoins au rendez-vous imposé par l’importun, entrant ainsi dans le mécanisme d’une remontée dans le temps qui deviendra bien vite incontournable. Comme dans tous ses ouvrages, Modiano promène son lecteur dans le dédale des adresses parisiennes, il se sert du décalage entre le souvenir des lieux et la réalité présente pour mieux accentuer l’évanescence du passé et faire ressentir le trouble que provoque la convocation des fantômes.
Si Modiano prend la peine de décrire son personnage en homme mûr qui s’est construit sur un rejet des relations familiales compliquées et insatisfaisantes, il s’amuse à mettre sur sa route deux personnages aux intentions troubles qui le conduisent à ce retour sur son propre chemin, parsemé de zones d’ombre et d’ambiguïté. Très vite le lecteur perçoit la confusion de l’écrivain face aux évocations, en apparence anodine, de patronymes déposés par hasard aux détours d’un roman, comme une bouée invisible. On est presque en droit de se demander si la ficelle n’est pas un peu grosse… Et puis, peu à peu, il devient évident que le hasard mène bien la danse, que les petits cailloux qui semblent semés sans rime ni raison l’ont été comme autant de balises destinées à guider chacun vers « sa » vérité. Jean Daragane se prend à ce jeu, ce passé oublié devient obsédant. Il se mue en enquêteur acharné à retrouver les clés des événements et des êtres qui l’ont entouré dans son enfance. C’est une femme dont la présence émerge, et cette femme n’est pas sa mère. Les réminiscences concernant Annie Arstrand sont troublantes, ambivalentes. Au passage, Modiano alias Daragane nous convie dans une maison mystérieuse où se sont tramées sans aucun doute de louches affaires… Mais chut, Modiano n’est-il pas le roi de l’esquive, nous resterons comme Daragane, des témoins au regard flou, des oreilles sourdes à la bande son, des personnes en quête d’enfance, indéfiniment…
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier
Patrick Modiano
Gallimard (nrf)
Août 2014
ISBN : 978-2-07-014693-2
19:35 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : patrick modiano, quete du passé, pour que tu ne te perdes pas, roman français |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
20/12/2014
Le Royaume
Présenté comme LE livre de la Rentrée, si l’on en croit la plupart des critiques publiées. Et je reconnais d’emblée que cette dernière mouture d’Emmanuel Carrère ne m’a pas déçue. Pourtant, comme beaucoup, j’aborde ses livres avec un curieux mélange d’envie fortement mâtinée de circonspection. Carrère, c’est encore un écrivain qui parle beaucoup de lui…
Mais il faut nuancer tout de suite. Le positionnement personnel d’Emmanuel Carrère dans ses ouvrages n’entre pas, et de loin, dans la pose satisfaite des auteurs Narcisse nombrilistes. La démarche de Carrère consiste à partir de son vécu pour nourrir d’authenticité sa réflexion. Ce qui ressortait comme parti pris dans d’autres vies que la mienne, et qui va ici encore plus loin.
Tout bien considéré, la qualité essentielle qui donne envie de le lire tient à la manière dont l’auteur traite son lecteur : il l’entretient en ami de ses réflexions, il poursuit tout au long de ces 630 pages une conversation à cœur ouvert, sans fausse modestie ni admonestations péremptoires. Le rythme du livre, sa découpe en brefs sous chapitres permettent de répondre, de noter nos réactions, d’être en phase ou de protester quand le cœur nous chante. Emmanuel Carrère excelle dans le ton de l’aparté comme dans l’expression du doute ; si je m’en octroyais le temps, je dénombrerais l’utilisation du « peut-être » au long de son discours.
Certains se sentiront rebutés par le thème du livre : ah, encore une démonstration de catho pour exciter la guerre de religion qui marque ce début de siècle. J’en connais qui pense que même toucher le livre peut-être contagieux. Mais non, Carrère l’avoue : il a donné, il en est sorti dé-fi-ni-ti-ve-ment, promis, juré… Ce qui ne veut pas dire qu’en renégat bon teint, il est interdit de réfléchir sur ce qui fascine dans le catholicisme, et permet à l’Église de perdurer, même mal, depuis plus de 20 siècles.
Faute de pouvoir se représenter le charisme de la personne qu’était Jésus de Nazareth, E Carrère fonde son enquête sur le personnage de Paul tout d’abord, dont le portrait se dessine en creux et en relief dans la véhémence de ses fameuses épîtres comme dans les Actes des Apôtres, recensés par un certain Luc. Ni l’un ni l’autre n’ont été des témoins directs de la vie du Christ : Paul a commencé, on le sait, par persécuter les juifs dissidents qu’étaient les adeptes de ce nouveau Gourou (sic). Luc est né plus tard, probablement en Macédoine. Il a rencontré Paul en tant que prêcheur, et son influence s’est révélée déterminante pour ce médecin cultivé. À son tour, il a tout quitté, lui aussi s’est fait disciple, de Paul d’abord, puis au fil du temps, ce lettré s’est questionné jusqu’à ressentir l’urgence de formuler la trace écrite des idées bouleversantes, proprement révolutionnaires, qui sont à la source d’une grande page de l’Histoire des hommes.
Cette enquête à vingt siècles d’écart est un vrai défi à la raison et à la rationalité. Le point de vue initial d’Emmanuel Carrère postule que ce sont les personnalités de ces hommes qui ont forgé la naissance d’une des trois (quatre si l’on admet le Bouddhisme) religions les plus importantes de notre civilisation. À la lecture des Lettres que Paul adressait à ses églises locales, les premiers fidèles, Carrère dresse le portrait d’un homme véhément, habité d’une force de persuasion et de conviction personnelles, intuitif et ombrageux, capable de mauvaise foi. Nous voilà devant un homme, dépouillé de son auréole sanctifiée par l’établissement d’un Canon dogmatique. La personnalité de Luc émerge également de son style, moins abrupt, plus nuancé et du choix des images retenues, les paraboles et miracles relatés.
Le Royaume s’impose dans notre paysage culturel autant que cultuel par l’intelligence, l’érudition et la finesse de ses analyses, la faconde de l’auteur qui nous fait croire qu’il écrit aussi simplement qu’il parlerait dans son salon ou sa retraite alpine. Finalement, voilà un livre qui se quitte à regrets, existe-t-il meilleure recommandation ?
Le Royaume
Emmanuel Carrère
P.O.L (août 2014)
ISBN : 978-2-8180-2118-7
20:15 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le royaume, emmanuel carrère, les évangiles, saint paul, luc évangéliste, l'Église du premier siècle, origines du catholicisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/12/2014
Moment de grâce
Décembre se vit fébrile et festif comme chaque année.
Un événement particulier cependant a agité l’espace d’une semaine la petite communauté de ma petite ville. Notre libraire fort appréciée fêtait les dix ans d’existence du Jardin desLettres. Contre vent et marées, dans son magasin de proportions modestes, Catherine tient tête depuis une décennie aux entreprises gloutonnes qui diffusent sans compter par franchise ou réseaux mondiaux. Il faut du courage pour jouer au petit Poucet, il faut de la ténacité, de la persévérance et de la chance, c’est une manière d’épopée que cette femme menue et décidée pourrait nous conter , nonobstant sa réserve naturelle, avec un drôle de sourire ému dans le regard. C’est ainsi qu’elle remercie les habitués de son antre. Pour l’heure, ou plutôt la semaine passée, Catherine avait concocté un programme d’animations pour tous les goûts, tous les âges:visites d’ auteurs, et buffet de clôture. Pour ma part, c’est au café –lecture du mardi que je voudrais rendre grâce. Mes fidèles- et- discrètes- souris- lectrices se souviendront que j’ai laissé par le passé un billet ou deux pour évoquer ces moments de partage autour d’un livre, d’un auteur. Curieux défi de nos jours, réunir un public fervent dans un café vieillot du centre bourg pour écouter une lecture à voix haute devant un verre de rosé ou une infusion de verveine.
Mardi dernier, il s’agissait d’honorer la vitalité du Jardin des Lettres, de donner une audience à un auteur choisi, d’incarner ses mots par le truchement des voix conjuguées d’Yves, Hélène et Laure. Pour cette belle occasion, le comité des lecteurs a élu un texte de Patrick Modiano, distinction Nobel oblige. Leur choix s’est porté sur Dora Bruder, un texte de 1997, réédité en poche folio, comme la plupart de ses œuvres. Mais cerise sur le cadeau, deux violoncellistes de l’école de musique se sont installées devant le comptoir du Cercle Philharmonique. Ce texte difficile, porté par la lecture respectueuse mais vivante des trois voix qui s’entremêlent et se répondent, acquiert une profondeur inégalée qui nous installe dans le Paris de l’occupation, dans les hôtels modestes et sans confort où les familles d’immigrés aux maigres ressources s’abritent vaille que vaille. Soulignée par quelques extraits des Suites de Bach et Boccherini, la quête de l’écrivain pour retracer le destin de cette famille d’émigrants « ordinaires » devient l’espace de deux heures notre quête. Pourtant bondée, la salle du café est devenue une seule oreille, attentive aux efforts d’ Ernest, le père de Dora, pour devenir quelqu’un; Modiano note à propos de ses journées consacrées à la recherche des lieux où ils ont vécu :
« On se dit qu’au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont habités. Empreinte : marque en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Bruder, pour Dora, je dirai : en creux. J’ai ressenti une impression d’absence et de vide, chaque fois que je me suis trouvé dans un endroit où ils avaient vécu. » ( Page 28-29)
Au fil des pages où Patrick Modiano égrène les résultats de ses recherches inlassables, l’émotion croît parmi le public. Les détails de leurs conditions de vie, la révolte de la jeune Dora qui fugue pour fuir sans doute une promiscuité étouffante, Modiano va les extirper des archives scolaires, du commissariat où Ernest se résout à signaler la disparition de sa fille, malgré le danger de se faire remarquer des autorités françaises, en 1941, quand on est étranger et juif. Et puis le processus des rafles commence, Ernest et Dora sont arrêtés et là, ce sont des documents précis qui en témoignent. Plus âpre parce que plus concis qu’une fiction, ce petit livre, à peine 150 pages, dépeint le calvaire inique de personnes que tout condamnait à l’anonymat, à se fondre dans la grisaille des murailles. Par la ténacité et la clairvoyance d’un auteur justement mis à l’honneur, les petites gens deviennent de vraies personnes, leur vie palpite à nouveau le temps d’une lecture, le temps qu’on ne les oublie pas tout à fait.
20:19 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : café lecture, lecture à voix haute, le jardin des lettres, dora bruder, patrick modiano |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
01/12/2014
Ma vie
Les mémoires d’Isadora Duncan ne paraissent pas d’actualité, mais comme nous visitions en Septembre dernier le musée Rodin, nos discussions ont dérivé sur le destin particulier des femmes artistes de la même époque, dont bien sûr Camille Claudel. Alors que nous choisissions dans la libraire du musée des ouvrages relatifs à cet échange, mon amie Alice a mis la main sur celui-ci, qu’elle m’a ensuite adressé. Ce petit historique personnel pour éclairer l’intérêt de la lecture d’une autobiographie qui surprendra plus d’une fois par son contenu autant que sa forme, et a le mérite d’apporter incidemment une belle pierre dans le jardin de la défense du droit des femmes à disposer de leur vie.
La vie d’Isadora n’a pas été un chemin couvert de pétales de roses. Elle est née en 1877 à San Francisco au sein d’une fratrie de quatre enfants, abandonnée par le père. Sans grandes ressources, sa mère élève et éduque seule ses enfants. L’évocation de la figure maternelle est constante, cette femme de caractère, d’une grande sensibilité artistique, compense les manques du foyer par une ouverture intellectuelle et esthétique sans limites. On a faim chez les Duncan, mais les soirées sont poétiques et musicales. La jeune Isadora semble animée d’une vivacité et d’une énergie sans réserve. L’extravagance maternelle se substitue largement au cadre rigide des écoles d’alors (nous sommes à la fin du XIXe siècle), elle apporte en revanche à la fois la liberté de se réaliser et l’exigence du perfectionnisme créatif. Ce sont des valeurs absolues qu’elle va défendre toute sa vie.
L’exercice d’écriture de Mémoires est difficile. Quel qu’en soit l’initiateur, les pièges y sont nombreux. Comment dérouler scrupuleusement le cheminement accompli quand on occupe la double position de sujet et d’objet ? Comment résister à l’oubli, de reconnaissance ? Qui peut prétendre savoir extraire et rapporter la Vérité d’une suite passionnée de faits, d’événements et de témoignages alors qu’on est encore en plein milieu de la route ? Car Isadora est morte jeune (cinquante ans) sans avoir renoncé à l’intensité de ses actes ni de ses idées. Elle le sait bien et confie dans sa préface : « Aucune femme n’a jamais dit la vérité de sa vie. Les autobiographies de la plupart des femmes célèbres sont une série de relations de leur existence extérieure, de détails et d’anecdotes futiles, qui ne donnent aucune idée de leur vie véritable. Quant aux grands moments de joie et de détresse, elles gardent à leur égard un étrange silence. » ( Page 10)
Qu’on n’attende donc pas ici un récit véridique, mais plutôt un exposé dont le but avoué repose sur l’éclairage de sa passion, le renouveau de la chorégraphie et par-dessus tout l’alliance charnelle quasi mystique entre musique et mouvements. Elle s’appuie sur la culture hellénistique: rétrospectivement, les expériences de la fratrie pour alimenter son inspiration aux sources du Parthénon prêtent à sourire. Sa première liberté, si chère, est de rejeter toutes les contraintes du ballet classique. Par extension pourrait-on dire, elle rejette aussi toutes les obligations du code moral de la société de l’époque. De sa vie privée, Isadora ne fait pas mystère, même si elle s’autorise des « impasses » comme nous disions autrefois à propos de sujets qui ne semblaient pas mériter nos efforts. Il est probable que la rumeur publique conserve en mémoire le fracas des scandales qui ont émaillé sa biographie : amours passantes, unions éphémères, la perte de ses enfants et les circonstances inouïes de son fatal accident. Isadora mentionne encore et justifie sa haine des liens juridiques matrimoniaux. Elle s’oblige à raconter les bouleversements angoissants des enfantements et la joie céleste que l’innocence et la vitalité des enfants procurent, elle en vient aux moments douloureux de leur perte, et les mots ne mentent pas quand ils hurlent l’horreur du chagrin. Ce sont des passages où elle ose encore se mettre à nu, et ce courage est touchant ô combien et reste universel.
Isadora Duncan a-t-elle contribué à dénouer le carcan qui entravait les destins des femmes, comme ses contemporaines Suzanne Valadon, Camille Claudel, Colette, Eléonore Duse, dont elle fut l’amie, et tant d’autres ? Ma vie retrace ses combats publics et privés et constitue un témoignage à verser au profit des combats pour la défense de la liberté des femmes. Mes réserves s’appliqueront en revanche à pointer les lourdeurs de la traduction, les répétitions trop fréquentes du mot Art, même s’il est le leitmotiv de son auteur.
Ma vie
Isadora Duncan
Poche folio 2013
Édition originale 1928 puis en 1932 par Gallimard pour la traduction française de Jean Allary.
J’ai recherché et visionné grâce aux médias actuels des documents relatifs à ses chorégraphies, ils illustrent les pages où elle exprime ses recherches. Voici en partage les adresses de deux vidéos :
15:04 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : livres, biographie, isadora duncan, destin de femmes, chorégraphie, art, création |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
23/11/2014
Secrets de Polichinelle
Par ce recueil de huit longues nouvelles, Alice Munro nous invite à explorer les petits coins cachés de nos consciences, les désirs inavoués qui nous poursuivent malgré nos efforts pour les oublier, les événements qui constituent le mille-feuilles de nos histoires personnelles. Ce sont toujours des femmes ou des jeunes filles qui focalisent l’attention de l’écrivaine, motivée par la manière dont ces femmes se débattent entre conformisme et exigence de leurs propres fantasmes. La vérité est souvent occultée, ou du moins Alice Munro montre ainsi que la vérité profonde des êtres reste souvent enfouie sous le fatalisme des apparences, à moins que…
C’est ainsi que dans Une vraie Vie, Alice décrit avec humour les relations de trois femmes plus campagnardes qu’urbaines dans le Canada des années 30. Les manières n’y sont pas très sophistiquées et la priorité de ce groupe d’amies est fondée sur la survie émaillée de ces plaisirs féminins qui passent pour superflus, comme la couture de robes ou la confection de rideaux. Et pourtant, toutes vont conjuguer leurs efforts pour encourager le remariage de la moins gâtée d’entre elles.
La première nouvelle, Emportés, m’a paru plutôt poignante par sa description de la relation épistolaire qu’une bibliothécaire établit avec un jeune concitoyen blessé sur le front en Europe, en 1917. La jeune femme, Louisa, n’a pas sollicité ce courrier, mais elle s’attache à répondre à ce militaire qui vit de terribles moments, bien que ses descriptions en soient très circonspectes. Et puis, la guerre s’achève et Louisa guette le passage de Jack, qui devrait être rentré. Mais Louisa attend en vain à la bibliothèque, et finit par épouser Arthur Doud, l’héritier de la plus importante entreprise de Carstairs. Un jour, elle finit par apprendre que Jack est pourtant revenu et a épousé une certaine Grace dont il a eu trois enfants, avant d’être tué par accident dans la fameuse scierie Doud. Tout un pan des rêves enfouis de Louisa part ainsi dans l’évanescence du temps impitoyable :
Puis il leva la tête, la secoua, et fit une déclaration.
« L’amour ne meurt jamais. »
Elle se sentit irritée au point de s’offusquer. Voilà tout ce que les discours font de vous, pensa-t-ellle : une personne capable d’affirmer des choses semblables. L’amour meurt tout le temps, ou du moins devient-il détourné, étouffé— Il pourrait tout autant être mort.
( Pages 64-65)
Alice Munro ne progresse jamais de façon linéaire dans la menée de ses récits. Elle procède par sauts de puces, d’un caractère à un autre, d’un événement marquant la petite communauté à l’évocation des souvenirs fondateurs. Son style utilise à merveille la manière anglo-saxonne de dire les choses en ayant l’air de ne pas y toucher. J’ai retrouvé cet art de l’ellipse qui caractérise nombre de femmes de lettres du côté d’Albion : Barbara Pym et sa grande sœur Jane Austen.
Ma nouvelle préférée, celle qui ouvre la plus large fenêtre aux fantasmes s’appelle la Vierge albanaise. Elle comprend soixante pages, mais prend l’intensité d’un roman. Malgré les multiples masques appliqués aux personnages, l’héroïne Charlotte devenue Lottar avant de réapparaître en une étrange visiteuse de librairie, connaît un destin extraordinaire, enlevée par des villageois aux mœurs reculées au cours d’un voyage touristique. Comme dans toutes les nouvelles du recueil, le récit atteint son apogée quand l’auteure rompt le déroulement en nous ramenant à d’autres périodes, nous obligeant à lire plus rapidement pour renouer les fils. Certains lecteurs n’apprécieront sans doute pas le procédé, mais je crois qu’il sert à voiler la crudité des situations, à étoffer le foisonnement onirique de nos consciences.
« Mais je n’étais pas abattue. J’avais opéré un changement radical dans ma vie, et malgré les regrets qui m’étreignaient chaque jour, j’en éprouvais de la fierté. J’avais le sentiment d’être enfin entrée dans le monde, avec une véritable peau neuve. (…) Je lisais, mais sans but ni engagement. Je lisais des phrases prises au hasard dans des livres que j’avais toujours voulu lire. Souvent, ces phrases me semblaient si satisfaisantes, ou si belles et insaisissables, que je ne pouvais m’empêcher d’abandonner tous les mots qui se trouvaient autour pour céder à une émotion particulière. J’étais vigilante et rêveuse, coupée de chaque individu, mais toujours consciente de la ville elle-même—laquelle me semblait un lieu étrange. » (Page 138)
Quels que soient les époques et les personnages créés par Alice Munro, ces histoires nous mènent vers des univers incertains et fragiles, où la réalité des rencontres et des situations fluctue selon les ressentis. Pas de vérité incontestable chez Madame Munro, mais ses qualités de conteuse donnent envie d’aller vagabonder du côté de Carstairs.
NB : il s’agit d’une vraie ville de L’Alberta, mais dépeinte ici dans une version personnelle à l’auteure.
Secrets de Polichinelle
Alice Munro
Points 2012 (éditions de l’Olivier)
Édition originale 1995 Open secrets
19:03 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alice munro, nouvelles, littérature traduite, canadienne, prix nobel de littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
19/10/2014
Le Goût des mots
Fine observatrice de nos sociétés, analyste pertinente de nos comportements et de nos motivations, Françoise Héritier consacre ce nouvel essai à la jouissance du langage. Chacun de nous perçoit d’abord sa langue maternelle par les sens : l’ouie évidemment en premier chef. Mais l’auteur nous convie à retourner puiser dans nos premiers rapports aux mots les sensations initiales, parfois plus abruptes et détachées de l’organisation du sens du discours. Dans ce qu’elle appelle « cette parlure intime (…) assez mécanique (…) au delà- des encordages du sens », chacun de nous peut raviver le souvenir d’un mot que l’on a déformé involontairement en lui attribuant une image, une odeur, une couleur. Dans mon expérience propre, je me souviens que mon frère et moi nous battions pour être celui qui s’assiérait autour de la table familiale sur un “ tas-de-bourets “ :Nous étions une famille nombreuse et les chaises traditionnelles occupaient trop de place dans la cuisine de la ferme. De même ma belle-mère, née parisienne, s’amusait-elle à évoquer sa méprise enfantine au sujet des « sergents d’huile » censés assurer la civilité des trottoirs et des carrefours de la capitale. C’est dire que les propositions de l’anthropologue font mouche immédiatement et avivent notre curiosité pour la suite de son propos.
Ce rapport affectif posé, Françoise Hériter développe les références aux couleurs des sons et des mots, ce que Rimbaud a définitivement révélé grâce au sonnet Voyelles (1872). Mais en sa qualité d’ethnologue, l’auteure élargit la spontanéité poétique et élabore le recensement de registres de mots, elle désigne comme la catégorie la plus courante ceux dont sens et assonance s’associent naturellement. Puis viennent ceux qui créent de la « sidération, les mots qui ne ressemblent pas à la chose, qui ne lui vont pas, qui basculent dans l’étrangeté ’ » (page 17). Enfin la troisième catégorie, plus spécifique à chacun d’entre nous, regorge de trésors inventifs puisqu’elle est constituée de « tous les mots qui ont d’emblée pour moi un autre sens que celui qu’ils ont ordinairement. ».
Je me garderais de reproduire ici les multiples exemples illustrant la démonstration. Certains sont amusants, d’autres étonnants, la plupart déclenchent une petite madeleine enfantine dans notre mémoire de lecteur. Françoise Héritier projette sa recherche sur les expressions populaires, « les lieux communs qui servent à communiquer directement une expérience concrète doublée d’une émotion sans passer par le truchement d’une pensée analytique et explicative abstraite.( Page 36).
Au lecteur de découvrir les énumérations que nous livre l’essayiste. En la matière, sa plume est prolixe. Considérons pour preuve la liste établie pages 41-42 des différents termes s’apparentant au registre émotionnel: environ 200 mots tout de même ! il en ira de même des différents registres de mots ou d’expressions communes, qu’elle dresse avec délectation, et que les amateurs de verbalisation apprécieront largement au fil des pages consacrées à ces rubriques. Pour ma part j’avoue avoir trouvé de tels recensements un peu trop longs.
La limite de l’exercice est atteinte ici, et l’on aborde enfin un nouvel usage du recours prolifique aux maximes toutes faites. La dernière partie de l’ouvrage de Françoise Héritier nous réserve un divertissement plus amusant et productif, et dont s’inspirera sans doute quelque animateur d’atelier d’écriture de ma connaissance! Avec humour et méthode digne des Oulipo et autres essais surréalistes, Françoise Héritier construit quelques saynètes n’utilisant que ces fameux lieux communs répertoriés. Je vous livre ici un court extrait de la seconde histoire, mais les trois exemples rachètent amplement la lassitude dénoncée un peu plus haut :
« Je vais bientôt casser ma pipe, je le sens, mais j’y vais à reculons, croyez-moi. Je ne suis pas un saint. J’ai couru le guilledou, mais j’ai aussi assuré.
J’ai grandi à la va comme je te pousse, toujours un peu triste comme un chien battu. J’ai longtemps rongé mon frein dans mon coin avant de me lancer dans l’arène. Mais quand j’ai démarré, c’était sur les chapeaux de roues. Sans tambour ni trompette, j’ai fait mon petit bonhomme de chemin… » (Pages 97-98)
En conclusion, l’auteure confesse avoir «… jouer avec les mots pour s’en servir de la manière la plus rentable et la plus œcuménique possible tout en sauvegardant l’étincelle primitive de la compréhension du réel à travers les sons purs. » Elle ajoute : « Les sons sont porteurs de sens. À nous d’en tirer parti pour créer un monde … ». Mine de rien, Françoise Héritier nous glisse une recette destinée à redynamiser notre sens de la communication englué trop souvent dans la pratique mécanique de notre langue. En considérant chaque élément du langage comme un jeu, elle leur attribue une nouvelle saveur et nous ouvre les pistes d’une jouissance créatrice à tous les niveaux d’expression.
Le Goûts des mots
Françoise Héritier
Odile Jacob (novembre 2013)
ISBN :978-2-7381-3001-3
18:24 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : françoise héritier, essai, les mots, le langage, la communication, éditions odile jacob, linguistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
La Passion selon cinq matous
Ce petit livre, acheté un peu par hasard lors d’un salon du livre, présente la chronique gentillette d’un été dans un village de l’arrière-pays Ardéchois ou languedocien, vue à hauteur de museaux. L’auteure Martine Pilate se régale manifestement à l’usage du lexique local dont elle parsème volontiers ses anecdotes. Le lecteur n’en sera pas dérouté pour autant, l’éditeur a prévu la traduction en langage courant en fin de récit.
Ce sont donc quelques brefs chapitres qui permettent d’aborder les scènes de la vie courante dans une communauté qui se vit hors du temps. Les touristes attendus sont toujours des « estrangers », ils ont donc rarement le beau rôle, si ce n’est un certain André qui compte pour l’exception. Rien de bien original dans le fond ni dans la forme, ce petit ouvrage de 120 pages permet de passer un moment léger pour qui se régale d’anthropomorphisme vis-à-vis de nos compagnons poilus.
La Passion selon cinq matous
Martine Pilate
Éditeur Lucien Souny (2009)
ISBN : 978-2-84886-251-4
11:59 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : martine pilate, la passion selon cinq matous, chronique, amour des chats, matous, parler régionnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/08/2014
Une part de ciel
Claudie Gallay n’a décidément rien perdu du talent qui lui permet de mouler ses personnages par la seule force des mots. Dès l’incipit du roman, la narratrice prend vie à travers l’écriture d’un récit en forme de journal où elle note les conditions de son retour dans la vallée de son enfance. Carole retrouve son frère Philippe et sa sœur Gaby, qui n’ont jamais quitté la région. En ces premiers jours de décembre, Carole ne sait pas encore quelle sera la durée de son séjour, mais le motif de son voyage apparaît rapidement telle une convocation quasi immanente de leur père. Celui-ci s’est fait une spécialité d’adresser à sa famille des boules de verre contenant paysages et flocons de neige artificiels en guise d’avertissement de ses passages prochains. Ces messages impérieux autant qu’imprécis agissent toujours sur la fratrie, assignation à une attente inquiète nourrie de souvenirs et d’espoirs…
Le fond des préoccupations de Carole s’épanouit sur cette vacuité forcée aux cours de l’expectative sans limites provoquée par l’envoi du vieil homme. La narratrice retrouve dans cette vallée retirée les connaissances qui ont accompagné sa vie jusqu’à son départ pour d’autres horizons. Entre-temps, Carole s’est mariée, est devenue professeur de cuisine dans un lycée professionnel en même temps que traductrice pour un éditeur de Saint -Étienne. Mais son compagnon— qu’elle nomme toujours le père des filles— l’a quittée et celles-ci, devenues adultes, viennent de partir aussi pour de lointaines expériences. Le cœur de Carole est vide et lourd, disponible pour la nostalgie et l’introspection.
J’aime l’art de Claudie Gallay qui sait dessiner avec vigueur des personnages entiers, sincères et durs : Les trois membres de la fratrie, aux destins bien différents, mais aussi moult personnages secondaires dont les silhouettes peuplent avec vraisemblance les paysages brumeux et pluvieux de la montagne industrieuse. Les états d’âme de ses personnages permettent de développer tout à tour bien des aspects de la vie, conférant une valeur universelle aux cas particuliers décrits. Il est question avec finesse de l’avenir de cette vallée, entre respect des activités traditionnelles et pulsion d’ouverture à une économie touristique, mirages de profits et de dynamisme social. Au plan personnel et affectif, ce retour aux sources peut-il réchauffer les cendres du passé ? Que propose Jean, ami d’enfance et premier amour avec ses multiples attentions ? Que dit cette chasse aux clichés de l’attente et des ombres qui couvent dans les non-dits des habitants de la vallée ?
Le nœud de l’affaire se pressent dans le rapport de Philippe et de Carole à Gaby, la benjamine. Elle est des trois celle qui semble la plus perdue, celle qui fait toujours les mauvais choix, celle que la vie n’aime pas. À la manière du Petit Poucet, Claudie Gallay sème tout au long des lignes du roman des éléments de souvenirs qui peu à peu s’organisent comme les pièces du puzzle de Diego, le restaurateur. Dans le passé, la famille a vécu un terrible drame, l’incendie de leur maison, au cours duquel leur mère, figure tutélaire détenant le pouvoir idéalisé d’aimer, a dû choisir… Et ce choix, forcé ou non, a inscrit de manière indélébile l’avenir de chacun.
Tout est là, cette responsabilité que nous portons à notre égard comme à celui des êtres que nous aimons : Nos parts d’ombre et de lumière, nos élans et nos obstacles, nos pulsions de vie et nos désirs de mort. Les touches de peinture que posent les mots de l’auteur révèlent les drames intimes et les réparations fragiles. La surprise, en toute analyse, apparaît justement dans le secret des forces accumulées dans l’adversité. Qui s’en sort le mieux ? Qui vit au plus près de sa nature profonde ?
La réussite de ce roman tient pour partie au contexte social et économique que Claudie Gallay excelle à bâtir. Elle est également une fine observatrice de la nature dont elle sait transmettre la beauté quotidienne, celle qu’on ne voit plus à force d’y vivre, autant que la grandeur quand les circonstances deviennent inhabituelles ou dangereuses. Elle développe surtout une manière d’écrire au ras de l’âme des personnages, donnant à chacun le ton exact qui l’habille de vérité. Je tiens une part de ciel pour une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines et j’ai plaisir à partager mon admiration pour cette écrivaine. Puissiez-vous y trouver le même contentement…
Une part de ciel
Claudie Gallay
Actes Sud (août 2013)
ISBN : 978-2-330-02264-8
16:39 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, roman, claudie gallay, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer