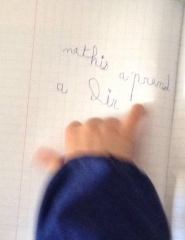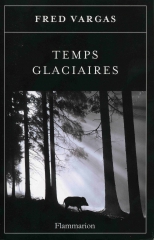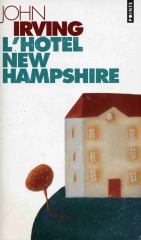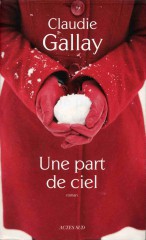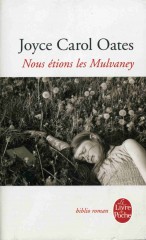13/06/2016
Je me souviens de tous vos rêves
Le dernier opus de René Frégni appartient à cette catégorie des livres- conversations qui sont autant d’invites à la résonance de nos propres émotions. Ce sont les deux derniers chapitres qui révèlent les intentions réelles qui sous-tendent les précédentes confidences :
Page 145 : « J’aurais voulu faire un livre sur le silence, remplir ce cahier de silence, dessiner des mots de plus en plus silencieux, comme on entre dans l’eau des rêves.
Je n’ai jamais ressenti, à travers les saisons de ma vie, un tel besoin de silence. Dans ce cahier, j’ai voulu parler d’un libraire, de mon chat, de quelques hommes perdus, parler de la lumière des collines, du visage d’Isabelle, de la douceur des chemins les après-midi d’automne, de cette petite table où j’invente la tendresse, en écoutant derrière la vitre les voyages du vent. »
Aucun éditeur n’aurait pu résumer en « quatrième de couve » de meilleure incitation à découvrir les mots de René Frégni.
Certains d’entre vous connaissez déjà cet écrivain méridional pour ses romans noirs, récits durs inspirés de ses propres expériences: Les chemins noirs, Où se perdent les hommes, Lettre à mes tueurs, Sous la ville rouge. Mais il ne faudrait pas ignorer le René Frégni conteur philosophe, l’homme poète qui, comme Christian Bobin, sait s’extasier et partager la lumière d’un rayon de soleil déchirant la brume, l’argent des oliviers frémissant dans le vent, la présence charismatique d’un chat réchauffant votre solitude… Après la fiancée des corbeaux, tel est cet ouvrage au titre percutant, Je me souviens de tous vos rêves.
Parce que René Frégni est un humaniste, un écrivain puisant à la source des autres, ainsi qu’en témoigne son récit d’amitié avec Joël Gattefossé, le libraire génial de Banon qui a inventé un village-librairie… Le chapitre qui lui est consacré est des plus émouvants, et l’on se prend à refaire le monde, abolir les horribles règles comptables et les banquiers incultes qui ruinent les rêves des grands enfants.
Mais quel que soit le sujet abordé, parmi toutes ces anecdotes qui pourraient appartenir à chacun d’entre nous, lecteurs du dimanche ou dévoreurs du soir, se niche toujours la petite remarque qui touche le cœur et l’esprit, qui nous conduit à une réflexion inattendue et aussitôt reconnue pour sa justesse. Ainsi, quand il évoque le cimetière où reposent ses parents, page 97 :
« En faisant le tour pour remettre ces fleurs debout, j’ai vu que la mairie avait agrandi le cimetière, c’est plutôt bon signe, preuve que le village, lui, ne meurt pas. »
Je me réjouis donc de rencontrer à nouveau demain chez ma libraire Catherine cet écrivain généreux et inventif, qui confesse aimer l’écriture comme « un combat de chaque mot entre contrainte et liberté. Rien n’est plus érotique que l’écriture », ( page 117).
Et si « le ciel est bien trop petit aujourd’hui pour contenir tous les nuages » (page 102), les pages de ce livre nous offrent bien plus encore en partageant avec nous les rêves d’un homme assagi que l’amour d’une mère disparue émeut encore au coeur de ses nuits :
« J’ai été réveillé par les pleurs de ma mère au fond de ma poitrine, comme elle recevait dans la sienne, jadis, la secousse des miens. (…)
Je ne choisis pas mes rêves, ils m’apportent ce qui me manque le plus. ( Page 149)
Je me souviens de tous vos rêves
René Frégni
Gallimard (la blanche) nrf Janvier 2016
ISBN : 978-2-07-010704-9
19:31 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : s rêves, récit, lecture, poésie, confidences, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
27/05/2016
Le goût de la lecture
Ça n'est pas pour me vanter, comme disait autrefois Philippe Meyer en préambule de ses chroniques matinales, mais demain, je descends passer la journée au Jardin des Lettres, où mon amie Catherine reçoit des auteurs jeunesse pour une rencontre mémorable entre jeunes lecteurs et pourvoyeurs de mots, d'histoires, de BD, de rêves…
Et je réalise qu'une de mes plus grandes joies grand-maternantes, c'est le partage des câlins lecture avec mes petitous. Voilà une activité que je n'échangerai pour aucune autre…
N'allez pas croire qu'Ève ignore qu'elle tient le livre à l'envers… En bonne conteuse, elle tourne les illustrations vers son public!
Le goût de lire vient en effet dès le plus jeune âge, et n'a rien de solitaire alors. Objet familier, le livre appartient au quotidien et à ses découvertes .
Je suis tranquille, la génération de mes "petitous" fera vivre encore bien des libraires…
18:30 Publié dans goutte à goutte, O de joie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, lecture jeunesse, gout de lire, partage, transmission |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
23/06/2015
Temps glaciaires
C’est moi ou les temps changent ? À l’image de nos jours moroses, le ton de ces Temps glaciaires m’a semblé désenchanté. L’harmonie d’un microcosme s’est fissurée, les hommes sont maintenant désabusés. Pourtant l’intrigue du nouvel opus de Fred Vargas fonctionne, les engrenages entraînent finement les personnages et leurs intrigues vers l’inexorable, mais une petite lassitude s’est infiltrée dans la brigade du 13ème. Incontestablement, nous les retrouvons tous, les pro Adamsberg et les réticents, que l’on reconnaît depuis toujours à leurs qualités et à leurs travers. Surtout les travers. Autant vous le dire tout de suite, je pense notamment à la relation du vieux couple Adamsberg Danglard, aux remarques concernant la personnalité de Retancourt. Il m’a semblé, et je reconnais que ça me peine un peu, quelque chose vieillit moins bien chez notre Pelleteur de nuages, il ne pêche plus dans ses rêves comme autrefois. À part ces quelques réticences, il s’agit d’un bon polar, bien dans la veine Vargas, avec ce qu’il faut de détours par l’histoire dans l’Histoire, épicée d’effluve fantasmatique, pour piquer notre curiosité et nous mener de fausses pistes en suspects innocents jusqu’au rebondissement final absolument imprévisible.
Une lettre qu’une vieille dame s’efforce de poster jusqu’au bout de ses forces, une vague de suicides étranges, un jeune homme au mental fragile, environné de personnages inquiétants, une signature de crimes en forme de guillotine, la Normandie profonde comme l’aime Adamsberg, un voyage épique aux confins du Septentrion, bref, tous les éléments sont réunis ici pour nous embarquer avec plaisir dans une série d’intrigues qui s’emmêle de façon inextricable. On se laisse mener jusqu’aux tréfonds de nos peurs, là où souffle l’âpre Afturganga qui menace de nous engloutir…
« Adamsberg prit conscience que, sous ce ciel toujours aussi bleu, l’air avait changé de consistance, apportant une odeur d’humidité. Il tourna la tête pour apercevoir, montant sur la plate-forme, une nappe blanche aussi menaçante qu’une coulée de lave, qui effaçait déjà les contours des baraquements.
— La brume, Veyrenc ! Cours !
Ils avaient à présent atteint la lisière des galets, tandis que l’ancien espace du fumoir à harengs, où gisaient leurs sacs à dos, était déjà à moitié pris. Dans sa course, Veyrenc se tordit la cheville entre les galets instables et chuta. Retancourt le releva et, passant son bras sous son épaule, reprit le trot en halant le lieutenant.
— Non commissaire ! Pas besoin d’aide, je me charge de lui ! Foncez au bateau, lancez le moteur, nom d’un chien !
Plus trace, déjà, du fumoir aux harengs, ni de la lisière des galets. Non, la brume ne se déplaçait pas comme un cheval au galop, elle leur fonçait dessus comme un train, comme un monstre, comme un afturganga. » (Page 382)
Au début, j’ai pensé que le changement d’éditeur ( de Viviane Hamy où elle est restée longtemps fidèle, Fred Vargas est passé chez Flammarion) était pour quelque chose dans l’évolution de l’esprit maison, puis je me suis dit qu’après tout, il en va des univers fictifs comme de la vraie vie : le temps use et corrompt, il érode les êtres et les rochers, il efface les enthousiasmes et nivelle les souvenirs. C’est peut-être moi, c’est peut-être l’époque, c’est sûrement la preuve que l’écriture de Fred Vargas est vivante. J’espère donc qu’elle ne va pas aller se déprendre de ses personnages, car elle reste une bâtisseuse d’histoires hors pair, une conteuse d’intrigues habilement nouées dans une atmosphère prenante, que l’on écouterait encore longtemps…
Temps glaciaires
Fred Vargas
Flammarion (2015)
ISBN : 978-2-0813-6044-0
18:52 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tezmps glaciaires, fred vargas, polar, littérature contemporaine, lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
11/02/2015
L'Hôtel New Hampshire
Ouvrir un roman de John Irving, c’est toujours l’assurance de plonger dans un monde fourmillant, tragi-comique, où le burlesque côtoie le drame, où les sentiments des personnages ne seront jamais sordides et mesquins, où se croiseront des personnalités polymorphes mises en scène habilement. John Irving possède le talent de dresser un portrait caustique de la société américaine au mitan du vingtième siècle, et de retourner la violence de la satire par de soudaines pirouettes, versant au registre clownesque les frasques et les humeurs de ses protagonistes et nous régalant de diverses facéties. Bref, écrit en 1980, l’hôtel New Hampshire s’inscrit bien dans la veine du Monde selon Garp, pour les lecteurs qui ont déjà fréquenté l’univers d’Irving.
Le narrateur de ce présent ouvrage s’appelle John, comme l’auteur. Il est le troisième d’une fratrie de cinq enfants, conçus par le couple de Winslow Berry, fils de Robert Berry dit Coach Bob, et Mary Bates, tous deux enracinés à Dairy, petite ville sans avenir du fin fond du New Hampshire. Le ton particulier de cette saga familiale nous réjouit d’entrée :
« Notre histoire favorite concernait l’idylle entre mon père et ma mère : comment notre père avait fait l’acquisition de l’ours, comment notre père et notre mère s’étaient retrouvés amoureux, et, coup sur coup, avaient engendré Franck, Franny et moi-même (« Pan, Pan, Pan », disait Franny) ; puis, après un bref intermède, Lilly et Egg (Paf et Pschitt ! » disait Franny). ( Page 10 de l’édition Points)
L’histoire de l’Hôtel New Hampshire se décline en trois grands épisodes, trois états différents du même rêve, l’utopie de Win Berry qui embarque sa famille dans l’hôtel conçu comme une arche de Noé. Et comme toute navigation est hasardeuse, la famille Berry traverse son lot de catastrophes, surmontées vaille que vaille grâce à une curieuse solidarité familiale, stimulée par la force morale de Franny, qui exerce un rôle de leader incontesté. Car s’il y a deux filles pour trois garçons dans cette fratrie, ce sont les femmes ici qui incarnent le réalisme et la volonté d’avancer, Franny d’abord, puis la petite Lilly qui essaie toujours de grandir. De fait, chaque personnage cherche sa place et son identité, ce qui confère au roman une dimension attachante qui dépasse les aspects brillants du récit.
Et cette histoire d’ours, me direz-vous ? Les ours et le chien Sorrow sont membres à part entière de cet échantillon d’humanité. Curieuse métaphore que file l’auteur, tout au long du roman : D’abord State O’ Maine, transmis par l’ami Freud, ( un homonyme du fondateur de la psychanalyse), ours un peu psychotique quand même, dont les frasques provoquent maintes aventures… Et prédispose le chien à s’appeler Sorrow, le chagrin. On ne s’étonne même plus alors de l’aphorisme résultant : le chagrin flotte, vous verrez pourquoi…Mais quand l’Ours Susie entre en scène, nul ne peut prévenir la suite des catastrophes qui s’enchaînent. La famille émigre à Vienne, en Autriche, pour recommencer un nouvel hôtel New Hampshire, entendez un nouvel état des choses. À la manière d’un nouveau Candide, le narrateur souligne l’abîme infranchissable qui s’étend entre le monde réel et la micro-société familiale ancrée dans son image. Tu sais, me disait parfois Fehlgeburt, l’unique ingrédient, qui distingue la littérature américaine des autres littératures de notre époque est une sorte d’optimisme béat et illogique. Quelque chose de techniquement très sophistiqué sans cesser pour autant d’être idéologiquement naïf…(Pages 394-395)
Retrouver l’Amérique, c’est se prouver que l’on a évolué, grandi comme Lilly, en intégrant ses deuils. Au cours d’une grande scène typiquement « Irvingnienne », Franny affronte son violeur, comme chaque membre de la famille règle son destin. Dans le dernier Hôtel New Hampshire, Win Berry, à l’abri de sa cécité, poursuit son rêve de bonheur, ses enfants ont pris l’avenir en main.
L’Hôtel New Hampshire
John Irving
Points (seuil) 1995
1e édition US 1981
Traduction Maurice Rambaud
ISBN :2-02-025586-3
12:29 Publié dans Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, littérature américaine, john irving, l'hôtel new hampshire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/08/2014
Une part de ciel
Claudie Gallay n’a décidément rien perdu du talent qui lui permet de mouler ses personnages par la seule force des mots. Dès l’incipit du roman, la narratrice prend vie à travers l’écriture d’un récit en forme de journal où elle note les conditions de son retour dans la vallée de son enfance. Carole retrouve son frère Philippe et sa sœur Gaby, qui n’ont jamais quitté la région. En ces premiers jours de décembre, Carole ne sait pas encore quelle sera la durée de son séjour, mais le motif de son voyage apparaît rapidement telle une convocation quasi immanente de leur père. Celui-ci s’est fait une spécialité d’adresser à sa famille des boules de verre contenant paysages et flocons de neige artificiels en guise d’avertissement de ses passages prochains. Ces messages impérieux autant qu’imprécis agissent toujours sur la fratrie, assignation à une attente inquiète nourrie de souvenirs et d’espoirs…
Le fond des préoccupations de Carole s’épanouit sur cette vacuité forcée aux cours de l’expectative sans limites provoquée par l’envoi du vieil homme. La narratrice retrouve dans cette vallée retirée les connaissances qui ont accompagné sa vie jusqu’à son départ pour d’autres horizons. Entre-temps, Carole s’est mariée, est devenue professeur de cuisine dans un lycée professionnel en même temps que traductrice pour un éditeur de Saint -Étienne. Mais son compagnon— qu’elle nomme toujours le père des filles— l’a quittée et celles-ci, devenues adultes, viennent de partir aussi pour de lointaines expériences. Le cœur de Carole est vide et lourd, disponible pour la nostalgie et l’introspection.
J’aime l’art de Claudie Gallay qui sait dessiner avec vigueur des personnages entiers, sincères et durs : Les trois membres de la fratrie, aux destins bien différents, mais aussi moult personnages secondaires dont les silhouettes peuplent avec vraisemblance les paysages brumeux et pluvieux de la montagne industrieuse. Les états d’âme de ses personnages permettent de développer tout à tour bien des aspects de la vie, conférant une valeur universelle aux cas particuliers décrits. Il est question avec finesse de l’avenir de cette vallée, entre respect des activités traditionnelles et pulsion d’ouverture à une économie touristique, mirages de profits et de dynamisme social. Au plan personnel et affectif, ce retour aux sources peut-il réchauffer les cendres du passé ? Que propose Jean, ami d’enfance et premier amour avec ses multiples attentions ? Que dit cette chasse aux clichés de l’attente et des ombres qui couvent dans les non-dits des habitants de la vallée ?
Le nœud de l’affaire se pressent dans le rapport de Philippe et de Carole à Gaby, la benjamine. Elle est des trois celle qui semble la plus perdue, celle qui fait toujours les mauvais choix, celle que la vie n’aime pas. À la manière du Petit Poucet, Claudie Gallay sème tout au long des lignes du roman des éléments de souvenirs qui peu à peu s’organisent comme les pièces du puzzle de Diego, le restaurateur. Dans le passé, la famille a vécu un terrible drame, l’incendie de leur maison, au cours duquel leur mère, figure tutélaire détenant le pouvoir idéalisé d’aimer, a dû choisir… Et ce choix, forcé ou non, a inscrit de manière indélébile l’avenir de chacun.
Tout est là, cette responsabilité que nous portons à notre égard comme à celui des êtres que nous aimons : Nos parts d’ombre et de lumière, nos élans et nos obstacles, nos pulsions de vie et nos désirs de mort. Les touches de peinture que posent les mots de l’auteur révèlent les drames intimes et les réparations fragiles. La surprise, en toute analyse, apparaît justement dans le secret des forces accumulées dans l’adversité. Qui s’en sort le mieux ? Qui vit au plus près de sa nature profonde ?
La réussite de ce roman tient pour partie au contexte social et économique que Claudie Gallay excelle à bâtir. Elle est également une fine observatrice de la nature dont elle sait transmettre la beauté quotidienne, celle qu’on ne voit plus à force d’y vivre, autant que la grandeur quand les circonstances deviennent inhabituelles ou dangereuses. Elle développe surtout une manière d’écrire au ras de l’âme des personnages, donnant à chacun le ton exact qui l’habille de vérité. Je tiens une part de ciel pour une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines et j’ai plaisir à partager mon admiration pour cette écrivaine. Puissiez-vous y trouver le même contentement…
Une part de ciel
Claudie Gallay
Actes Sud (août 2013)
ISBN : 978-2-330-02264-8
16:39 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, roman, claudie gallay, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
18/07/2014
Les lisières
Roman en forme d’autofiction ou autofiction qui fait semblant d’être un roman ?
Assurément le lien entre réalité et fiction est ténu dans cette oeuvre d’Olivier Adam. Quand s’ouvre le récit, Paul Steiner, le narrateur, traverse une passe difficile. Il refuse d’admettre que la séparation imposée par son épouse est irrémédiable. Bien qu’il ait déménagé dans la même rue de sa cité bretonne, il souffre du manque de ses enfants au quotidien. Mais la remise en question n’est guère profonde : il sait être et avoir toujours été un être tourmenté, et jusqu’alors, sa famille fonctionnait. La lassitude de Sarah ne peut être que temporaire, il se persuade que la désagrégation de son couple ne peut être qu’une étape provisoire.
Quand son frère aîné lui demande de le relayer auprès de leurs parents vieillissants, il prend cette requête pour une corvée malencontreuse de plus. Paul a quitté depuis longtemps la banlieue parisienne où il a vécu son adolescence, tout comme son frère. Cependant François, l’aîné, bénéficie de la posture du « bon fils », tandis que le départ de Paul ressemble plus à une fuite impliquant l’abandon d’une famille et d’un passé où il étouffait.
Très rapidement en effet, les rapports entre Paul et son père prennent un tour d’agressivité mal maîtrisée. Malgré son égocentrisme, Paul réalise que l’état de santé de sa mère est réellement préoccupant. Le déni paternel représente un autre sujet d’inquiétude. Le dialogue entre les deux hommes devient difficile, tant les blessures d’ego sont vives. Le père s’est senti renié par le succès du fils, celui-ci n’a d’autres réponses que la fuite à la recherche des anciens camarades. Ce qui lui permet de constater combien il est loin de leur mode de vie et de leurs problèmes sociaux économiques irrésolubles.
À travers ce qui ressemble à une très longue logorrhée nombriliste, olivier Adam parvient à poser des état de faits assez pertinents : le marasme des banlieues, l’engluement du couple, le désastre du vieillissement de la population. Trois piliers de ce roman qui nourrissent largement le sentiment de déprime du narrateur …Et du lecteur.
Sans nier les qualités de narration, je confesse avoir éprouvé quelques fatigues à la lecture. Je l’ai dit, tous les problèmes abordés évoquent des faits qui sonnent justes, d’autant que nous y sommes (ou serons) confrontés. Mais le ton du roman, l’angle de vue adopté par le narrateur, double distancié de l’auteur, me ramène à ce que je perçois comme un travers bavard anti-littéraire, même s’il relève d’une pratique courante dans la sphère germanopratine. Olivier Adam ne tente d’ailleurs même pas de disculper son personnage. Il tient le filtre du nombrilisme pour éclairage significatif, ce qui n’est pas entièrement faux d’un point de vue existentiel. Je veux bien concéder qu’il s’agit ici de ma propre fatigue face à cette manière de grever nos relations affectives. Mais à vouloir tout dire, même en 450 pages, Olivier Adam a provoqué en moi un besoin irrépressible d’aller respirer ailleurs… Un livre intéressant, mais pas incontournable.
Les lisières
Olivier Adam
Flammarion Août 2012
ISBN :978-2-0812-8374-9
10:07 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olivier adam, les lisières, roman français, littérature, lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/07/2014
L'Arc en ciel blanc
Ce recueil remarquable comporte quatre récits écrits entre 1953 et 1964. Ce sont de longues nouvelles à l’écriture sobre et efficace, et qui ont en commun le poids de l’inexorable qui pèse sur la destinée.
L’arc-en-ciel blanc, qui donne son nom au recueil, est la plus ancienne de ces nouvelles. Il y règne une atmosphère particulière, à la limite du fantastique. Toshisuke a épousé Ayako, beaucoup plus jeune que lui. Immédiatement, il a compris que sa femme n’était pas prête à accepter les relations conjugales. « Leurs corps ne se touchaient pas beaucoup plus. Pour sa part, il n’essayait jamais d’aller vers elle.
Cette relation bizarre était liée à sa réaction lors de la première nuit…Ce soir-là, à l’instant où son mari l’avait touchée, Ayako n’avait pas caché sa violente aversion. »
Toutefois, depuis quelque temps, Toshisuke observe que le comportement d’Ayako se modifie. La nuit, elle semble vivre un rêve éveillé, prétend entendre sa mère décédée, puis elle semble malade. Toshisuke s’inquiète, et l’on pressent sa tendresse à l’égard de sa jeune femme. « Il pensa qu’il venait de goûter pour la première fois depuis leur mariage un sentiment de couple. » Peu après, la jeune femme en vient à avouer le viol dont elle a été victime peu de temps avant leur mariage. Difficile moment pour un couple que celui où cet aveu se révèle lourd de conséquences. Mais Toshisuke assume cette paternité honteuse :
« L’acte impulsif d’un homme (…)…Voici ce qui était à l’origine de tout. De plus, le corps de sa femme n’avait gardé que les conséquences de l’acte de cet homme. L’existence de Toshisuke en tant qu’époux n’avait pas de prise sur ce corps.
Le bébé s’imposait majestueusement dans le couple. Il tétait le sein d’Ayako, Toshisuke le changeait.
Toshisuke chaque soir glissait la bouillotte dans le lit du bébé. Et lui, avec ses jambes toujours glacées, avait le plus grand mal à s’endormir. » (Page 28)
Puis on apprend la mort accidentelle du Bébé. Un procès a lieu dont Ayako est acquittée. Mais le couple sortira-il de cette épreuve ?
Un été en vêtements de deuil (1958) nous entraîne à la suite de l’orphelin Kiyoshi dans le jardin de la maison où sa grand-mère l’héberge. Outre les poules et la domestique de l’aiëule, nous découvrons également sa petite compagne Tokiko et sa mère hébergées dans une resserre à l’écart de la grande maison. Un mystère plane sur les relations de tout ce petit monde, mais il est évident que tous dépendent de cette grand –mère immobile. Une nuit, Kiyoshi est réveillé par des bruits bizarres. Dominant sa peur, le garçonnet explore l ’immense couloir et découvre une trappe menant à une cache… Grand-mère est-elle si malade ? Son père est-il vraiment mort ?
Le troisième récit, étoiles et funérailles (1960) met en scène Jirô, le garçon qui aime beaucoup les enterrements. Jirô est un peu simple d’esprit, mais nous comprenons pourquoi il n’en manque aucun, et se montre tellement scrupuleux sur le déroulement du rituel. On pourrait même le croire très malin, ce Jirô qui vit seul avec sa mère mal aimante. Mais dans le voisinage de Jirô vit Tokiko, pauvre gamine totalement perdue avec son bébé sur le dos. Tokiko est plus malheureuse que Jirô, alors celui-ci n’écoute que son cœur et tente de l’aider. Comment Tokiko perçoit-elle les avances de Jirô ? Incompréhension, maltraitance, inceste et solitude sont les seules vertus promises à ces représentants du petit peuple. Cette nouvelle magnifique me semble la plus désespérée des quatre récits.
Ce sont encore des enfants aux corps maigres, Kiyota et sa sœur Hisae, qui essaient de lutter contre une fatalité. Ce n’est pas la misère qu’ils veulent contrer, par une nuit étoilée, en fuyant la société de recherche close par un Mur de brique ( 1964) où ils demeurent depuis que leur mère s’est remariée avec ingénieur. Oh, ce n’est pas qu’il n’apprécie pas le beau-père, au contraire, ils sont appris à lui être reconnaissants de veiller à leur éducation. Mais en vivant sous son toit, ils ont découvert ce qui se trame dans cette entreprise … Et malgré leur jeune âge, ils ne peuvent accepter ce qu’ils ont découvert. Seulement voilà, peut-on sauver quelqu’un malgré lui ?
J’ai beaucoup aimé la poésie de cette dernière nouvelle, moins désespérée que les récits précédents. Poignant comme l’Arc en ciel blanc, où presque cynique dans Étoiles et funérailles, l’univers de Akira Yoshimura dresse un état de la société japonaise qui étreint par la profonde misère morale autant que matérielle qu’il dépeint. Cette œuvre sombre offre cependant une poésie du dénuement, non comme une fin en soi, mais comme regard sur les êtres faibles et leur manière de se débattre, cette découverte mérite le détour.
L’Arc en ciel blanc
Akira Yoshimura
Actes Sud (2012)
ISBN :978-2-330-00617-4
19:50 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, littérature japonaise, akira yoshimura, nouvelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
11/07/2014
Nous étions les Mulvaney
Au moment du choix de ce roman, il faut se fier au titre. L’usage de l’imparfait est en soi un indice sémantique pertinent. Tenir compte aussi de l’univers de l’auteur : chez Joyce Carol Oates, pas d’angélisme ni d’optimisme béat. De l’optimisme pourtant, Corinne Mulvaney n’en manque pas, cette mère de famille ne ménage pas sa peine pour transmettre à ses quatre enfants sa foi et son énergie. Et contrairement à d’autres de ses créatures, il me semble que l’auteur a ressenti une sympathie, voire une véritable tendresse pour ces Mulvaney.
Ce sont les six membres d’une famille américaine que l’on suit sur deux décennies, des années 70 au début 90. Les deux époux, Michaël et Corinne viennent d’horizons très différents : Michaël, en rupture familiale dès son jeune âge, devient le prototype du self made man, après avoir connu une jeunesse aventureuse. Jusqu’au jour où il rencontre une curieuse jeune femme rousse et maladroite, qui compense sa beauté discrète par le charme plus durable d’une nature profondément cocasse. Michaël évoluera en durcissant ses ambitions, exigeant avec lui-même comme avec chaque membre de son entourage. Il prospère en fondant sa société et gravit un à un tous les échelons du code social. Corinne incarne l’autre versant : dynamique et un rien brouillonne, elle gère la vie à la maison, c’est- à- dire High Point Farm, la ferme où cohabitent enfants et animaux. Cette ferme représente l’univers parfait pour Corinne, issue d’une famille de fermiers d’origine allemande, dont elle a hérité foi religieuse et volonté de travail. Indéfectible soutien de son mari qu’elle aimera jusqu’au bout, Corinne détonne pourtant à ses côtés par son originalité vestimentaire. Mais elle est moulée elle aussi par le rêve américain, fixée sur l’objectif de mener une famille « parfaite », où chacun exécute tâches domestiques et fonctions sociales.
L’ascension des Mulvaney est longue et belle, jusqu’au jour où Michaël est enfin intronisé membre du club le plus en vue de Mont Ephraim, la ville proche de High Point Farm. Mais l’aîné, Mike junior, commence à décrocher, abandon de sa carrière sportive, et nuits trop arrosées. Son cadet, Patrick, se construit une carapace d’intellectuel arrogant et rebelle. Marianne répond à la fierté de ses parents, adolescente entourée d’amies, elle irradie et incarne toute la réussite paternelle. Quant à Judd, le benjamin, il grandit imprégné d’admiration infantile pour chacun de ses aînés.
La fêlure échappe à tous pourtant, ce lendemain du bal de la Saint Valentin 1976, où Marianne, comble d’honneur, était invitée. Curieusement, ni Patrick à qui il est demandé d’aller rechercher sa sœur et qui ne s’inquiète pas de son mutisme, ni sa propre mère Corinne, que les succès scolaires et amicaux de sa fille éblouissent, encore moins le père tellement occupé qu’il rentre de plus en plus tard… Personne ne perçoit le malaise patent de Marianne.
Aussi quand éclate enfin le scandale, les réactions des uns et des autres nous prennent au dépourvu. La culpabilité docile, la soumission de Marianne convient en apparence à Corinne et l’on reste stupéfait devant cette soudaine pruderie. La colère de Michaël père est violente, douloureuse, et dans un premier temps, on se dit qu’il a raison : allez régler ses comptes directement chez le « salaud ». Mais… Mais la pression est forte, Marianne tellement repliée sur sa » faute » —poids de la pratique religieuse. Par le regard de Judd, de Patrick dit Pinch, nous suivons alors la métamorphose du rêve en cauchemar.
Joyce Carol Oates poursuit sans concession la dissection méticuleuse des verrous sociaux et culturels. Son analyse acérée se teinte cette fois de tendresse pour Marianne et Corinne. Son empathie lui permet de démontrer comment chacune se débat dans le désastre. La force de l’amour de Corinne pour Michaël est saisissante, et l’on reste sidéré par le parti pris à l’égard des enfants, de la jeune fille en particulier. La construction du roman emprunte parfois la narration personnelle, à travers les points de vue différenciés de Judd ou de Patrick, pour mieux considérer comment ces enfants issus d’un clan fusionnel vont s’approprier leur propre destinée, hors Mulvaney. L’arrachement au formatage familial pour chacun des quatre rejetons est sinueux, difficile, douloureux, « une vie en patchwork « selon le reproche à peine déguisé de Corinne à sa fille.
Et même si l’on se dit qu’on est en train d’observer une famille campagnarde américaine sous la loupe d’une écrivaine de là-bas, difficile de ne pas frémir en reconnaissant sous les mots de Joyce Carol Oates les ferments du qu’en dira-t-on universel, la violence de l’ambition, la versatilité des sentiments, la révolte face à l’injustice. Le monde décrit par l’auteur est dur, mais il appartient à chacun de s’y construire en choisissant ses valeurs, telle serait la morale finale de cette saga captivante.
Nous étions les Mulvaney
Joyce Carol Oates
Paru aux USA :1996
En France chez Stock en 1998
Edition le livre de Poche, 2011
ISBN : 978-2-253-15750-2
19:43 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, roman, littérature américaine, joyce carol oates, critique socila, note de lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer