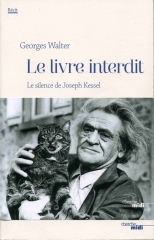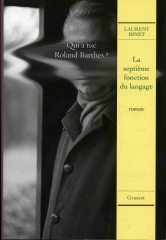19/06/2016
Réparer les vivants
Justement un des livres les plus récompensés de la rentrée 2014, Réparer les vivants est un livre aussi envoûtant que déroutant, une ode à la Vie qui renaît de la Mort. Un livre dont on se dit qu’il ne faut pas se séparer, qu’on vient de toucher là au grand Mystère. Et pourtant, rien de « religieux » dans ce récit, rien qui prête à l’ésotérisme ou aux courants philosophiques ou new age; La forme elle-même, propre à Maylis de Kerangal, adopte ce ton méticuleux, cette démarche quasi scientifique qui lui confère davantage la couleur du reportage que l’atmosphère du roman. Mais en matière de roman, en ce qui concerne l’exploration de l’âme humaine, oui, ce livre nous entraîne tout au long de ses pages jusqu’au tréfonds des sentiments, des motivations, des émotions et des bouleversements auxquels le destin nous confronte inévitablement.
Tel est le destin donc de Simon Limbres, qui n’a pas vingt ans, et qui aime tant la vie qu’il rencontre sa mort trop tôt. C’est un accident, bien sûr. La faute à personne comme on dit, la faute à ce sentiment de jeunesse, se croire immortel et présumer de ses forces. Simon arrive à l’hôpital en état de mort cérébrale. Il reste quelques heures pour découvrir, accepter, transformer cette catastrophe en ressources, en renaissance, en maillon d’éternité pour ceux qui font partie des vivants.
Une vraie révolution sur vingt-quatre heures, que nous suivons chez tous les protagonistes du drame, à commencer par Marianne et Sean, les parents de Simon. Et Juliette, sa petite amie. Mais aussi tous les membres de l’équipe soignante, que nous suivons pas à pas tout au long de cette journée dense, où la fatigue est sans cesse repoussée par l’urgence des soins, des décisions, des rencontres nécessaires. Et même pour Claire, quinquagénaire à bout de souffle, perturbée par la perspective aussi soudaine qu’attendue d’un cœur à prendre.
Maylis de Kerangal utilise souvent le paradoxe pour parer l’évidence. Son écriture s’attache aux détails pour mieux exacerber le vital. La dureté du choc émotionnel, la beauté fascinante des vagues, la collision des vies personnelles et professionnelles, elle conte par le menu toutes les péripéties de cette course contre le temps, décompte fatal et prodigieux. Par ce procédé, l’émotion cueille souvent le lecteur là où il ne l’attend pas. À peine remarque-t-on les jeux de mots parsemés ici ou là : Le coordinateur Thomas Rémige, amoureux des passereaux sera l’oiseau de bon et de mauvais augure, Simon qui vit dans les limbes sa dernière journée, s’appelle Limbres…
Ce roman est aussi un hommage rendu à ces héros modernes que sont les chirurgiens et les équipes hospitalières, une reconnaissance du travail souterrain mais essentiel de ceux qui oeuvrent loin des médias, dans l’intimité forcée des endeuillés. C’est une lumière forte portée sur nos angoisses et nos douleurs. Mais en fin de compte, c’est une ode à la vie, qui triomphe quand même. Un superbe livre, qui marque pour longtemps.
Réparer les vivants
Maylis de Kerangal
Folio (Gallimard) avril 2014
ISBN :978-2-07-046236-0
12:09 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maylis de kerangal, réparer les vivants, vie et mort, chirurgie cardiaque, transplantation, greffe, roman contemporain |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/06/2016
Je me souviens de tous vos rêves
Le dernier opus de René Frégni appartient à cette catégorie des livres- conversations qui sont autant d’invites à la résonance de nos propres émotions. Ce sont les deux derniers chapitres qui révèlent les intentions réelles qui sous-tendent les précédentes confidences :
Page 145 : « J’aurais voulu faire un livre sur le silence, remplir ce cahier de silence, dessiner des mots de plus en plus silencieux, comme on entre dans l’eau des rêves.
Je n’ai jamais ressenti, à travers les saisons de ma vie, un tel besoin de silence. Dans ce cahier, j’ai voulu parler d’un libraire, de mon chat, de quelques hommes perdus, parler de la lumière des collines, du visage d’Isabelle, de la douceur des chemins les après-midi d’automne, de cette petite table où j’invente la tendresse, en écoutant derrière la vitre les voyages du vent. »
Aucun éditeur n’aurait pu résumer en « quatrième de couve » de meilleure incitation à découvrir les mots de René Frégni.
Certains d’entre vous connaissez déjà cet écrivain méridional pour ses romans noirs, récits durs inspirés de ses propres expériences: Les chemins noirs, Où se perdent les hommes, Lettre à mes tueurs, Sous la ville rouge. Mais il ne faudrait pas ignorer le René Frégni conteur philosophe, l’homme poète qui, comme Christian Bobin, sait s’extasier et partager la lumière d’un rayon de soleil déchirant la brume, l’argent des oliviers frémissant dans le vent, la présence charismatique d’un chat réchauffant votre solitude… Après la fiancée des corbeaux, tel est cet ouvrage au titre percutant, Je me souviens de tous vos rêves.
Parce que René Frégni est un humaniste, un écrivain puisant à la source des autres, ainsi qu’en témoigne son récit d’amitié avec Joël Gattefossé, le libraire génial de Banon qui a inventé un village-librairie… Le chapitre qui lui est consacré est des plus émouvants, et l’on se prend à refaire le monde, abolir les horribles règles comptables et les banquiers incultes qui ruinent les rêves des grands enfants.
Mais quel que soit le sujet abordé, parmi toutes ces anecdotes qui pourraient appartenir à chacun d’entre nous, lecteurs du dimanche ou dévoreurs du soir, se niche toujours la petite remarque qui touche le cœur et l’esprit, qui nous conduit à une réflexion inattendue et aussitôt reconnue pour sa justesse. Ainsi, quand il évoque le cimetière où reposent ses parents, page 97 :
« En faisant le tour pour remettre ces fleurs debout, j’ai vu que la mairie avait agrandi le cimetière, c’est plutôt bon signe, preuve que le village, lui, ne meurt pas. »
Je me réjouis donc de rencontrer à nouveau demain chez ma libraire Catherine cet écrivain généreux et inventif, qui confesse aimer l’écriture comme « un combat de chaque mot entre contrainte et liberté. Rien n’est plus érotique que l’écriture », ( page 117).
Et si « le ciel est bien trop petit aujourd’hui pour contenir tous les nuages » (page 102), les pages de ce livre nous offrent bien plus encore en partageant avec nous les rêves d’un homme assagi que l’amour d’une mère disparue émeut encore au coeur de ses nuits :
« J’ai été réveillé par les pleurs de ma mère au fond de ma poitrine, comme elle recevait dans la sienne, jadis, la secousse des miens. (…)
Je ne choisis pas mes rêves, ils m’apportent ce qui me manque le plus. ( Page 149)
Je me souviens de tous vos rêves
René Frégni
Gallimard (la blanche) nrf Janvier 2016
ISBN : 978-2-07-010704-9
19:31 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : s rêves, récit, lecture, poésie, confidences, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
02/06/2016
L'amie prodigieuse
Justement reconnu comme un roman jubilatoire et fourmillant de vie, l’amie prodigieuse s’inscrit sur la liste des lectures qui laissent leur empreinte et nous enjoignent de lire la suite, qui sort justement ce printemps en France. Elena Ferrante nous entraîne dans un quartier pauvre à la périphérie de Naples, dans les années cinquante, en compagnie de deux fillettes qui tissent une amitié dense et exclusive. Lila et Léna unissent leurs talents pour découvrir et amadouer un monde difficile et pour tout dire assez sordide. Déjà lu, penserez-vous. Ça ressemble en effet aux romans dit d’initiation, qui nous content la prise de conscience des difficultés du monde, vue à hauteur d’enfants. Bien menée, la fraîcheur du récit souligne alors les aspects sordides de la société.
L’amie prodigieuse s’appelle Lila, elle est fille du cordonnier Fernando Cerullo, qui peine dans son échoppe, pour avoir refusé de se compromettre avec les mafieux de son quartier. Lila est chétive, mais remarquablement vive d’esprit et son institutrice Madame Oliviero aimerait bien pousser son élève dans les allées du Savoir… Mais c’est Léna, Lenù en dialecte napolitain, qui bénéficiera de cette chance, bien qu’elle paraisse moins brillante, plus pusillanime parfois. Les parents de Léna, son père du moins, semble plus sensible à la fierté et à l’espoir d’offrir un sort meilleur à sa fille aînée.
Les routes des deux adolescentes doivent donc bifurquer, ce qui n’altère en rien l’admiration que la narratrice, Léna voue à son amie. Apparemment, Lila s’en sort bien, grâce à sa force de caractère qui lui permet de puiser des ressources d’enthousiasme et de passion dans sa nouvelle situation. Les deux fillettes quittent l’enfance et ses illusions. Malgré sa chance de découvrir un autre monde par la culture et la fréquentation du lycée, Léna ressent toujours le besoin de s’identifier à Lila en confrontant ses expériences à celles vécues par son amie. Elle se sent désorientée lorsque celle-ci semble se plier au sort des filles pauvres et s’engage dans la voie des fiançailles avec l’épicier Stefano, le fils de Don Achille, le petit chef camoriste qui les terrifiait dans leur enfance…
Outre les péripéties qui jalonnent le récit et dressent un tableau saisissant des conditions sociales et économiques d’une banlieue au mitan du XXe siècle, le roman d’Elena Ferrante est d’autant plus touchant que s’y joue le devenir d’une communauté à part entière. La psychologie des personnages, à commencer par celle de la narratrice, est toujours ambivalente: jalousie, rancœur, peurs ordinaires et machisme inculqué par l’éducation, habitent ses personnages autant que leurs espoirs insensés et leurs ambitions raisonnables. L’auteur n’idéalise aucun des caractères présentés et nourrit même les personnages secondaires de traits cruciaux qui leur confèrent une présence justifiée. Je pense à la bande d’adolescents, filles et garçons qui entourent naturellement les deux amies, à Rino, frère de Lila qui partage ses désirs de revanche, à la perversité du poète Sarratore…
En parallèle se situe d’ailleurs un autre débat qui n’est pas des moindres: le bouleversement qu’apporte dans ce microcosme l’accès aux études d’un petit nombre d’élus alors que d’autres n’ont pas l’opportunité de s’échapper d’un quotidien plombé par les traditions et les commérages rituels. Le malaise ressenti par Lena qui anticipe la fracture à naître avec Lila, la rivalité souterraine qui entache ses joies secrètes quand elle comprend les efforts cachés de son amie pour suivre la même progression, l’écartèlement de Lena qui parvient difficilement à se situer entre ses deux univers, la tentation du renoncement et la reddition aux lois du plus fort sont autant de thèmes développés subtilement au fil du récit. L’intrigue se resserre de plus en plus autour de ce combat en abordant le mariage de Lila et c’est peu de dire combien la fin nous laisse sur notre faim… En attendant de se procurer sans tarder le nouveau nom, volume suivant paru justement ce printemps.
L’amie prodigieuse
Elena Ferrante
Folio (Gallimard 2014)
ISBN :978-2-07-046612-2
18:23 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : elena ferrante, roman italien, naples, la société des années cinquante, amitié, rivalité, féminisme et machisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
05/04/2016
La cache
Présenté comme un roman, ce récit de Christophe Boltanski appartient sans doute davantage au genre autobiographique, bien qu’il ne concerne pas seulement son auteur. Car en réalité, le journaliste de l’Express consacre son premier « roman » à la saga de ses ancêtres — Entendez par-là essentiellement ses grands-parents. Grâce à une astuce assez fine que Christophe Boltanski apparente à une partie de Cluedo, le récit s’articule autour de la géographie des lieux ; nous quittons peu l’appartement établi dans un hôtel particulier de la rue de Grenelle, en commençant par la plus petite cellule de ce logis tribal, la Fiat 500. Cette voiture en vogue dans les années 50-60, surnommée en son temps « pot à yaourt, sert longtemps aux transports quotidiens de la famille dans Paris. On note l’humour et la dérision des descriptions, étonnantes, de « Mère-Grand » au volant de l’engin, déposant son mari Étienne, médecin des hôpitaux de Paris et Professeur émérite de la Faculté. Mère-grand ne se déplace qu’en tribu, telle une reine abeille perpétuellement entourée de ses extensions familiales, enfants puis petits-enfants.
Progressivement, de pièce en pièce, selon le schéma qui introduit chaque chapitre, nous allons découvrir à la fois quels sont les protagonistes de cette famille singulière, et les raisons de ce comportement tribal. Au fil du récit, se dessine une vie en retrait, chacun s’associant à un territoire spécifique, Jean-Élie, oncle de Christophe, est associé à la cuisine, comme Christian, un autre oncle le sera plus tard dans le récit à son atelier du second étage de l’immeuble. Toutefois au fil de la progression dans la visite des lieux, l’intérêt du récit se concentre sur la personnalité excessive de Marie-Élise, alias Myriam, alias Annie Lauran, la fameuse grand-mère de l’auteur. Cette femme, au destin très particulier, apparaît comme une battante. Dès l’enfance où elle est quasiment vendue à une « marraine » d’adoption, qui l’élève dans un monde clos, déjà, où la bigoterie le dispute au conformisme et au quand dira-t-on, Marie-Élise, devenue Myriam, se sent marginale. Atteinte de poliomyélite alors qu’elle est déjà jeune adulte, elle n’accepte pas son handicap et s’insurge contre quiconque prétend l’aider, si ce n’est un membre désigné de sa famille. Son mari Étienne, Grand-papa, si doux, si sensible, si effacé en apparence aux yeux du petit Christophe, un médecin dont la main tremble quand il lui faut vacciner ses petits-enfants, a été élevé par une mère assez excentrique, issue d’une famille juive d’Odessa. Beaucoup de personnalités exubérantes donc à l’origine des gènes Boltanski, ce qui apparemment leur permet à tous de se réaliser, soit dit au passage. Étudiant, le jeune homme fréquente André Breton avant de se tourner résolument vers la pratique de la médecine, et de servir au front pendant la grande guerre. Intellectuellement brillant, ce n’est pourtant pas un homme qui se met en avant, au fur et à mesure du temps, il semble s’effacer devant la volonté tenace de sa femme. Et c’est bien elle qui le sauvera de la déportation en organisant la mise en scène de leur divorce, de sa prétendue fuite, de sa vie recluse dans la cache qui donne son titre à l’ouvrage. Il est évident que la force des liens tissés par cette femme a constitué une cellule familiale à la fois généreuse et oppressante, dont l’auteur cherche peut-être à se dégager en écrivant leur histoire.
Histoire devenue roman, donc, puisque de son propre aveu, Christophe Boltanski n’a cherché qu’à donner sa vision des faits et des personnes, en un portrait sincère et détaché, où l’affection ne nuit pas à la lucidité. À cet égard, c’est un roman touchant.
La cache
Christophe Boltanski
Stock novembre 2015
ISBN: 978-2-234-07637-2
18:22 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christophe boltanski, la cache, roman français, famille, saga familiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
04/04/2016
Si c'est un homme
Au rayon Témoignages, ce livre est un incontournable. Non pas encore un livre sur la Shoah et les camps, mais il est plutôt Le Livre, l’un des premiers écrit et publié— dès 1947— accueilli pendant plus d’une décennie par un silence général, une volonté d’occultation qui a causé les ravages que l’on sait, et peut-être à long terme une des causes de la disparition tragique de son auteur.
Ce qui confère au témoignage de Primo Levi un caractère tellement particulier tient dans la réflexion qui sous-tend chaque fait rapporté. Le récit des souffrances et des humiliations subies est transmis en même temps que la recherche de sens, non pas du pourquoi elles sont infligées, mais du pourquoi et comment les supporter et résister à leur pouvoir dévastateur.
Page 18 : « Nous découvrons tôt ou tard dans la vie que le bonheur parfait n’existe pas, mais bien peu sont ceux qui s’arrêtent à cette considération inverse qu’il n’y a pas non plus de malheur absolu. Les raisons qui empêchent la réalisation de ces deux états limites sont du même ordre : elles tiennent à la nature même de l’homme, qui répugne à tout infini. Ce qui s’y oppose, c’est notre connaissance toujours imparfaite de l’avenir ; et cela s’appelle, selon le cas, espoir ou incertitude du lendemain. »
Ce paragraphe qui figure dans les premières pages du témoignage de Primo Levi éclaire le sens de ce récit volontairement épuré de tout pathos, alors même que les faits précisément retranscrits confinent à l’horreur absolue, à la barbarie érigée en système, à la folie humaine légitimée, autorisant les crimes de masse qui nous font encore frémir.
Arrivé au camp d’Auschwitz – Monowitz fin février 1944, Primo Levi déroule avec une précision « scientifique » l’organisation de la vie au Lager. Par chance, il fait partie de ceux qui sont retenus pour travailler et avec ses compagnons d’infortune, il s’adapte à la faim, au froid, à la torture quotidienne du manque, à la promiscuité des couchettes occupées à plusieurs, au bruit des autres pensionnaires du dortoir, aux vols à répétition qui n’en sont plus dès lors que ce sont des actes de survie.
Page 111 : « Aujourd’hui est une bonne journée. Nous regardons autour de nous comme des aveugles qui recouvrent la vue, et nous nous entre-regardons. Nous ne nous étions jamais vus au soleil : quelqu’un sourit. Si seulement nous n’avions pas faim !
Car la nature humaine est ainsi faite, que les peines et les souffrances éprouvées simultanément ne s’additionnent pas dans notre sensibilité, mais se dissimulent les unes derrière les autres par ordre de grandeur décroissante selon les lois bien connues de la perspective. Mécanisme providentiel qui rend possible notre vie au camp.
Primo Levi était un humaniste. Né en 1919, il n’a découvert sa judéité qu’à travers la discrimination des lois antijuives qui apparaissent dès 1938 dans l’Italie de Mussolini. C’est dire que l’ouverture d’esprit hérité de ses parents ne l’avait pas préparé à la soumission. Ingénieur Chimiste, à vingt-quatre ans, il entre en Résistance en 1943, mais comme il l’a clairement exprimé tout au long des conférences et interventions de la dernière partie de sa vie, il ne s’est jamais rangé du côté de la rébellion physique. S’il a tenu le coup, lui, dans les conditions où tant d’hommes sont morts autour de lui, cela tient à la chance, mais aussi à cette capacité de réflexion qui lui permet d’analyser le danger, de l’amadouer en comprenant sa nature, de contourner l’animalité que l’extrême dénuement fait réapparaître en nous. Page 20 : Rares sont les hommes capables d’aller dignement à la mort, et ce ne sont pas toujours ceux auxquels on s’attendrait. Bien peu savent se taire et respecter le silence d’autrui.
Aussi importantes sans doute que ce récit pourtant très incisif, les réflexions annexes à cette édition Pocket retirée en 2014, nous permettent de mieux comprendre le message et les leçons que cet homme a su mettre en évidence. Chaque lecteur aborde évidemment ce livre avec sa propre expérience de la vie et ses engagements individuels, mais il me semble que la vision et la compréhension de l’Humanité que nous livre ici Primo Levi constituent un axe de pensée auquel il serait bon de se référer souvent, surtout en cette période. D’ailleurs, n’a-t-on pas récemment repris cette phrase de Heinrich Heine, poète juif allemand du XIXème siècle, cité par Levi page 306 : « ceux qui brûlent les livres finissent tôt ou tard par brûler les hommes ». Paroles prophétiques et glaçantes, qui n’ont rien perdu de leur brûlante actualité.
Page 293 : Les Lager nazis ont été l’apogée, le couronnement du fascisme européen, sa manifestation la plus monstrueuse ; mais le fascisme existait déjà avant Hitler et Mussolini, et il a survécu, ouvertement ou sous des formes dissimulées, à la défaite de la seconde guerre mondiale.
À la question récurrente concernant les causes du développement de l’antisémitisme, Primo Levi apportait cette réponse en 1976 :
L’aversion pour les Juifs, improprement appelée antisémitisme, n’est qu’un cas particulier d’un phénomène plus général, à savoir l’aversion pour ce qui est différent de nous. (…) L’antisémitisme est un phénomène typique d’intolérance . pour qu’une intolérance se manifeste, il faut qu’il y ait entre deux groupes en contact une différence perceptible : ce peut-être une différence physique (…) Mais notre civilisation compliquée nous a rendu sensibles à des différences plus subtiles, comme la langue et les dialectes (…) Ou bien la religion avec toutes ses manifestations extérieures et sa profonde influence sur la manière de vivre, ou encore la façon de s’habiller et de gesticuler, les habitudes publiques et privées.
N’est-elle pas plus que jamais une analyse aiguë de notre société au tournant du troisième millénaire ?
Si c’est un homme
Primo Levi
Pocket (janvier 2003)
Édition initiale : Turin 1958 et 1976
Édition française 1987
ISBN : 978-2-266-02250-7
18:53 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : primo levi, témoignages, camp de concentration, lager, shoah, l'italie de mussolini, la déportation, antisémitisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
20/03/2016
Le livre interdit
C’est un récit bien particulier qui nous est livré ici. Une sorte de double testament, amical et littéraire, puisque le livre interdit représente le dernier ouvrage de Georges Walter, décédé avant de le voir édité. Et l’on apprend de Mathieu Walter*, son fils, que c’était en fait un ouvrage commandé par Pierre Drachline, éditeur au Cherche Midi, décédé également avant la sortie du livre. Une étrange malédiction, le Livre interdit ?
Pierre Drachline avait donc confié à Georges Walter la mission de raconter l’histoire d’un livre que Kessel n’a jamais écrit. L’auteur prolixe des Cavaliers, du Lion, de l’Équipage n’a jamais pu se résoudre à écrire le « roman » de sa mère, Raïssa. Et pourtant, Kessel savait ce qu’il devait à cette femme forte, il possédait même la matière viscérale permettant de lui donner la parole, en l’occurrence le journal d’exil tenu au fil du long périple familial de Russie vers la France en passant par la route de l’Argentine, où est né Joseph. Années difficiles, combats impossibles, surmontés à force de volonté et de désir d’y croire.
Et justement, Georges Walter, se définissant lui aussi comme une sorte d’exilé hongrois, détient, non le journal de Kessel, mais la mémoire des conversations tenues entre les deux amis. Il nous raconte ainsi l’histoire de cette amitié exceptionnelle, une fraternité à certains égards, qui unissait ces deux hommes venus d’ailleurs, aux expériences d’enfance émigrée si ressemblantes. Georges, le plus jeune, a été reconnu comme l’alter ego par Jef. Au seuil de sa propre disparition, l’écrivain journaliste relate à touches mesurées le lien unique et intime, reposant sur le sentiment d’être double, double par l’origine similaire, double par la nécessité d’écriture, double par le goût de l’ailleurs et des autres. Cette amitié à la fois nourrie de reconnaissance et d’autonomie qui permet les défis intellectuels, les joutes oratoires, les soirées très arrosées et l’inépuisable soutien amical face aux désordres intimes.
Georges Walter dessine à petits pas le cheminement des amis de Jef, qui voudrait le voir enfin solder sa dette à Raïssa, régler une bonne fois les non-dits d’une mère au destin accompli. Mais bien plus que la bataille perdue de l’écrivain confronté à sa première page désespérément blanche, résonne aussi le combat de l’homme pour sauver sa femme Michèle de ses propres démons. Les pages consacrées à cette bataille contre l’alcool nous montrent un homme capable d’amour à la miséricorde sans fin, sans jugement, jusqu’à ce silence définitif quand tombe le grand homme.
Les phrases de George Walter sonnent juste et nous donnent furieusement envie de retourner vers les ouvrages de Joseph Kessel, mais aussi vers ceux de son frère en écriture, conteur délicat et ami fidèle.
Le livre interdit
Georges Walter
Éditions du Cherche Midi (Janvier 2016)
ISBN :978-2-7491-4793-2
* Interview à Libération en date du 29 janvier 2016 :
http://next.liberation.fr/livres/2016/01/29/le-vieux-lion...
12:16 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : georges walter, le livre interdit, joseph kessel, mémoires et souvenirs, écriture, éditions cherche midi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
07/03/2016
Brooklyn
Entre l’Irlande des années 50 et Brooklyn, où elle est pratiquement exilée, Eilis Lacey va devoir trouver sa place et le sens de sa vie. Quelle est la part du libre-arbitre pour une jeune fille d’origine très modeste, élevée par sa mère et sa sœur aînée, Rose ?
Le roman dresse d’abord le tableau sociétal d’une famille ordinaire, dans une petite ville du Sud-est de la République d’Irlande. Colm Tòibìn évoque sa ville natale, l’emprise des traditions et du conformisme, les conventions sociales, les difficultés d’une société où le niveau de vie est laminé par la menace du chômage. Évitant tout pathos, l’auteur dresse l’état des lieux tel qu’il est ressenti par son héroïne, une toute jeune fille, admirative de l’aisance acquise par sa sœur aînée. Rose travaille et dispose d’un salaire suffisant pour aider leur mère devenue veuve très tôt. Rose incarne le futur, elle est moderne, autonome, même si en fait nous allons découvrir qu’elle se sacrifie à sa mère. Aussi presse-t-elle Eilis, comme tout le monde, de quitter la petite ville pour rejoindre Brooklyn et sa communauté irlandaise sous la tutelle morale du Père Flood pour s’offrir au moins un avenir.
Ce roman raconte la déchirure du départ, le courage d’affronter l’inconnu et la nostalgie tenace des racines coupées. Bien que situé dans les années 50, le sujet reste d’une actualité brûlante si l’on songe aux millions de personnes jetées sur les routes d’Europe en quête d’un meilleur ailleurs.
Par de très brèves allusions, l’exil économique forcé des frères Lacey en Grande-Bretagne, le poids des conventions sociales qui gèrent même les relations amoureuses, l’autorité naturellement admise de l’Église en la personne bienveillante du père Flood, Colm Tòibìn montre avec justesse combien nos choix sont entravés. Mais il offre à Eilis la force de rebondir grâce à l’autonomie de jugement que son déracinement douloureux lui apporte. Tel est le prix de l’affranchissement, et le dépassement des préjugés inhérents à chaque groupe social. L’arrivée à Brooklyn est difficile, la micro-société recréée dans la pension tenue par la veuve Kehoe semble bien rebutante avec son lot de jeunes femmes obligées au vivre ensemble sous la férule artificielle de la maîtresse des lieux. Moins naïve qu’elle apparaît aux yeux de ses co-pensionnaires, Eilis gagne progressivement sa place dans ce nouveau monde. Les tuteurs moraux que représentent le Père Flood et la veuve Kehoe sont esquissés avec subtilité, ce sont eux qui permettent en fin de compte à la jeune femme de se tracer une ligne de conduite. Jusqu’à ce qu’un drame la rappelle au pays.
Cette dernière partie du roman est poignante. À peine sortie du deuil de l’Exil, Eilis est confrontée à une autre perte, nouveau deuil qui la ramène en Irlande. Elle y découvre à quel point sa mère, incarnation de l’ancien monde, est pesante. Entre réconfort des retrouvailles avec ses amis, où elle bénéficie d’un regard valorisant, et culpabilité de trahir l’attente de ceux qui l’ont accueillie là-bas, que va choisir Eilis ? Ce retour à Enniscorthy représente un nœud drastique. Eilis est tentée par le retour, déchirée par la responsabilité de la parole donnée. Jusqu’aux dernières pages, il est difficile de connaître le sort que se réserve la jeune femme. Ce sera pour elle comme pour chacun de nous, l’obligation de s’imposer un choix, si douloureux et contraignant soit-il. L’occasion pour Colm Tòibìn, qui se fonde sur sa propre expérience, de démontrer combien chaque étape franchie recèle en même temps l’impossibilité de retour en arrière.
Brooklyn
Colm Tòibìn
Robert Laffont 2011
Et pour éd 10/18 : 201 ISBN :978-2-264-05648-1
09:36 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colm toibin, roman, exil, racines, irlande, émigration, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
15/02/2016
La septième fonction du langage
Remarqué dès sa sortie, ce roman de Laurent Binet se signale par l’originalité de son sujet et la vivacité singulière de son écriture. Il pourrait s’apparenter à un thriller, posant d’entrée l’hypothèse d’un crime commis contre l’un des maîtres à penser du vingtième siècle.
En réalité, le lecteur est embarqué très vite dans une parodie de policier mettant en scène de nombreuses personnalités très médiatisées dans les années 70 et 80. Il fallait un certain culot pour s’emparer ainsi des personnages comme Foucault et BHL, ou Sollers pour ne citer que ces trois-là. Outre le monde germanopratin qui est habillé pour plusieurs hivers, Laurent Binet nous offre avant tout une satire des mœurs politiques et médiatiques.
Rire et sourireles zygomatiques du lecteur sont sollicités. Mais aussi cette petite graine qui commence à tourner dans notre tête, au fil des pages : … Et si ce n’était pas tout à fait faux ? Bigre, ça vaut le coup de continuer…
Nous sommes en février 1980, Roland Barthes, linguiste célèbre sort d’un déjeuner chez François Mitterrand, candidat comme chacun sait à l’élection présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines. L’intellectuel vieillissant est préoccupé, déprimé depuis le décès de sa mère dont il était très proche. Est-il trop perdu dans ses pensées, est-il suivi sans en être conscient ? Une fourgonnette le renverse et s’enfuit… À partir de là, toutes les hypothèses sont possibles. Barthes ne meurt pas sur le coup, mais succombe quelques jours plus tard, malgré les veilles alarmées de ses amis. Chargé d’élucider les circonstances de cet accident, l’enquêteur reconnaît d’emblée dans les yeux de la victime une peur intense. Il n’en faut pas plus pour qu’il prenne l’affaire d’autant plus au sérieux qu’en réalité, Jacques Bayard appartient aux RG, et que sa mission est, directement commanditée par l’Élysée.
Bayard analyse très vite qu’il a besoin d’un guide pour comprendre les codes qui régissent les relations du petit monde des célébrités intellectuelles, amitiés indéfectibles, inimitiés définitives, narcissisme à tous les étages, suspicions et batailles d’ego garanties, sans compter bien sûr le sens de ces matières occultes que sont pour lui linguistique et sémiologie. Il débauche donc à « la fac gauchiste de « Vincennes, domaine réservé de Deleuze et de Foucault, un jeune professeur égaré qui stagne dans cette université du pauvre. Simon Herzog accepte à contrecœur d’éclairer la lanterne de Bayard, et tous deux constituent dès lors une équipe d’enquêteurs insolites. Laurent Binet s’amuse, et le lecteur se régale.
Petit aparté ici à l’adresse de tous ceux qui, de la même génération que moi, ont parcouru les couloirs de Censier ou de la Sorbonne dans cette décennie, voire dans mon cas, un tantinet plus tôt : la description du souk paraît réelle, bien que Binet soit à peine né à cette époque.
Le tandem Bayard Herzog entreprend de démêler les arcanes des mystères entrevus quand il se retrouve rapidement victime d’adversaires improbables : Laurent Binet prend le lecteur à témoin pour signaler la-voiture-noire-que-suit-la-voiture-bleue, qui suivent toutes deux nos détectives. La satire cède la place au polar déjanté, qui nous mènera de Paris à Venise en passant par Bologne— Pas de bol, juste au moment où une bombe fait exploser la gare— l’université Cornell à Ithaca (USA) où nous suivons un véritable vaudeville « typically 70’s « : l’auteur met en scène de véritables personnalités (entre autres : Searle, Derrida, Althusser, Sollers et Kristeva, et même… Jakobson en personne !) dans des situations plus loufoques les unes que les autres. Et puis, pourquoi se priver quand on donne dans le baroque et le mélange des genres, voici l’intrigue catapultée dans le genre-société secrète façon Da Vinci, le Logos Club, dont les membres, entichés de dialectique sont prêts à y laisser leurs phalanges, voire plus…
Vous l’aurez compris, les péripéties s’enchaînent sans relâches, l’écriture de Laurent Binet vous emporte avec brio et une facilité déconcertante dans cet univers fantaisiste, avec son lot de rebondissements étonnants et percutants agrémentés d’allusions très fines… Quand arrive le dénouement, nous restons suspendu à un « C’était donc ça ? Et si c’était possible… »
Un conseil, si un week-end morose se profile, n’hésitez pas, procurez vous cette septième fonction du langage, le monde vous paraîtra plus drôle, dans tous les sens du terme.
Outre le Prix Interallié, La septième fonction du langage a été distingué également par le prix du Roman FNAC.
À titre d’illustration du style Binet, rien de mieux que les mots de l’auteur :
Bien sûr, on peut y voir un polar sémiologique, un roman pop, une farce rocambolesque, une satire… Un délire proche du surréalisme. À propos, mon premier émoi littéraire, à 17 ans, avait été la lecture d'un roman de Desnos, La liberté ou l'amour! La septième fonction du langage, c'est également l'occasion d'évoquer et de réfléchir sur le rôle du langage et de la communication verbale. D'ailleurs, j'adore le mélange des genres. Et puis, le roman est par excellence le genre du mélange des genres. La sémiologie, c'est la science de Sherlock Holmes: les signes y sont des indices. Ce que j'aime, c'est faire se rencontrer des personnages réels avec des personnages de fiction. ( Laurent Binet au Figaro le 1er septembre 2015)
La septième fonction du langage
Laurent Binet
Grasset (Août 2015)
ISBN: 978-2-246-77601-7
18:46 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent binet, la septième fonction du langage, roman, satire, polar déjanté, sémiologie, linguistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer