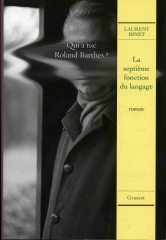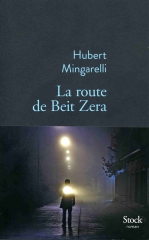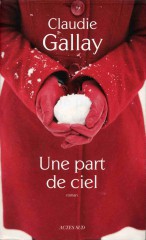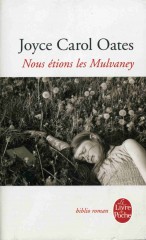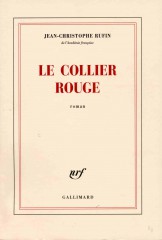07/03/2016
Brooklyn
Entre l’Irlande des années 50 et Brooklyn, où elle est pratiquement exilée, Eilis Lacey va devoir trouver sa place et le sens de sa vie. Quelle est la part du libre-arbitre pour une jeune fille d’origine très modeste, élevée par sa mère et sa sœur aînée, Rose ?
Le roman dresse d’abord le tableau sociétal d’une famille ordinaire, dans une petite ville du Sud-est de la République d’Irlande. Colm Tòibìn évoque sa ville natale, l’emprise des traditions et du conformisme, les conventions sociales, les difficultés d’une société où le niveau de vie est laminé par la menace du chômage. Évitant tout pathos, l’auteur dresse l’état des lieux tel qu’il est ressenti par son héroïne, une toute jeune fille, admirative de l’aisance acquise par sa sœur aînée. Rose travaille et dispose d’un salaire suffisant pour aider leur mère devenue veuve très tôt. Rose incarne le futur, elle est moderne, autonome, même si en fait nous allons découvrir qu’elle se sacrifie à sa mère. Aussi presse-t-elle Eilis, comme tout le monde, de quitter la petite ville pour rejoindre Brooklyn et sa communauté irlandaise sous la tutelle morale du Père Flood pour s’offrir au moins un avenir.
Ce roman raconte la déchirure du départ, le courage d’affronter l’inconnu et la nostalgie tenace des racines coupées. Bien que situé dans les années 50, le sujet reste d’une actualité brûlante si l’on songe aux millions de personnes jetées sur les routes d’Europe en quête d’un meilleur ailleurs.
Par de très brèves allusions, l’exil économique forcé des frères Lacey en Grande-Bretagne, le poids des conventions sociales qui gèrent même les relations amoureuses, l’autorité naturellement admise de l’Église en la personne bienveillante du père Flood, Colm Tòibìn montre avec justesse combien nos choix sont entravés. Mais il offre à Eilis la force de rebondir grâce à l’autonomie de jugement que son déracinement douloureux lui apporte. Tel est le prix de l’affranchissement, et le dépassement des préjugés inhérents à chaque groupe social. L’arrivée à Brooklyn est difficile, la micro-société recréée dans la pension tenue par la veuve Kehoe semble bien rebutante avec son lot de jeunes femmes obligées au vivre ensemble sous la férule artificielle de la maîtresse des lieux. Moins naïve qu’elle apparaît aux yeux de ses co-pensionnaires, Eilis gagne progressivement sa place dans ce nouveau monde. Les tuteurs moraux que représentent le Père Flood et la veuve Kehoe sont esquissés avec subtilité, ce sont eux qui permettent en fin de compte à la jeune femme de se tracer une ligne de conduite. Jusqu’à ce qu’un drame la rappelle au pays.
Cette dernière partie du roman est poignante. À peine sortie du deuil de l’Exil, Eilis est confrontée à une autre perte, nouveau deuil qui la ramène en Irlande. Elle y découvre à quel point sa mère, incarnation de l’ancien monde, est pesante. Entre réconfort des retrouvailles avec ses amis, où elle bénéficie d’un regard valorisant, et culpabilité de trahir l’attente de ceux qui l’ont accueillie là-bas, que va choisir Eilis ? Ce retour à Enniscorthy représente un nœud drastique. Eilis est tentée par le retour, déchirée par la responsabilité de la parole donnée. Jusqu’aux dernières pages, il est difficile de connaître le sort que se réserve la jeune femme. Ce sera pour elle comme pour chacun de nous, l’obligation de s’imposer un choix, si douloureux et contraignant soit-il. L’occasion pour Colm Tòibìn, qui se fonde sur sa propre expérience, de démontrer combien chaque étape franchie recèle en même temps l’impossibilité de retour en arrière.
Brooklyn
Colm Tòibìn
Robert Laffont 2011
Et pour éd 10/18 : 201 ISBN :978-2-264-05648-1
09:36 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colm toibin, roman, exil, racines, irlande, émigration, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
15/02/2016
La septième fonction du langage
Remarqué dès sa sortie, ce roman de Laurent Binet se signale par l’originalité de son sujet et la vivacité singulière de son écriture. Il pourrait s’apparenter à un thriller, posant d’entrée l’hypothèse d’un crime commis contre l’un des maîtres à penser du vingtième siècle.
En réalité, le lecteur est embarqué très vite dans une parodie de policier mettant en scène de nombreuses personnalités très médiatisées dans les années 70 et 80. Il fallait un certain culot pour s’emparer ainsi des personnages comme Foucault et BHL, ou Sollers pour ne citer que ces trois-là. Outre le monde germanopratin qui est habillé pour plusieurs hivers, Laurent Binet nous offre avant tout une satire des mœurs politiques et médiatiques.
Rire et sourireles zygomatiques du lecteur sont sollicités. Mais aussi cette petite graine qui commence à tourner dans notre tête, au fil des pages : … Et si ce n’était pas tout à fait faux ? Bigre, ça vaut le coup de continuer…
Nous sommes en février 1980, Roland Barthes, linguiste célèbre sort d’un déjeuner chez François Mitterrand, candidat comme chacun sait à l’élection présidentielle qui aura lieu dans quelques semaines. L’intellectuel vieillissant est préoccupé, déprimé depuis le décès de sa mère dont il était très proche. Est-il trop perdu dans ses pensées, est-il suivi sans en être conscient ? Une fourgonnette le renverse et s’enfuit… À partir de là, toutes les hypothèses sont possibles. Barthes ne meurt pas sur le coup, mais succombe quelques jours plus tard, malgré les veilles alarmées de ses amis. Chargé d’élucider les circonstances de cet accident, l’enquêteur reconnaît d’emblée dans les yeux de la victime une peur intense. Il n’en faut pas plus pour qu’il prenne l’affaire d’autant plus au sérieux qu’en réalité, Jacques Bayard appartient aux RG, et que sa mission est, directement commanditée par l’Élysée.
Bayard analyse très vite qu’il a besoin d’un guide pour comprendre les codes qui régissent les relations du petit monde des célébrités intellectuelles, amitiés indéfectibles, inimitiés définitives, narcissisme à tous les étages, suspicions et batailles d’ego garanties, sans compter bien sûr le sens de ces matières occultes que sont pour lui linguistique et sémiologie. Il débauche donc à « la fac gauchiste de « Vincennes, domaine réservé de Deleuze et de Foucault, un jeune professeur égaré qui stagne dans cette université du pauvre. Simon Herzog accepte à contrecœur d’éclairer la lanterne de Bayard, et tous deux constituent dès lors une équipe d’enquêteurs insolites. Laurent Binet s’amuse, et le lecteur se régale.
Petit aparté ici à l’adresse de tous ceux qui, de la même génération que moi, ont parcouru les couloirs de Censier ou de la Sorbonne dans cette décennie, voire dans mon cas, un tantinet plus tôt : la description du souk paraît réelle, bien que Binet soit à peine né à cette époque.
Le tandem Bayard Herzog entreprend de démêler les arcanes des mystères entrevus quand il se retrouve rapidement victime d’adversaires improbables : Laurent Binet prend le lecteur à témoin pour signaler la-voiture-noire-que-suit-la-voiture-bleue, qui suivent toutes deux nos détectives. La satire cède la place au polar déjanté, qui nous mènera de Paris à Venise en passant par Bologne— Pas de bol, juste au moment où une bombe fait exploser la gare— l’université Cornell à Ithaca (USA) où nous suivons un véritable vaudeville « typically 70’s « : l’auteur met en scène de véritables personnalités (entre autres : Searle, Derrida, Althusser, Sollers et Kristeva, et même… Jakobson en personne !) dans des situations plus loufoques les unes que les autres. Et puis, pourquoi se priver quand on donne dans le baroque et le mélange des genres, voici l’intrigue catapultée dans le genre-société secrète façon Da Vinci, le Logos Club, dont les membres, entichés de dialectique sont prêts à y laisser leurs phalanges, voire plus…
Vous l’aurez compris, les péripéties s’enchaînent sans relâches, l’écriture de Laurent Binet vous emporte avec brio et une facilité déconcertante dans cet univers fantaisiste, avec son lot de rebondissements étonnants et percutants agrémentés d’allusions très fines… Quand arrive le dénouement, nous restons suspendu à un « C’était donc ça ? Et si c’était possible… »
Un conseil, si un week-end morose se profile, n’hésitez pas, procurez vous cette septième fonction du langage, le monde vous paraîtra plus drôle, dans tous les sens du terme.
Outre le Prix Interallié, La septième fonction du langage a été distingué également par le prix du Roman FNAC.
À titre d’illustration du style Binet, rien de mieux que les mots de l’auteur :
Bien sûr, on peut y voir un polar sémiologique, un roman pop, une farce rocambolesque, une satire… Un délire proche du surréalisme. À propos, mon premier émoi littéraire, à 17 ans, avait été la lecture d'un roman de Desnos, La liberté ou l'amour! La septième fonction du langage, c'est également l'occasion d'évoquer et de réfléchir sur le rôle du langage et de la communication verbale. D'ailleurs, j'adore le mélange des genres. Et puis, le roman est par excellence le genre du mélange des genres. La sémiologie, c'est la science de Sherlock Holmes: les signes y sont des indices. Ce que j'aime, c'est faire se rencontrer des personnages réels avec des personnages de fiction. ( Laurent Binet au Figaro le 1er septembre 2015)
La septième fonction du langage
Laurent Binet
Grasset (Août 2015)
ISBN: 978-2-246-77601-7
18:46 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : laurent binet, la septième fonction du langage, roman, satire, polar déjanté, sémiologie, linguistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/02/2016
Virtuoso ostinato
Amateurs d’histoires amples et chaleureuses, de couleurs et de paysages dessinés à la plume, les romans de Philippe Carrese vous attendent. Ce virtuose obstiné l’est, assurément, dans l’accomplissement de son destin musical qui suppose de s’arracher à la glaise épaisse de San Catello. Nous sommes en 1911, au fin fond de la campagne lombarde. C’est là que vivent Volturno Belonore et ses fils, qu’il exploite sans vergogne. La vie est âpre dans ce village montagnard, les journées consacrées au travail des champs. Les villageois forment une communauté resserrée sur elle-même, organisée autour des traditions et des stratifications héritées d’âges immémoriaux. Seule la musique que le Père Steinegger, le curé du village, essaie de transmettre tant bien que mal grâce aux cantiques dominicaux, ouvre un horizon différent aux jeunes voix de la paroisse. Des trois fils de Volturno, c’est le cadet Marzio qui impressionne le prêtre par la justesse de sa voix. Très vite, il permet à l’enfant de s’exercer sur l’harmonium de la paroisse, ce qu’accepte Volturno, à condition que les répétitions aient lieu le soir, toutes besognes familiales accomplies. Veuf de la mère des trois garçons, Volturno a épousé en seconde noce Ofelia, la plus jolie femme du village, beaucoup plus jeune que lui. Ofelia est si belle que tous les hommes en sont plus ou moins amoureux. N’empêche, Ofelia se montre très sage, sous la houlette de l’acariâtre belle-mère, elle assume les tâches d’une mère de famille nombreuse, puisqu’en plus des 3 beaux-fils, elle élève Vittoria sa petite fille. Mais à mesure que Marzio grandit, la complicité qui rapproche Ofelia de son beau-fils devient de plus en plus tendre. Dans cette petite communauté, cette situation peut se révéler explosive.
D ‘autant que les villageois ne manquent pas de se préoccuper de la soudaine passion de Volturno pour « sa mine ». Le paysan s’est mis en tête de trouver un filon de minerai prometteur de fortune, et il n’épargne plus sa peine pour retourner le champ des Frêles, risquant dans cette entreprise sa fortune… Et la vie de ses fils.
L’arrivée d’un musicien charmeur achève de faire voler en éclats l’ordonnance de cette microsociété. De drame en drame, la tragédie bouleverse San Catello, au point de ne plus faire de différence entre les morts, les meurtres, les accidents. C’est un souffle épique que Philippe Carrese maîtrise parfaitement. L’écrivain, par ailleurs scénariste et dessinateur, dresse un portrait formidable de la montagne Piémontaise, paysages humides et froids de l’hiver, âpreté de la vie paysanne au début du XXe siècle, aspirations à la tendresse des âmes tendres…
Dans ce récit construit en puzzle, le lecteur sait très vite que Marzio a échappé à la malédiction des Belonore, mais à quel prix ? Rien n’est achevé cependant quand vous refermez les presque 400 pages du roman… Reste à espérer que Philippe Carrese nous livre rapidement une suite.
Virtuoso ostinato
Philippe Carrese
L’aube (mai 2015)
ISBN : 978-2-8159-1207-5
18:41 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe carrese, virtuoso ostinato, roman, fresque campagnarde |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/06/2015
1Q84
Haruki Murakami
Traduction Hélène Morita
Ed 10/18 (Belfond)
ISBN : 978-2-264-05788-4
Sage stratégie de lectrice avertie, avant « d’attaquer » l’univers 1Q84, j’ai attendu la parution simultanée de la trilogie. Pourquoi en effet se soumettre à la torture de l’attente, quand, à l’évidence, il sera difficile aux lecteurs engagés dans cette histoire de patienter entre deux volumes ? Il me semble que j’ai bien fait tant, apparemment, le découpage en 3 tomes ne correspond qu’à une répartition de pagination. Il s’agit bien d’une histoire avec son unité de temps, un printemps, un été, un automne.
Premier volume donc : le printemps, d’Avril à Juin. Nous sommes à Tokyo, sur un périphérique embouteillé, une voie expresse qui ne l’est pas… Une jeune femme aux intentions mystérieuses est installée dans un taxi dont le chauffeur n’est pas moins intrigant. Ce jour-là, Aomamé a programmé sa journée très minutieusement, elle suit un plan réfléchi jusque dans les moindres détails, y compris vestimentaires. Un premier flottement se produit quand elle identifie un morceau de musique classique, pourtant peu familier, alors qu’il est diffusé sans annonce sur l’autoradio. La diversion semble anodine et Aomamé se concentre à nouveau sur l’objectif qu’elle s’est fixé et pour lequel elle s’est méticuleusement préparée. Les embouteillages menaçant l’équilibre de son horaire, elle accepte la proposition tout à fait inhabituelle du chauffeur de taxi, qui l’invite à quitter sa voiture et la voie expresse en empruntant un escalier de secours qui relie le périphérique aux voies urbaines.
Sans transition, c’est maintenant Tengo, un jeune professeur de mathématiques, écrivain à ses heures perdues, que nous rencontrons. Il a rendez-vous avec un éditeur, qui joue plus ou moins le rôle de mentor, en se servant à l’occasion de la perspicacité du jeune homme pour découvrir ou améliorer les textes d’autres écrivains. Tengo a ainsi repéré un manuscrit original parmi quelques œuvres de candidats à un concours ouvert aux auteurs débutants. L’œuvre présentée est intéressante, mais nécessite une sérieuse révision dans sa forme pour avoir la moindre chance d’être remarquée, on connaît la chanson… Et Tengo se laisse convaincre de contribuer à l’amélioration du roman…
D’entrée de jeu, les deux personnages dont nous allons alternativement suivre les péripéties viennent de franchir insidieusement une frontière subtile hors de leurs pratiques habituelles. Chacun d’entre eux poursuit ses activités, suivant une ordonnance qu’ils ont mis en place avec soin. Haruki Murakami prend le temps de développer les portraits de ses protagonistes : après des enfances malheureuses, ces deux trentenaires actifs, loups solitaires sans attaches familiales, sans amours durables, se sont dotés d’une ligne de conduite rigoureuse, dépourvue de désir de reconnaissance. Ils sont cependant également animés du besoin vital d’autonomie. Hormis ces points communs, le lecteur ne décèle pas le moindre lien qui pourrait rapprocher Tengo et Aomamé, pendant la majeure partie de ce premier volume. Tout juste un souvenir d’école, fugace et secondaire, et les fines mouches lancées à la poursuite des pages se disent : « tiens, tiens » …
Parce que Murakami est un romancier habile. Il sait comment distiller les indices et les pistes qui lui permettront de mener par le bout du doigt ses lecteurs tourneur de pages. Tengo entre en contact avec la délicieuse Fukaéri, l’auteur de la fameuse Chrysalide de l’air qui accepte sans réserve que le jeune homme reprenne l’écriture de son roman. Fukaéri possède une personnalité énigmatique, et compte tenu de sa jeunesse, Tengo a rencontré son tuteur. C’est ainsi que pour la première fois, il entend parler de la secte très fermée constituée par ceux qui se nomment eux-mêmes les Précurseurs. Ainsi, il est possible que l’imagination de Fukaéri ait pu se développer dans un contexte particulier.
De son côté, Aomamé rompt parfois sa solitude grâce aux invites pressantes d’une vieille dame richissime, à qui elle prodigue ses soins. Aomamé a plusieurs cordes à son arc sportif, elle enseigne les techniques de self-défense et pratique des exercices de détente musculaire auprès desquels mes séances de stretching hebdomadaires s’apparentent à de vulgaires siestes. Cette vieille Dame très (in) digne et son garde du corps offrent ainsi des oasis de bienveillance à la jeune femme, d’autant qu’un pacte occulte les unit.
Les intrigues sont en place, d’autres personnages secondaires donnent relief et vie au quotidien des protagonistes. La construction en alternance des deux histoires ne procurent pas de rupture du climax, tant nous sommes certains que ces deux-là vont bien finir par se rencontrer. Mais bon, arrivé en butée à la page 548, bien malin qui peut deviner comment, pourquoi, quel événement particulier déterminera la rencontre d’Aomamé et de Tengo.
Reste à ouvrir le livre second…
 1Q84 Livre 2 (Juillet-Septembre)
1Q84 Livre 2 (Juillet-Septembre)
Haruki Murakami
Traduction Hélène Morita
Ed 10/18 (Belfond)
ISBN : 978-2-264-05789-1
Tout naturellement, nous retrouvons Aomamé confrontée aux graves événements qui se sont déroulés dans la Safe-house où la vieille dame offre refuge aux femmes victimes des violences sexuelles. Suite donc des aventures de la jeune femme, sans rupture dans la forme et le fond par rapport au premier livre. Souvenez-vous que nous avions laissé notre héroïne en proie à quelques doutes concernant sa raison. Aomamé a pris conscience de phénomènes étranges qui malmènent ses repères. Outre cette seconde lune apparue dans le ciel, les références à des faits historiques totalement occultés comme les répressions meurtrières contre les Précurseurs qui entrent ainsi dans la conscience de la jeune femme, voilà qu’elle apprend l’assassinat de Ayumi, la jeune policière dont elle se sentait si proche malgré leurs statuts différents. La tension se fait extrême pour elle quand elle apprend la disparition de la petite Tsubasa, protégée par la vieille dame après les tortures sexuelles qu’elle a manifestement subies. Consciente du choix crucial et de ses conséquences, Aomamé accepte une ultime « mission » confiée par sa marraine improvisée. Difficile d’en dévoiler davantage sans déflorer l’intérêt de cette suite qui repose à ce niveau sur le suspense. Sachez néanmoins qu’Aomamé rencontrera le Leader des Précurseurs. Deux chapitres tendus sont consacrés à ce tournant de l’histoire. Le destin d’Aomamé bascule, elle oscille entre aspiration mortifère et pulsion vitale. Alors que tout paraît écrit, le souvenir de Tengo se fait tellement pressant. Parallèlement, Aomamé est maintenant détentrice du lien entre le Leader et les fameux Little People, secret dont elle mesure la gravité. C’est aussi par hasard qu’elle est amenée à lire le livre de Fukaéri, ignorant bien sûr le rôle qu’a joué Tengo dans sa réalisation. Pour le coup, le lecteur n’est pas fâché d’accéder enfin à la teneur du roman dans le roman !
En ce qui concerne Tengo, les événements se sont également compliqués. Qu’advient-il à sa maîtresse plus âgée ? Comment gérer la cohabitation avec une jeune fille presque mutique ? Fukaéri est-elle médium ? Son récit révèle-t-il une réalité invisible, mais indiscutable ? Tengo rejette les propositions malsaines du trouble Ushikawa, mais l’irruption de cet homme de paille accentue la certitude du danger encouru par Fukaéri. Enfin contraint de revoir son père dont la santé se dégrade, Tengo peut réviser ses peurs et ses traumatismes d’enfance. Alors que nous progressons inexorablement vers la fin du deuxième tiers de récit, Haruki Murakami ménage un rebondissement inattendu. Tengo le mathématicien n’échappe pas à l’univers fantastique de l’année 1Q84…
L’alternance des récits étant acquise, les deux univers de Tengo et Aomamé poursuivent leurs voies parallèles. Même si le lecteur a bien perçu que ces deux-là se connaissent et aspirent à se retrouver, comme un idéal qui donne sens à leur vie, Murakami joue adroitement des rebondissements, repoussant toujours plus loin leur possible rencontre…
Toujours sous-tendu par l’alternance des chapitres consacrés à chacun des personnages principaux, l’été de l’année 1Q84 n’a rien perdu en rythme et en intensité dramatique. L’intrigue s’oriente de plus en plus vers la prégnance du surnaturel. Mais le lecteur peut se sentir désappointé par le dernier rebondissement consacrée à Aomamé. Le lecteur malmené ne peut que se jeter sur le troisième volume.
 1Q84 Livre 3 (Octobre-Décembre)
1Q84 Livre 3 (Octobre-Décembre)
Haruki Murakami
Traduction Hélène Morita
Ed 10/18 (Belfond)
ISBN : 978-2-264-05926-0
Ce troisième et dernier volume présente une rupture concernant l’alternance à laquelle Haruki Murakami nous avait habitués, avec l’irruption de chapitres consacrés au mauvais génie de l’affaire, le sulfureux Ushikawa. Ce personnage à la moralité douteuse s’est manifesté au cours du second volume, inquiétant Tengo par son attitude intrusive, après le succès remporté par la Chrysalide de l’air. Ce personnage secondaire monte d’un cran dans l’échelon des protagonistes, travaillant ouvertement pour les Précurseurs, le voilà furetant et intrigant sur la mystérieuse jeune femme que l’on a vue chez le Leader, au soir d’un orage aux conséquences étranges.
Il est intéressant de noter l’astuce de l’auteur, qui bouscule l’architecture de son récit en éclatant la bipolarité du récit Tengo-Aomamé. Puisque Ushikawa détient désormais le ressort dramatique essentiel, l’ordonnance du récit sera tripartite. Ce qui permet au lecteur de suivre avec effroi les avancées de l’enquêteur, aussi retors que son physique est difforme. Les rapports du romancier aux portraits de ses créatures me paraissent ici intéressants : l’apparence d’Ushikawa est symbolique de son mental pervers, mais ses difformités n’empêchent pas la fulgurance de ses intuitions, et la persévérance de ses objectifs. À ce portrait inquiétant Murakami oppose la légèreté aérienne, la transparence de Fukaéri, le « bon ange » de Tengo, sylphide et sibylle, dont la présence rassure alors qu’elle est, aux sens propre et figuré, la matrice des ennuis du jeune homme.
À ce stade, si vous êtes engagés dans la lecture de la trilogie, il vous faut quitter d’urgence les notes de lecture glanées ici et là. Profitez à votre rythme des aléas qui attendent les protagonistes, filez de pages en pages vers la résolution des énigmes, les attentes d’Aomamé sur son balcon et les errements de Tengo sous la clarté des deux lunes…
Mais s’il vous reste à la fin une impression d’inachèvement, le sentiment que l’on passe à côté de la substantifique moelle poétique en germe dans cet univers parallèle, je vous rejoins pleinement. Ce troisième tome refermé, qu’advient-il de Fukaéri, de Komatsu, de notre vieille Dame et de son fidèle Tamaru? De quel monde l’enfant d’Aomamé va-t-il hériter?
Ce pourrait être une manière subtile pour un auteur reconnu par ailleurs de faire naître un désir chez ses lecteurs. Mais il me semble que Haruki Murakami est passé à autre chose, se délestant d’une histoire qui a dû empiéter sur une bonne tranche de sa vie. Reste quelques réserves d’une autre nature concernant la rédaction ou la traduction de ce roman fleuve : à la manière des feuilletonistes du XIXème siècle, bien obligés de résumer de temps à autre les détours de leurs intrigues à tiroirs, Murakami donne parfois l’impression de penser que son lecteur a besoin de rappels ou d’explications qui paraissent bien superflus. Ce sont des maladresses qui embourbent la fluidité du récit, aux tonalités par ailleurs plus subtiles. Curieux paradoxe pour un ouvrage qui a essaimé autour du monde et connaît un succès universel.
18:03 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : 1q84, haruki murakami, littérature japonaise, roman, science fiction, fantastique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
29/03/2015
La route de Beit Zera
J’avais conservé un excellent souvenir d’un repas en hiver, un des précédents romans d’Hubert Mingarelli. Aussi n’ai-je pas hésité très longtemps avant de me saisir de celui-ci. Et chose rare, ma bonne impression se confirme. Il me semble même que ce livre est encore meilleur.
Stépan vit seul dans une maison isolée, quelque part sous le lac de Tibériade. Pour rejoindre la route qui mène à la prochaine ville, Beit Zera, il faut traverser à pied une forêt. Stépan est un solitaire, mais il a une chienne, à laquelle il est très attaché. Quand s’ouvre le roman, la chienne est à l’agonie, l’homme sait qu’il va devoir affronter sa disparition… Cette étape n’est pas la première séparation à laquelle il doit faire face. Progressivement, le récit nous permet de remonter dans l’histoire de cette solitude installée, qui, comme toutes les retraites, s’est imposée plus qu’elle n’a été choisie.
« Il n’avait pas fini sa cigarette. Elle n’était pas bonne et apaisante comme il l’avait espéré, mais il la gardait encore, car après elle, il ne savait pas ce qu’il ferait. Il fumait et il tendait l’oreille. Malgré le soleil rasant, il jetait des regards vers la forêt. À présent, il redoutait de voir le garçon arriver. Même si c’était chose rare le matin. Sa décision prise et son chagrin à l’intérieur de lui, il voulait rester seul. » (Page 14)
Stépan a un fils qui vit au loin, en Nouvelle-Zélande. Chaque nuit, il écrit à Yankel, dont l’absence pèse si lourd. Stépan survit grâce aux boîtes de carton dont son ami Samuelson lui confie le montage, l’assurant ainsi d’un petit revenu tout juste suffisant. Les deux hommes sont très proches depuis que leur amitié est neé au cours de l’interminable service militaire israélien. Amitié rude fondée sur la rémanence des souvenirs, entretenue par les longues soirées passées à boire sous la véranda de la maison. Les deux hommes n’ont pas de secrets l’un pour l’autre, sauf… Sauf que depuis quelque temps, un jeune garçon lui rend souvent visite, à la tombée de la nuit. Cet adolescent quasi mutique a noué une affection avec la vieille chienne, qu’il caresse longuement et emmène en balade dans la forêt. Sans trop savoir pourquoi, Stépan l’a encouragé à s’occuper ainsi de la chienne. Car Amghar, le garçon, est manifestement arabe. De plus, de soir en soir, Stépan apprend qu’il vient à pied de Beit Zera, la ville de l’autre côté de la forêt, ce qui représente un périple dangereux dans ce pays en conflit toujours larvé.
Avant l’action dont on le devine tout à fait capable, c’est la vie intérieure de Stépan qui est mise en lumière tout au long du roman. L’homme se projette avant de faire, ce qu’il vit intérieurement compense l’isolement vécu comme un emprisonnement, même si cette punition paraît volontaire.
« Amghar s’en alla. La chienne grimpa les marches et vint se coucher près du fauteuil. Pour la première fois depuis longtemps, Stépan refit en pensée le trajet jusqu’à Beit Zera. Cela lui prit du temps, même en pensée, car il devait s’arrêter à certains endroits de la forêt, sa mémoire le trompait et il n’était plus sûr de lui. Mais une fois sorti de la forêt et traversé le champ de terre, se dressait la prise d’eau en béton surmonté de tuiles, et passant devant, la route nationale. Tout au bout, Beit Zera lui apparut. Il la vit, éclairée au loin, et ce n’est pas l’imagination qui lui manqua pour y aller, mais le courage. » ( Page 54-55)
Pourquoi Stépan est-il si mal à l’aise avec ce garçon, alors qu’on verra qu’il s’inquiète pour lui ? Pourquoi Yankel est-il si loin ? Pourquoi la route de Beit Zera fait-elle si peur à Stépan, y compris pour Amghar ?
Hubert Mingarelli dévoile progressivement, par toutes petites touches, les événements qui ont participé à l’isolement de Stépan et à une culpabilité insoluble dans l’oubli. Roman à l’écriture sensible et poétique, la fatigue de l’homme comme celle de sa chienne, le dépouillement extrême des rapports humains soulignent le lien charnel à son fils, un attachement si fort qu’il en devient irraisonné. Les images sont belles et fortes, en particulier celles qui se déroulent dans la forêt où Yankel a trouvé refuge. C’est aussi dans cette forêt que Stépan part à la recherche d’Amghar un soir d’orage. Subtilement, cet étrange garçon devient le fils d’Hassan Gabai, la victime de Yankel, et nous sommes au fait du traumatisme qu’éprouvent les hommes, paralysés par la peur au point de tuer par erreur, de tuer par fantasme de l’ennemi.
« Finissant sa cigarette, il songea pour la millième fois que si Dieu avait existé, Il n’aurait pas fait des nuits pareilles. Il aurait toujours laissé briller quelque chose de plus fiable que la lune, qui ne sert à rien quand le ciel est si couvert. Pour la millième fois il mesura combien cette chose avait manqué à Yankel la nuit où, dix longues années auparavant , il était revenu à la maison pour sa première permission, et où après avoir laissé les lumières de Beit Zera derrière lui, il allait sur la route au-devant d’Hassan Gabai qui rentrait aussi chez lui. » ( Page 62)
J’ai aimé la manière dont Hubert Mingarelli avance par touches délicates pour dresser la situation de son personnage central, un homme apparemment fruste. Progressivement, Mingarelli nimbe ses créatures de tendresse et de sensibilité. Peur, amitié, solidarité et culpabilité habitent ses protagonistes, tous victimes d’un état de fait qui les a toujours dépassés. L’écriture de l’auteur se dépouille d’effets, suit au plus près les gestes quotidiens qui traduisent au mieux le désarroi de l’absence, la difficulté de la décision, la méfiance instinctive de l’Autre.
Mais au bout du voyage intérieur de son personnage, Hubert Mingarelli nous offre une image à la fois déchirante et apaisante des liens de tendresse entre un homme et la chienne malade, belle et sombre métaphore pour rappeler qu'on n'aime pas sans mal, qu'on ne vit pas en ignorant la mort.
Un beau roman, vraiment.
La route de Beit Zera
Hubert Mingarelli
Stock 2015-03-25
ISBN : 978-2-234-07810-9
18:53 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la route de beit zera, hubert mingarelli, stock, peur de l'autre, littérature française, roman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/08/2014
Une part de ciel
Claudie Gallay n’a décidément rien perdu du talent qui lui permet de mouler ses personnages par la seule force des mots. Dès l’incipit du roman, la narratrice prend vie à travers l’écriture d’un récit en forme de journal où elle note les conditions de son retour dans la vallée de son enfance. Carole retrouve son frère Philippe et sa sœur Gaby, qui n’ont jamais quitté la région. En ces premiers jours de décembre, Carole ne sait pas encore quelle sera la durée de son séjour, mais le motif de son voyage apparaît rapidement telle une convocation quasi immanente de leur père. Celui-ci s’est fait une spécialité d’adresser à sa famille des boules de verre contenant paysages et flocons de neige artificiels en guise d’avertissement de ses passages prochains. Ces messages impérieux autant qu’imprécis agissent toujours sur la fratrie, assignation à une attente inquiète nourrie de souvenirs et d’espoirs…
Le fond des préoccupations de Carole s’épanouit sur cette vacuité forcée aux cours de l’expectative sans limites provoquée par l’envoi du vieil homme. La narratrice retrouve dans cette vallée retirée les connaissances qui ont accompagné sa vie jusqu’à son départ pour d’autres horizons. Entre-temps, Carole s’est mariée, est devenue professeur de cuisine dans un lycée professionnel en même temps que traductrice pour un éditeur de Saint -Étienne. Mais son compagnon— qu’elle nomme toujours le père des filles— l’a quittée et celles-ci, devenues adultes, viennent de partir aussi pour de lointaines expériences. Le cœur de Carole est vide et lourd, disponible pour la nostalgie et l’introspection.
J’aime l’art de Claudie Gallay qui sait dessiner avec vigueur des personnages entiers, sincères et durs : Les trois membres de la fratrie, aux destins bien différents, mais aussi moult personnages secondaires dont les silhouettes peuplent avec vraisemblance les paysages brumeux et pluvieux de la montagne industrieuse. Les états d’âme de ses personnages permettent de développer tout à tour bien des aspects de la vie, conférant une valeur universelle aux cas particuliers décrits. Il est question avec finesse de l’avenir de cette vallée, entre respect des activités traditionnelles et pulsion d’ouverture à une économie touristique, mirages de profits et de dynamisme social. Au plan personnel et affectif, ce retour aux sources peut-il réchauffer les cendres du passé ? Que propose Jean, ami d’enfance et premier amour avec ses multiples attentions ? Que dit cette chasse aux clichés de l’attente et des ombres qui couvent dans les non-dits des habitants de la vallée ?
Le nœud de l’affaire se pressent dans le rapport de Philippe et de Carole à Gaby, la benjamine. Elle est des trois celle qui semble la plus perdue, celle qui fait toujours les mauvais choix, celle que la vie n’aime pas. À la manière du Petit Poucet, Claudie Gallay sème tout au long des lignes du roman des éléments de souvenirs qui peu à peu s’organisent comme les pièces du puzzle de Diego, le restaurateur. Dans le passé, la famille a vécu un terrible drame, l’incendie de leur maison, au cours duquel leur mère, figure tutélaire détenant le pouvoir idéalisé d’aimer, a dû choisir… Et ce choix, forcé ou non, a inscrit de manière indélébile l’avenir de chacun.
Tout est là, cette responsabilité que nous portons à notre égard comme à celui des êtres que nous aimons : Nos parts d’ombre et de lumière, nos élans et nos obstacles, nos pulsions de vie et nos désirs de mort. Les touches de peinture que posent les mots de l’auteur révèlent les drames intimes et les réparations fragiles. La surprise, en toute analyse, apparaît justement dans le secret des forces accumulées dans l’adversité. Qui s’en sort le mieux ? Qui vit au plus près de sa nature profonde ?
La réussite de ce roman tient pour partie au contexte social et économique que Claudie Gallay excelle à bâtir. Elle est également une fine observatrice de la nature dont elle sait transmettre la beauté quotidienne, celle qu’on ne voit plus à force d’y vivre, autant que la grandeur quand les circonstances deviennent inhabituelles ou dangereuses. Elle développe surtout une manière d’écrire au ras de l’âme des personnages, donnant à chacun le ton exact qui l’habille de vérité. Je tiens une part de ciel pour une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines et j’ai plaisir à partager mon admiration pour cette écrivaine. Puissiez-vous y trouver le même contentement…
Une part de ciel
Claudie Gallay
Actes Sud (août 2013)
ISBN : 978-2-330-02264-8
16:39 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, roman, claudie gallay, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
11/07/2014
Nous étions les Mulvaney
Au moment du choix de ce roman, il faut se fier au titre. L’usage de l’imparfait est en soi un indice sémantique pertinent. Tenir compte aussi de l’univers de l’auteur : chez Joyce Carol Oates, pas d’angélisme ni d’optimisme béat. De l’optimisme pourtant, Corinne Mulvaney n’en manque pas, cette mère de famille ne ménage pas sa peine pour transmettre à ses quatre enfants sa foi et son énergie. Et contrairement à d’autres de ses créatures, il me semble que l’auteur a ressenti une sympathie, voire une véritable tendresse pour ces Mulvaney.
Ce sont les six membres d’une famille américaine que l’on suit sur deux décennies, des années 70 au début 90. Les deux époux, Michaël et Corinne viennent d’horizons très différents : Michaël, en rupture familiale dès son jeune âge, devient le prototype du self made man, après avoir connu une jeunesse aventureuse. Jusqu’au jour où il rencontre une curieuse jeune femme rousse et maladroite, qui compense sa beauté discrète par le charme plus durable d’une nature profondément cocasse. Michaël évoluera en durcissant ses ambitions, exigeant avec lui-même comme avec chaque membre de son entourage. Il prospère en fondant sa société et gravit un à un tous les échelons du code social. Corinne incarne l’autre versant : dynamique et un rien brouillonne, elle gère la vie à la maison, c’est- à- dire High Point Farm, la ferme où cohabitent enfants et animaux. Cette ferme représente l’univers parfait pour Corinne, issue d’une famille de fermiers d’origine allemande, dont elle a hérité foi religieuse et volonté de travail. Indéfectible soutien de son mari qu’elle aimera jusqu’au bout, Corinne détonne pourtant à ses côtés par son originalité vestimentaire. Mais elle est moulée elle aussi par le rêve américain, fixée sur l’objectif de mener une famille « parfaite », où chacun exécute tâches domestiques et fonctions sociales.
L’ascension des Mulvaney est longue et belle, jusqu’au jour où Michaël est enfin intronisé membre du club le plus en vue de Mont Ephraim, la ville proche de High Point Farm. Mais l’aîné, Mike junior, commence à décrocher, abandon de sa carrière sportive, et nuits trop arrosées. Son cadet, Patrick, se construit une carapace d’intellectuel arrogant et rebelle. Marianne répond à la fierté de ses parents, adolescente entourée d’amies, elle irradie et incarne toute la réussite paternelle. Quant à Judd, le benjamin, il grandit imprégné d’admiration infantile pour chacun de ses aînés.
La fêlure échappe à tous pourtant, ce lendemain du bal de la Saint Valentin 1976, où Marianne, comble d’honneur, était invitée. Curieusement, ni Patrick à qui il est demandé d’aller rechercher sa sœur et qui ne s’inquiète pas de son mutisme, ni sa propre mère Corinne, que les succès scolaires et amicaux de sa fille éblouissent, encore moins le père tellement occupé qu’il rentre de plus en plus tard… Personne ne perçoit le malaise patent de Marianne.
Aussi quand éclate enfin le scandale, les réactions des uns et des autres nous prennent au dépourvu. La culpabilité docile, la soumission de Marianne convient en apparence à Corinne et l’on reste stupéfait devant cette soudaine pruderie. La colère de Michaël père est violente, douloureuse, et dans un premier temps, on se dit qu’il a raison : allez régler ses comptes directement chez le « salaud ». Mais… Mais la pression est forte, Marianne tellement repliée sur sa » faute » —poids de la pratique religieuse. Par le regard de Judd, de Patrick dit Pinch, nous suivons alors la métamorphose du rêve en cauchemar.
Joyce Carol Oates poursuit sans concession la dissection méticuleuse des verrous sociaux et culturels. Son analyse acérée se teinte cette fois de tendresse pour Marianne et Corinne. Son empathie lui permet de démontrer comment chacune se débat dans le désastre. La force de l’amour de Corinne pour Michaël est saisissante, et l’on reste sidéré par le parti pris à l’égard des enfants, de la jeune fille en particulier. La construction du roman emprunte parfois la narration personnelle, à travers les points de vue différenciés de Judd ou de Patrick, pour mieux considérer comment ces enfants issus d’un clan fusionnel vont s’approprier leur propre destinée, hors Mulvaney. L’arrachement au formatage familial pour chacun des quatre rejetons est sinueux, difficile, douloureux, « une vie en patchwork « selon le reproche à peine déguisé de Corinne à sa fille.
Et même si l’on se dit qu’on est en train d’observer une famille campagnarde américaine sous la loupe d’une écrivaine de là-bas, difficile de ne pas frémir en reconnaissant sous les mots de Joyce Carol Oates les ferments du qu’en dira-t-on universel, la violence de l’ambition, la versatilité des sentiments, la révolte face à l’injustice. Le monde décrit par l’auteur est dur, mais il appartient à chacun de s’y construire en choisissant ses valeurs, telle serait la morale finale de cette saga captivante.
Nous étions les Mulvaney
Joyce Carol Oates
Paru aux USA :1996
En France chez Stock en 1998
Edition le livre de Poche, 2011
ISBN : 978-2-253-15750-2
19:43 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, roman, littérature américaine, joyce carol oates, critique socila, note de lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
10/06/2014
Le collier rouge
Le collier rouge
Jean-Christophe Rufin
Gallimard (NRF) 2014
ISBN :978-2-07-013797-8
Avec ce roman, qui pourrait paraître court, Jean Christophe Ruffin revient à la fiction. En réalité, malgré la limpidité de son écriture, le sujet traité ici est dense. Si l’on peut se méfier de l’effet tendance qui consiste à projeter les intrigues sur le centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale, Jean Christophe Rufin nous entraîne très vite à la recherche de la Vérité, celle qui ne s’expose pas aux regards de témoins omniscients mais qui motive profondément certains actes aussi impulsifs qu’insensés. Cette quête universelle et intemporelle est menée ici par le juge militaire Hugues Lantier du Grez , qui entend résoudre sa dernière affaire en tant qu’officier, avant de réintégrer la vie civile. C’est dire que sa conscience professionnelle est composée de rigueur et de respect des valeurs de sa classe, autant que d’une lassitude morale, maladie contractée à force d’examiner les dossiers de pauvres diables ayant subi l’enfer des tranchées pendant quatre longues années.
Au cours de l’été 1919, le Commandant Lantier débarque donc dans une petite bourgade berrichonne endormie sous la chaleur. Seuls les aboiements désespérés d’un chien perturbent la léthargie de la petite ville. À l’intérieur de la caserne désaffectée, un gardien veille l’unique prisonnier du lieu. Cet homme mutique doit répondre d’une agression inexplicable dont la nature ne nous sera révélée que bien plus tard. Mais la curiosité du juge militaire concerne le curieux rapports établis entre Morlac, ce paysan taiseux revenu dans sa région, et son chien manifestant une fidélité exemplaire. Pourquoi et comment cet animal, devenu tout au long du conflit la mascotte des bataillons où son maître était envoyé, a-t-il pu susciter sa haine? Pourquoi cet homme est-il revenu de son propre chef dans son village, en évitant de rentrer chez lui, de retrouver sa ferme, de se jeter dans les bras de sa femme et de son fils ?
Menée comme une intrigue policière, la recherche des motifs de l’étrange comportement du prisonnier met l’accent sur les difficultés de réinsertion de ces hommes traumatisés par leur vécu. Rufin ne joue pas la carte du misérabilisme ni de la culpabilité sociale et politique, mais laisse percevoir à travers l’obstination du juge, combien il devient nécessaire de gratter délicatement les défenses acquises par ces hommes qui ont compris qu’ils avaient été floués, qu ’on avait joué de leurs vies et de leurs sorts pour servir des intérêts abscons.
Rufin nous offre un étonnant argumentaire du juge, qui propose à l’homme d’abandonner les charges, ce que l’accusé récuse. Il n’entend pas se dérober à la sentence qu’il croit mériter. Car le commandant découvre peu à peu que l’accusé n’est pas le paysan analphabète qu’il avait cru devoir juger. Et puis ce chien qui se tient obstinément aux abords de la place, qui meurt de faim, de soif et d’épuisement malgré les soins empathiques de certains villageois, ce fidèle compagnon devient un personnage à part entière et Lantier devine que le canidé détient la clé de l’affaire. Finalement, après bien des détours autour du personnage, c’est au long d’une enquête « à la Maigret », reposant sur les menues confidences recueillies dans le village, que l’officier parvient à saisir qui est Morlac, et quels sont les vraies raisons de ses agissements. Le lecteur n’attend pas de Jean-Christophe Rufin une autre vision que celle d’un humaniste. Et ce sera la toute dernière joute reposant la sentence qu’il confie à son juge. « En tous cas, conclut Lantier d’une voix ferme, je ne serai pas complice de votre provocation. Puisqu’on attend de moi que je vous punisse, je sais quel châtiment je vais vous infliger. C’est celui qui fera le plus de mal à votre orgueil. Vous allez la voir et l’entendre. L’entendre jusqu’au bout et mesurer votre erreur. « (page 149)
Un beau roman humaniste et touchant, un de ceux que l’on regrette de refermer, et qui ne pèsera pas lourd dans vos bagages de l’été.
12:12 Publié dans goutte à goutte, Livre, Source de jouvence | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, notes de lectures, roman, jean christophe rufin, fidélité, roman sur la guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer