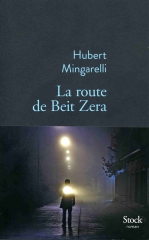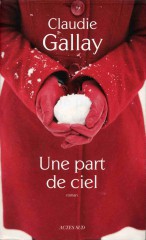13/06/2016
Je me souviens de tous vos rêves
Le dernier opus de René Frégni appartient à cette catégorie des livres- conversations qui sont autant d’invites à la résonance de nos propres émotions. Ce sont les deux derniers chapitres qui révèlent les intentions réelles qui sous-tendent les précédentes confidences :
Page 145 : « J’aurais voulu faire un livre sur le silence, remplir ce cahier de silence, dessiner des mots de plus en plus silencieux, comme on entre dans l’eau des rêves.
Je n’ai jamais ressenti, à travers les saisons de ma vie, un tel besoin de silence. Dans ce cahier, j’ai voulu parler d’un libraire, de mon chat, de quelques hommes perdus, parler de la lumière des collines, du visage d’Isabelle, de la douceur des chemins les après-midi d’automne, de cette petite table où j’invente la tendresse, en écoutant derrière la vitre les voyages du vent. »
Aucun éditeur n’aurait pu résumer en « quatrième de couve » de meilleure incitation à découvrir les mots de René Frégni.
Certains d’entre vous connaissez déjà cet écrivain méridional pour ses romans noirs, récits durs inspirés de ses propres expériences: Les chemins noirs, Où se perdent les hommes, Lettre à mes tueurs, Sous la ville rouge. Mais il ne faudrait pas ignorer le René Frégni conteur philosophe, l’homme poète qui, comme Christian Bobin, sait s’extasier et partager la lumière d’un rayon de soleil déchirant la brume, l’argent des oliviers frémissant dans le vent, la présence charismatique d’un chat réchauffant votre solitude… Après la fiancée des corbeaux, tel est cet ouvrage au titre percutant, Je me souviens de tous vos rêves.
Parce que René Frégni est un humaniste, un écrivain puisant à la source des autres, ainsi qu’en témoigne son récit d’amitié avec Joël Gattefossé, le libraire génial de Banon qui a inventé un village-librairie… Le chapitre qui lui est consacré est des plus émouvants, et l’on se prend à refaire le monde, abolir les horribles règles comptables et les banquiers incultes qui ruinent les rêves des grands enfants.
Mais quel que soit le sujet abordé, parmi toutes ces anecdotes qui pourraient appartenir à chacun d’entre nous, lecteurs du dimanche ou dévoreurs du soir, se niche toujours la petite remarque qui touche le cœur et l’esprit, qui nous conduit à une réflexion inattendue et aussitôt reconnue pour sa justesse. Ainsi, quand il évoque le cimetière où reposent ses parents, page 97 :
« En faisant le tour pour remettre ces fleurs debout, j’ai vu que la mairie avait agrandi le cimetière, c’est plutôt bon signe, preuve que le village, lui, ne meurt pas. »
Je me réjouis donc de rencontrer à nouveau demain chez ma libraire Catherine cet écrivain généreux et inventif, qui confesse aimer l’écriture comme « un combat de chaque mot entre contrainte et liberté. Rien n’est plus érotique que l’écriture », ( page 117).
Et si « le ciel est bien trop petit aujourd’hui pour contenir tous les nuages » (page 102), les pages de ce livre nous offrent bien plus encore en partageant avec nous les rêves d’un homme assagi que l’amour d’une mère disparue émeut encore au coeur de ses nuits :
« J’ai été réveillé par les pleurs de ma mère au fond de ma poitrine, comme elle recevait dans la sienne, jadis, la secousse des miens. (…)
Je ne choisis pas mes rêves, ils m’apportent ce qui me manque le plus. ( Page 149)
Je me souviens de tous vos rêves
René Frégni
Gallimard (la blanche) nrf Janvier 2016
ISBN : 978-2-07-010704-9
19:31 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : s rêves, récit, lecture, poésie, confidences, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
29/03/2015
La route de Beit Zera
J’avais conservé un excellent souvenir d’un repas en hiver, un des précédents romans d’Hubert Mingarelli. Aussi n’ai-je pas hésité très longtemps avant de me saisir de celui-ci. Et chose rare, ma bonne impression se confirme. Il me semble même que ce livre est encore meilleur.
Stépan vit seul dans une maison isolée, quelque part sous le lac de Tibériade. Pour rejoindre la route qui mène à la prochaine ville, Beit Zera, il faut traverser à pied une forêt. Stépan est un solitaire, mais il a une chienne, à laquelle il est très attaché. Quand s’ouvre le roman, la chienne est à l’agonie, l’homme sait qu’il va devoir affronter sa disparition… Cette étape n’est pas la première séparation à laquelle il doit faire face. Progressivement, le récit nous permet de remonter dans l’histoire de cette solitude installée, qui, comme toutes les retraites, s’est imposée plus qu’elle n’a été choisie.
« Il n’avait pas fini sa cigarette. Elle n’était pas bonne et apaisante comme il l’avait espéré, mais il la gardait encore, car après elle, il ne savait pas ce qu’il ferait. Il fumait et il tendait l’oreille. Malgré le soleil rasant, il jetait des regards vers la forêt. À présent, il redoutait de voir le garçon arriver. Même si c’était chose rare le matin. Sa décision prise et son chagrin à l’intérieur de lui, il voulait rester seul. » (Page 14)
Stépan a un fils qui vit au loin, en Nouvelle-Zélande. Chaque nuit, il écrit à Yankel, dont l’absence pèse si lourd. Stépan survit grâce aux boîtes de carton dont son ami Samuelson lui confie le montage, l’assurant ainsi d’un petit revenu tout juste suffisant. Les deux hommes sont très proches depuis que leur amitié est neé au cours de l’interminable service militaire israélien. Amitié rude fondée sur la rémanence des souvenirs, entretenue par les longues soirées passées à boire sous la véranda de la maison. Les deux hommes n’ont pas de secrets l’un pour l’autre, sauf… Sauf que depuis quelque temps, un jeune garçon lui rend souvent visite, à la tombée de la nuit. Cet adolescent quasi mutique a noué une affection avec la vieille chienne, qu’il caresse longuement et emmène en balade dans la forêt. Sans trop savoir pourquoi, Stépan l’a encouragé à s’occuper ainsi de la chienne. Car Amghar, le garçon, est manifestement arabe. De plus, de soir en soir, Stépan apprend qu’il vient à pied de Beit Zera, la ville de l’autre côté de la forêt, ce qui représente un périple dangereux dans ce pays en conflit toujours larvé.
Avant l’action dont on le devine tout à fait capable, c’est la vie intérieure de Stépan qui est mise en lumière tout au long du roman. L’homme se projette avant de faire, ce qu’il vit intérieurement compense l’isolement vécu comme un emprisonnement, même si cette punition paraît volontaire.
« Amghar s’en alla. La chienne grimpa les marches et vint se coucher près du fauteuil. Pour la première fois depuis longtemps, Stépan refit en pensée le trajet jusqu’à Beit Zera. Cela lui prit du temps, même en pensée, car il devait s’arrêter à certains endroits de la forêt, sa mémoire le trompait et il n’était plus sûr de lui. Mais une fois sorti de la forêt et traversé le champ de terre, se dressait la prise d’eau en béton surmonté de tuiles, et passant devant, la route nationale. Tout au bout, Beit Zera lui apparut. Il la vit, éclairée au loin, et ce n’est pas l’imagination qui lui manqua pour y aller, mais le courage. » ( Page 54-55)
Pourquoi Stépan est-il si mal à l’aise avec ce garçon, alors qu’on verra qu’il s’inquiète pour lui ? Pourquoi Yankel est-il si loin ? Pourquoi la route de Beit Zera fait-elle si peur à Stépan, y compris pour Amghar ?
Hubert Mingarelli dévoile progressivement, par toutes petites touches, les événements qui ont participé à l’isolement de Stépan et à une culpabilité insoluble dans l’oubli. Roman à l’écriture sensible et poétique, la fatigue de l’homme comme celle de sa chienne, le dépouillement extrême des rapports humains soulignent le lien charnel à son fils, un attachement si fort qu’il en devient irraisonné. Les images sont belles et fortes, en particulier celles qui se déroulent dans la forêt où Yankel a trouvé refuge. C’est aussi dans cette forêt que Stépan part à la recherche d’Amghar un soir d’orage. Subtilement, cet étrange garçon devient le fils d’Hassan Gabai, la victime de Yankel, et nous sommes au fait du traumatisme qu’éprouvent les hommes, paralysés par la peur au point de tuer par erreur, de tuer par fantasme de l’ennemi.
« Finissant sa cigarette, il songea pour la millième fois que si Dieu avait existé, Il n’aurait pas fait des nuits pareilles. Il aurait toujours laissé briller quelque chose de plus fiable que la lune, qui ne sert à rien quand le ciel est si couvert. Pour la millième fois il mesura combien cette chose avait manqué à Yankel la nuit où, dix longues années auparavant , il était revenu à la maison pour sa première permission, et où après avoir laissé les lumières de Beit Zera derrière lui, il allait sur la route au-devant d’Hassan Gabai qui rentrait aussi chez lui. » ( Page 62)
J’ai aimé la manière dont Hubert Mingarelli avance par touches délicates pour dresser la situation de son personnage central, un homme apparemment fruste. Progressivement, Mingarelli nimbe ses créatures de tendresse et de sensibilité. Peur, amitié, solidarité et culpabilité habitent ses protagonistes, tous victimes d’un état de fait qui les a toujours dépassés. L’écriture de l’auteur se dépouille d’effets, suit au plus près les gestes quotidiens qui traduisent au mieux le désarroi de l’absence, la difficulté de la décision, la méfiance instinctive de l’Autre.
Mais au bout du voyage intérieur de son personnage, Hubert Mingarelli nous offre une image à la fois déchirante et apaisante des liens de tendresse entre un homme et la chienne malade, belle et sombre métaphore pour rappeler qu'on n'aime pas sans mal, qu'on ne vit pas en ignorant la mort.
Un beau roman, vraiment.
La route de Beit Zera
Hubert Mingarelli
Stock 2015-03-25
ISBN : 978-2-234-07810-9
18:53 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la route de beit zera, hubert mingarelli, stock, peur de l'autre, littérature française, roman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/08/2014
Une part de ciel
Claudie Gallay n’a décidément rien perdu du talent qui lui permet de mouler ses personnages par la seule force des mots. Dès l’incipit du roman, la narratrice prend vie à travers l’écriture d’un récit en forme de journal où elle note les conditions de son retour dans la vallée de son enfance. Carole retrouve son frère Philippe et sa sœur Gaby, qui n’ont jamais quitté la région. En ces premiers jours de décembre, Carole ne sait pas encore quelle sera la durée de son séjour, mais le motif de son voyage apparaît rapidement telle une convocation quasi immanente de leur père. Celui-ci s’est fait une spécialité d’adresser à sa famille des boules de verre contenant paysages et flocons de neige artificiels en guise d’avertissement de ses passages prochains. Ces messages impérieux autant qu’imprécis agissent toujours sur la fratrie, assignation à une attente inquiète nourrie de souvenirs et d’espoirs…
Le fond des préoccupations de Carole s’épanouit sur cette vacuité forcée aux cours de l’expectative sans limites provoquée par l’envoi du vieil homme. La narratrice retrouve dans cette vallée retirée les connaissances qui ont accompagné sa vie jusqu’à son départ pour d’autres horizons. Entre-temps, Carole s’est mariée, est devenue professeur de cuisine dans un lycée professionnel en même temps que traductrice pour un éditeur de Saint -Étienne. Mais son compagnon— qu’elle nomme toujours le père des filles— l’a quittée et celles-ci, devenues adultes, viennent de partir aussi pour de lointaines expériences. Le cœur de Carole est vide et lourd, disponible pour la nostalgie et l’introspection.
J’aime l’art de Claudie Gallay qui sait dessiner avec vigueur des personnages entiers, sincères et durs : Les trois membres de la fratrie, aux destins bien différents, mais aussi moult personnages secondaires dont les silhouettes peuplent avec vraisemblance les paysages brumeux et pluvieux de la montagne industrieuse. Les états d’âme de ses personnages permettent de développer tout à tour bien des aspects de la vie, conférant une valeur universelle aux cas particuliers décrits. Il est question avec finesse de l’avenir de cette vallée, entre respect des activités traditionnelles et pulsion d’ouverture à une économie touristique, mirages de profits et de dynamisme social. Au plan personnel et affectif, ce retour aux sources peut-il réchauffer les cendres du passé ? Que propose Jean, ami d’enfance et premier amour avec ses multiples attentions ? Que dit cette chasse aux clichés de l’attente et des ombres qui couvent dans les non-dits des habitants de la vallée ?
Le nœud de l’affaire se pressent dans le rapport de Philippe et de Carole à Gaby, la benjamine. Elle est des trois celle qui semble la plus perdue, celle qui fait toujours les mauvais choix, celle que la vie n’aime pas. À la manière du Petit Poucet, Claudie Gallay sème tout au long des lignes du roman des éléments de souvenirs qui peu à peu s’organisent comme les pièces du puzzle de Diego, le restaurateur. Dans le passé, la famille a vécu un terrible drame, l’incendie de leur maison, au cours duquel leur mère, figure tutélaire détenant le pouvoir idéalisé d’aimer, a dû choisir… Et ce choix, forcé ou non, a inscrit de manière indélébile l’avenir de chacun.
Tout est là, cette responsabilité que nous portons à notre égard comme à celui des êtres que nous aimons : Nos parts d’ombre et de lumière, nos élans et nos obstacles, nos pulsions de vie et nos désirs de mort. Les touches de peinture que posent les mots de l’auteur révèlent les drames intimes et les réparations fragiles. La surprise, en toute analyse, apparaît justement dans le secret des forces accumulées dans l’adversité. Qui s’en sort le mieux ? Qui vit au plus près de sa nature profonde ?
La réussite de ce roman tient pour partie au contexte social et économique que Claudie Gallay excelle à bâtir. Elle est également une fine observatrice de la nature dont elle sait transmettre la beauté quotidienne, celle qu’on ne voit plus à force d’y vivre, autant que la grandeur quand les circonstances deviennent inhabituelles ou dangereuses. Elle développe surtout une manière d’écrire au ras de l’âme des personnages, donnant à chacun le ton exact qui l’habille de vérité. Je tiens une part de ciel pour une de mes meilleures lectures de ces dernières semaines et j’ai plaisir à partager mon admiration pour cette écrivaine. Puissiez-vous y trouver le même contentement…
Une part de ciel
Claudie Gallay
Actes Sud (août 2013)
ISBN : 978-2-330-02264-8
16:39 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, roman, claudie gallay, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer