Ulysse from Bagdad
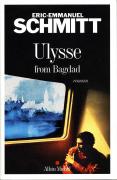
Auteur : Éric Emmanuel Schmitt
Éditeur : Albin Michel
Année : Novembre 2008
« Je m’appelle Saad Saad, ce qui signifie en arabe Espoir Espoir et en anglais Triste Triste ; Au fil des semaines, parfois d’une heure à la suivante, voire dans l’explosion d’une seconde, ma vérité glisse de l’arabe à l’anglais ; selon que je me sens optimiste ou misérable, je deviens Saad l’Espoir ou Saad le Triste. »
Ainsi débute Ulysse from Bagdad, le dernier ouvrage d’Éric Emmanuel Schmitt, résumant de manière magistrale le bois dont est fait son personnage, mais aussi les destins entrecroisés des protagonistes du roman.
Est-il possible d’être léger et charmeur quand on développe le thème d’une des plus grandes tragédies humaines que ce début de siècle nous réserve ?
À la lecture de ce roman, le talent d’E E Schmitt endosse avec empathie les états d’âme de son narrateur, le jeune Saad Saad, dont le destin d’enfant heureux au sein d’une famille aimante bascule dans les affres d’un migrant « ordinaire », en route pour un Eldorado imaginaire. Saad Saad raconte son odyssée, et se raconte, à travers les démêlés des Irakiens, sous le joug du dictateur Saddam Hussein qui restreint les libertés d’opinion, sous l’embargo international qui prive le peuple du nécessaire, sous les attaques des soldats américains qui promettent faussement une ère nouvelle, sous les bombes aveugles des forcenés suicidaires qui refusent que règne enfin la Paix tellement attendue.
Élevé par un père humaniste, forgé par sa philosophie poétique qui transcende les difficultés matérielles et concrètes par des formules fleuries et un humour au second, voire au troisième degré, Saad se crée une relation au monde fondée sur l’identification émotionnelle :
Extrait page 58 à 61 :
« Un matin, en entamant ma toilette, je remarquai trois points sombres sous mes pieds, que je montrai aussitôt à mon père.
- Des verrues, fils.
- Je n’en ai jamais eu !
- Souvent, les verrues apparaissent après qu’on a conduit un mort en terre.
- Cela vient des cercueils ? Des cadavres ?
- Non.
- De toute façon, je n’ai accompagné personne en terre…
- Choc émotif, fils. J’usais d’une métaphore pour te suggérer que les verrues naissent des chagrins.
- Reçu cinq sur cinq ! Je suis traumatisé, c’est ça ?
- Les verrues sont des fleurs que les âmes tourmentées font éclore sous leur peau.
Attrapant mon pied d’une main, ajustant ses lunettes de l’autre, il examina les trois marguerites opaques.
- Il y a deux solutions pour les supprimer : soit tu enduis ta peau d’une décoction de citron dans du vinaigre blanc, soit tu les nommes.
- Je choisis le remède numéro un. Je ne vois pas comment je baptiserais mes verrues…
- Pourtant, ça marche aussi. J’avais un ami qui a trimballé une verrue pendant dix ans, une solide, une tenace, une persistante, dont aucun grattage, aucune potion ne venait à bout. Le jour où il l’a qualifié de Fatima, elle a disparu.
- Fatima ?
- Fatima, sa mère, une épouvantable mégère qui l’avait martyrisé sans qu’il l’avouât auparavant. Dès que tu repères le juste titre d’une verrue, celui qui explique son origine, tu l’effaces.
- Ça t’es déjà arrivé ?
- Oui.
Il rougit, diminua sa voix.
- J’ai développé une verrue pendant mes deux premières années de mariage avec ta mère.
- Tu as trouvé son intitulé ?
- Oui.
- Eh bien ?
- Saad, chair de ma chair, sang de mon sang, sueur des étoiles, me promets-tu le secret ?
- Sur ma tête.
- Ma verrue s’appelait Myriam. Une jeune fille que j’aurais souhaité épouser. Juste avant ta mère.
- Avant ?
Il devint écarlate et murmura en détournant les yeux :
-Presque.
Je reçus la confidence avec un sourire attendri puis commençai à réfléchir : comment mes verrues s’appelaient-elles ?
- Papa, les verrues portent-elles toujours des prénoms de femmes ?
- Les verrues d’hommes, souvent. Mais ne te focalise pas là-dessus : il y a aussi des verrues qui s’appellent Remords, Opium ou Double Scotch.
Je traînais donc trois verrues. Qu’exprimaient-elles ? J’avais l’embarras du choix, question tourments… Paix ? Bonheur ? Liberté ? Avenir ? Amour ? Enfants ? Études ? Travail ? À moi, tout désormais posait problème. Trop triste pour pratiquer l’introspection, je demandai à ma mère de me préparer la lotion au vinaigre citronné. (…) »
Saad Saad connaît son premier vrai chagrin quand un missile américain démolit par erreur la maison où demeure sa bien-aimée et la famille de celle-ci. Premier chavirement d’un monde jusqu’ici harmonieux malgré les vicissitudes générales. Ses sœurs perdent tour à tour leurs maris, victimes d’un attentat suicide sous les yeux du jeune homme, puis son père est à son tour abattu par les soldats américains, trop nerveux pour interpréter les appels à l’aide du brave homme. Saad s’appuie sur la distanciation spirituelle que lui transmet son père. Mais quand celui-ci devient à son tour la énième victime absurde du conflit, le malheur se mue en horreur pétrifiante. Secours naturel, la résilience et la solidarité familiale l’obligent à combattre le sort qui s’acharne : sa mère et ses sœurs comptent sur le seul homme qui reste dans la famille. Jusqu’au jour où une de ses nièces meurt d’une septicémie, faute d’accès aux soins. Les malheurs successifs forment une bulle qui enferme les humains jusqu’aux frontières de l’aberration : ce n’est pas la révolte personnelle qui pousse Saad à partir, c’est la nécessité, étayée par l’idée commune que là-bas, en Europe, la vie facile lui permettra de gagner l’argent indispensable pour offrir à ses parentes les soins impossibles à pourvoir en Irak.
En filigrane des épreuves, Saad dispose d’une aide morale et mentale extraordinaire. Ce n’est pas la foi religieuse, ni l’idéologie politique, encore moins le lyrisme né d’une Libération qui pousse le héros à agir. Comme sa mère, Saad reçoit la visite régulière de … son père, fantôme familier qui se manifeste de préférence à l’heure de la toilette, au cours de conversations fantaisistes. Ces échanges paternels, moments de drôlerie délicate, apportent au récit une bouffée d’humour et au personnage de Saad des éléments de réflexion des plus salutaires, quoique parfois un peu confus… C’est un peu la transformation des leçons que Pangloss déverse sur Candide…
Extrait page 115 à 117 :
« Comme j’avais enlevé mes chaussures pour conduire, mon père ne tarda pas à surgir sur le siège du passager et ronronna, émerveillé, en touchant les commandes de ses doigts épatés.
- J’adore ces voitures rustiques dotées de quatre roues motrices.
- Les quatre-quatre ?
- Comme tu dis. Avoue que tes amis les Lotophages ne sont pas beaux à voir, ce matin !
- Comment les appelles-tu ?
- Saad mon fils, chair de ma chair, sang de mon sang, sueur des étoiles, tu sais très bien qui sont les Lotophages car je t’ai lu plusieurs fois l’histoire dans ta jeunesse. Allons, souviens-toi. Tu me la demandais avidement tant tu l’aimais.
- Moi ?
- « Le dixième jour, Ulysse et ses compagnons abordèrent le pays des mangeurs de fleurs appelés Lotophages. Ces hommes dévorent du lotos au cours de leurs repas. Or quiconque en goûtait le fruit aussi doux que le miel, ne voulait plus rentrer chez lui ni donner de nouvelles mais s’obstinait à rester là, parmi les Lotophages, à se repaître du lotos, dans l’oubli du retour. »
- Ah oui, l’Odyssée…
- L’Odyssée, fils, le premier récit de voyage qui marque l’humanité. Un voyage écrit par un aveugle, Homère, ce qui prouve qu’on décrit mieux avec l’imagination qu’avec les yeux.
- Le lotos fait oublier le retour… Crois-tu que, toujours, la drogue fait oublier le but ?
- Parfois, elle obtient mieux encore, fils, : elle fait oublier qu’on n’a pas de but.
Je réfléchis pendant des kilomètres.
- Ce n’est pas pour moi, conclus-je, ni lotos, ni opium, ni cocaïne, ni une autre substance.
- Content de te l’entendre dire.
À ce moment-là, Hatim et Habib gémirent.
- Stoppe, fiston, ils sont en train de se chier dessus.
Je freinais et ouvris la porte arrière. Glissant hors du véhicule, ils rampèrent vers le fossé. Pendant qu’ils se vidaient, bruyants, mon père leva les yeux au ciel.
-Là, je dois avouer que c’est un des rares avantages de la condition d’outre-tombe : mort, on a la tripe tranquille. (…) »
Saad est convaincu de la nécessité de partir et d’affronter le vaste monde.
Comme il ne sait par où l’aborder, ce monde différent et forcément meilleur, il s’en remet d’abord aux extrémistes cause de son malheur… Expérience effrayante qu’il contourne en choisissant ensuite la voie des pilleurs de patrimoine, escrocs de petite envergure, mais grands consommateurs de drogue. Grâce ou malgré eux, le voilà largué au Caire, ville tentaculaire où il pourrait bien se perdre, si le hasard ne le mettait en présence d’ »un jeune noir aux yeux très larges » : Boubacar, qui a fui le Libéria et sa guerre civile interminable, lui sert de mentor.
Extrait page 154-155 :
« À minuit, je rejoignis Boub au squat, me glissai jusqu’à son matelas sans réveiller les autres Libériens. Dans la pénombre, je lui appris mon échec et mon désir de tracer la route.
- Nous voilà à égalité, Saad. Ils m’ont refusé le statut de réfugié.
- Quand ?
- L’an dernier. Je te l’avais caché pour ne pas te décourager.
- Quoi ? Toi aussi ? Ta famille exécutée sous tes yeux, les tortures physiques, ta bouche mutilée, ça ne…
- Ils prétendent que je n’ai aucune preuve écrite de ma naissance ni de ma nationalité.
- Autrement dit, ils t’accusent de mentir !
- Ça les arrange. Ils ne voient guère ce que l’Amérique pourrait gagner à héberger un Boubacar non qualifié, non diplômé.
Il se gratta la tête d’un doigt vigoureux, comme si cela l’aidait à en extraire les meilleures pensées.
- Tu sais, Saad, la dictature, au moins c’est clair, ça joue franc-jeu : on sait qu’il y a un pouvoir central, total, qui exerce son arbitraire en toute impunité. En Occident, c’est plus vicieux : pas de despote mais des administrations bloquées, des règlements plus longs que tous les annuaires téléphoniques, des lois concoctées par des êtres bien intentionnés. À l’arrivée ? Les mêmes réponses absurdes ! On ne te croit pas, tu ne comptes pas, ta vie n’a pas d’importance. Si tu es débarrassé du souci de plaire à un tyran, tu découvres que tu ne conviens pas au système : trop tard, pas conforme, manquant d’éléments officiels. Vous êtes né ? Non, puisque vous n’avez pas de certificat. Vous êtes libérien ? Prouvez-le, sinon, restez-le ! (…) »
Ensemble ils échafaudent des stratégies de survie, puis s’organisent pour « passer » la mer. L’art de l’auteur est de nous montrer la frayeur des clandestins face à l’immensité des flots, à l’inconfort extrême infligé aux passagers, et aussi la petitesse mentale des passeurs, aussi lâche que cyniques. Le monde est dur, observe l’auteur, et les hommes se servent les uns des autres, avec détermination mais sans plan d’envergure.
Extrait page 175 :
« Le voyage se poursuivit et nous pûmes mieux comprendre ce qui s’était sans doute passé. À mesure que nous avancions, nous apercevions des formes suspectes flottées sur l’eau ; si les premières purent êtres identifiés comme des chaussures, des valises, des vêtements, certains amas ressemblaient à des humains ; bientôt, il n’y eut plus moyen d’avoir des doutes : des cadavres de femmes, d’hommes, d’enfants voguaient autour de nous. Un bâtiment avait dû couler et envoyer son chargement à la noyade.
Sur notre esquif, les nuques se raidirent, quelques gémissements sortirent des gorges mais personne ne commenta. Le silence fut notre seule réaction. Peut-être avions nous l’espoir qu’en nous taisant, nous supprimerions ce qui gênait nos yeux, qu’en refusant de formuler l’épouvante en mots nous amoindririons sa portée, voire sa réalité ?
Comme s’il avait compris ce qui agitait nos esprits, notre marin avait relevé le menton, fier, hautain, déterminé. Désormais, il savait que la peur nous muselait, que nous ne discuterions plus ses ordres, qu’il serait, jusqu’à ce que nous posions le pied à terre, notre héros. (…) »
Saad-Ulysse poursuit son voyage et, après moult péripéties et nouveaux déchirements, il parvient enfin au rivage de la mer du Nord. Voyage risqué qu’Éric Emmanuel Schmitt construit avec sa recette mélangeant ainsi moments tragiques et émotionnels, truffant les épisodes dramatiques de bouffées humoristiques, offrant à son personnage des rencontres réconfortantes, des occasions de tisser un lien puissant, mais justement, Saad porte trop de malheurs pour se poser avant la résolution de son rêve, son obsession d’atteindre sa terre promise, l’Angleterre. Nous le retrouvons donc à Calais, face au bras de mer que tant d’êtres humains scrutent à la recherche du moyen de franchir ce dernier obstacle. Impossible de vous faire part de toutes les péripéties, il vous faut, à votre tour, plonger dans les trois cents pages de ce récit qui coule du cœur frais de Saad-l’espoir vers nos consciences de Nantis.
La voix de Saad, c’est d’abord celle d’un auteur sensible à ses frères humains. Après le magnifique mais dur Eldorado de Laurent Gaudé, il y a quelque deux ans je crois, voilà à nouveau abordé le thème des migrants, et de leur quête dans un contexte humaniste, humain, compatissant sans pathos, l’humour toujours à fleur d’émotion, contribue à étayer le message.
Publié dans Sources Vives | Lien permanent








































































































































