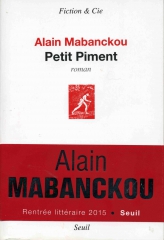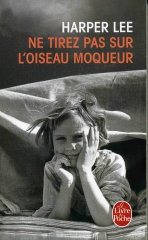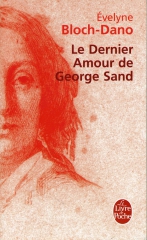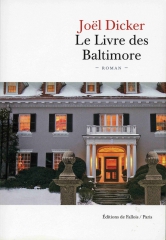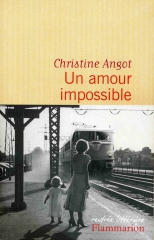14/02/2016
Virtuoso ostinato
Amateurs d’histoires amples et chaleureuses, de couleurs et de paysages dessinés à la plume, les romans de Philippe Carrese vous attendent. Ce virtuose obstiné l’est, assurément, dans l’accomplissement de son destin musical qui suppose de s’arracher à la glaise épaisse de San Catello. Nous sommes en 1911, au fin fond de la campagne lombarde. C’est là que vivent Volturno Belonore et ses fils, qu’il exploite sans vergogne. La vie est âpre dans ce village montagnard, les journées consacrées au travail des champs. Les villageois forment une communauté resserrée sur elle-même, organisée autour des traditions et des stratifications héritées d’âges immémoriaux. Seule la musique que le Père Steinegger, le curé du village, essaie de transmettre tant bien que mal grâce aux cantiques dominicaux, ouvre un horizon différent aux jeunes voix de la paroisse. Des trois fils de Volturno, c’est le cadet Marzio qui impressionne le prêtre par la justesse de sa voix. Très vite, il permet à l’enfant de s’exercer sur l’harmonium de la paroisse, ce qu’accepte Volturno, à condition que les répétitions aient lieu le soir, toutes besognes familiales accomplies. Veuf de la mère des trois garçons, Volturno a épousé en seconde noce Ofelia, la plus jolie femme du village, beaucoup plus jeune que lui. Ofelia est si belle que tous les hommes en sont plus ou moins amoureux. N’empêche, Ofelia se montre très sage, sous la houlette de l’acariâtre belle-mère, elle assume les tâches d’une mère de famille nombreuse, puisqu’en plus des 3 beaux-fils, elle élève Vittoria sa petite fille. Mais à mesure que Marzio grandit, la complicité qui rapproche Ofelia de son beau-fils devient de plus en plus tendre. Dans cette petite communauté, cette situation peut se révéler explosive.
D ‘autant que les villageois ne manquent pas de se préoccuper de la soudaine passion de Volturno pour « sa mine ». Le paysan s’est mis en tête de trouver un filon de minerai prometteur de fortune, et il n’épargne plus sa peine pour retourner le champ des Frêles, risquant dans cette entreprise sa fortune… Et la vie de ses fils.
L’arrivée d’un musicien charmeur achève de faire voler en éclats l’ordonnance de cette microsociété. De drame en drame, la tragédie bouleverse San Catello, au point de ne plus faire de différence entre les morts, les meurtres, les accidents. C’est un souffle épique que Philippe Carrese maîtrise parfaitement. L’écrivain, par ailleurs scénariste et dessinateur, dresse un portrait formidable de la montagne Piémontaise, paysages humides et froids de l’hiver, âpreté de la vie paysanne au début du XXe siècle, aspirations à la tendresse des âmes tendres…
Dans ce récit construit en puzzle, le lecteur sait très vite que Marzio a échappé à la malédiction des Belonore, mais à quel prix ? Rien n’est achevé cependant quand vous refermez les presque 400 pages du roman… Reste à espérer que Philippe Carrese nous livre rapidement une suite.
Virtuoso ostinato
Philippe Carrese
L’aube (mai 2015)
ISBN : 978-2-8159-1207-5
18:41 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philippe carrese, virtuoso ostinato, roman, fresque campagnarde |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
29/01/2016
Petit Piment
Petit Piment est le surnom que le narrateur s’est gagné à la suite d’un exploit fort risqué, en s’attaquant avec ruse et hardiesse aux jumeaux Songi-Songi et Tala-Tala, deux terreurs qui règnent dans l’orphelinat de Loango. Mais les rudesses des enfants entre eux ne sont rien en comparaison des sévices dus aux abus de pouvoir commis par le directeur de l’orphelinat, Dieudonné Ngoulmoumako. Entre autres méfaits, celui-ci a obtenu l’éviction de la seule personne capable de procurer aux enfants abandonnés du bonheur. Mais outre le fait d’aimer ces pensionnaires, Papa Moupelo avait le tort d’être un prêtre, que son caractère expansif ne pouvait pas protéger des aléas engendrés par les multiples remous politiques qui caractérisent l’Histoire de la République du Congo.
Quand il se persuade que personne ne viendra plus l’arracher aux sévices de Ngoulmoumako et ses sbires, Petit Piment s’enfuit de l’orphelinat en compagnie des fameux jumeaux, dont il intègre la bande. Les gamins se rendent à Pointe-Noire, capitale économique du Pays. Là, ils organisent leur survie comme peuvent le faire les enfants des rues dans toutes les villes du monde : racket, rapines, extorsions diverses et violences. Petit piment est malin, on l’a vu, il tire son épingle du jeu, véritable figure congolaise de Gavroche mâtinée de Huckleberry Finn.
La bonne fortune de Petit Piment arrive enfin le jour où il rencontre Maman Fiat 500 qui, avec ses dix filles de joie, lui offre une vraie famille. Petit Piment connaît une période de prospérité et de stabilité, il pense avoir trouvé sa place. Mais le sort, qui est sournois, en décide autrement. La politique et ses arrangements font voler en éclats le paradis. Comme jadis Papa Moupelo, Maman Fiat 500 disparaît. Et Petit Piment se retrouve à la rue, abandonné une nouvelle fois.
Celui dont le véritable nom de baptême était « Rendons grâce à Dieu, le Moïse noir est né sur la terre des ancêtres » s’emploie alors à traverser son désert affectif aiguillonné par une curieuse vision de sa vengeance. La vie jusqu’alors épique de Petit Piment s’englue dans le tragique, jusqu’à la pirouette finale.
Ce roman picaresque coule longtemps d’une voix amusante, où la malice l’emporte souvent sur la nostalgie. La verve d’Alain Mabanckou fait sourire, provoque des éclats de rire tant il sait user du ressort naïf pour dépeindre une réalité plutôt sordide. En donnant la parole à un enfant, l’écrivain évite de s’appesantir sur les brutalités, la corruption et les iniquités absurdes d’un pays en proie aux soubresauts de l’instabilité. Mais c’est toute la finesse du genre, qui donne à ses personnages la force des faibles, la fantaisie des vaincus d’avance qui n’ont rien à perdre. Rire pour ne pas pleurer en somme. En ce sens, il ne faut pas enfermer Mabanckou dans une idée « africaine « de la Littérature, même si sa langue et son style nous apportent une fraîcheur et une saveur bien particulières.
De toutes les questions que je me posais pendant cette période d'agitation intérieure qui marquait le début de ma crise d'adolescence, une seule revenait de jour comme de nuit et m'empêchait d'avaler ma salive comme si j'avais une arête dans la gorge: étais-je le seul "Tokumisa Nzambe po Mose yamoyindo abotami ya Bakoko" au monde? À la longueur de ce nom je pouvais répondre par l'affirmative et me réjouir d'être un gamin singulier. Or Papa Moupelo fréquentait d'autres orphelinats à Pointe-Noire, à Tchimbamba ou à Ngoyo. Je ne pouvais me retenir de nourrir des doutes sur l'originalité de ce patronyme. Une certaine jalousie m'habitait rien qu'à l'idée de savoir que je pourrais n'être qu'un Moïse parmi des centaines et des milliers d'autres et qu'ils étaient plus aimés que moi par Papa Moupelo.
Il était le seul à pouvoir me rassurer. Et comme nous étions au milieu de la semaine, j'avais hâte que le samedi arrive afin de lui poser ouvertement la question. Hélas, j'étais loin de penser qu'un fait inattendu allait chambouler le reste de notre existence dans ce coin perdu de la région du Kouilou. Je me serais attendu à tout, sauf à un tel retournement des choses.
Curieusement, et c'était cela qui m'alarmait le plus, Papa Moupelo non plus n'avait pas cu venir cet événement malgré sa proximité avec le ciel… ( Pages 20-21)
Petit Piment
Alain Mabanckou
Le Seuil (Août 2015)
ISBN :978-2-02-112509-2
18:21 Publié dans Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alain mabanckou, littérature francophone, petit piment, république du congo |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
25/01/2016
Va et poste une sentinelle
S’il est une erreur à éviter, c’est d’enchaîner la lecture de la deuxième œuvre publiée d’Harper Lee juste après avoir achevé Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. Erreur absolue que je vous conseille de ne pas commettre à votre tour, à double titre : protégez votre plaisir de lecture d’une éventuelle déception, et offrez à ce roman une chance de vous toucher.
Lire donc Va et poste une sentinelle sans essayer d’établir un lien chronologique entre les deux ouvrages. Difficile certes pour les lecteurs qui ont vraiment apprécié le premier titre paru. Ne pas se laisser influencer par la genèse de l’œuvre, qui nous présente celui-ci comme une ébauche.
Parmi les éléments qui vous surprendront sans doute, sachez que l’héroïne de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, devenue adulte, ne s’entend plus guère appelée Scout mais Jean Louise. Après ses études, la jeune femme s’est installée à New York et le roman débute alors qu’elle revient à Maycomb où elle pense se ressourcer quelques jours chez son père Atticus. Elle sait qu’elle retrouvera près de lui sa tante Alexandra qui l’agaçait déjà dans son enfance. D’entrée, le style est très différent, le charme de l’enfance envolé, certes, mais le ton si particulier du premier ouvrage, incisif, railleur et faussement naïf, tellement réjouissant, n’est plus. Ce n’est plus Scout qui raconte, le roman est écrit à la troisième personne, ce qui permet de réaliser paradoxalement l’intérêt d’un récit à la première personne, l’intimité immédiate que crée le processus entre le narrateur et son lecteur.
Les perspectives de Jean Louise sont partagées par ce retour à Maycomb. Elle guette les signes de faiblesse de son père qui vieillit physiquement, mais elle en attend rigueur intellectuelle et honnêteté morale qu’elle a toujours connues. Elle retrouve également sa complicité avec un nouveau venu pour nous, Henry Clinton, Hank pour les intimes, qu’Atticus considère comme son successeur potentiel depuis la mort de Jem. Car, et c’est un nouveau choc, nous apprenons que le frère aîné de Jean Louise est décédé brutalement. Henry Clinton, orphelin depuis son adolescence, a été aidé par Atticus et lui voue en retour une piété filiale. Ses rapports amoureux avec Jean Louise date de cette époque et nous pensons à Dill, second grand absent du roman. Nous sommes ainsi préparés à observer les changements survenus dans la petite bourgade.
Au-delà des éléments de ton, de style, le fond de l’intrigue majeure reste la manière dont l’héroïne va être conduite à grandir en se confrontant à la réalité. Jean Louise est désormais New Yorkaise, elle s’est habituée au mixage des visages, des habitudes, des micro-sociétés qui se côtoient dans la grande ville du Nord ; Nous sommes maintenant dans les années cinquante, mais l’Alabama est toujours enraciné dans sa mentalité du Sud et la jeune femme va devoir réapprendre un nouveau code comportemental. Certes, elle reste provocatrice et entière, mais elle a appris à composer avec sa tante, elle joue aussi au chat et à la souris avec Henry, réellement amoureux d’elle. Malgré elle, elle ne peut s’empêcher de se questionner au sujet d’un éventuel mariage avec l’ami d’enfance, le substitut de son frère disparu. Ce sont là des éléments d’incarnation du personnage qui ne manquent pas d’intérêts.
Mais ces questionnements personnels se retrouvent brutalement balayés par un événement qui prend la mesure d’un ouragan. Obéissant à sa curiosité, Jean Louise s’est glissé dans la salle du tribunal, comme autrefois pendant le fameux procès où Atticus avait tenté de défendre un noir injustement accusé de viol. Alors que dans le passé, son père avait revêtu les atours d’un archange défenseur du Droit, elle le surprend ce dimanche-là en pleine compromission avec des racistes notoires. Stupeur et accablement, Jean Louise est bouleversée. Son père serait-il devenu raciste, adepte des idées du Klan dont elle a trouvé un fascicule de propagande sur un guéridon du salon ? Tenaillée entre un amour inconditionnel pour la figure paternelle qui s’impose depuis son enfance comme un repère, et cette découverte qui l’horrifie, elle vit en deux journées sombres une véritable révolution —au sens géométrique du terme— qui la conduit à intégrer la nécessité des compromis. Son père perd son statut, son univers bascule, c’est encore une étape vers la maturité que doit gravir douloureusement l’ex petite Scout.
Roman donc de passage initiatique, Va et poste une sentinelle, expose la vision de l’auteur, elle-même femme de ce Sud ambivalent. Ce sont les thèmes centraux des deux ouvrages, bien que traités différemment. Si la réussite de l’Oiseau moqueur est incontestable, Va et poste une sentinelle souffre d’une facture plus didactique, d’une sensibilité moindre dans l’expression des états d’âme de l’héroïne, comme des personnages secondaires : Cet Henry Clinton, amoureux gentiment repoussé est trop placide, trop parfait. Les explications de l’oncle Jack, philosophe loufoque, tournent autour du pot et peuvent être lassantes malgré les anecdotes cocasses. Quant à Atticus, est-il aussi convaincant quand il laisse sa fille patauger et s’enferrer au lieu de mettre les points sur les i ? En un mot ce roman forgé de bonnes intentions paraît infiniment moins réussi que celui qu’Harper Lee publiera quelques années plus tard. Il reste néanmoins intéressant en ce qui concerne l’éclosion au monde adulte, aux vérités ambiguës et aux nécessaires compromissions.
Va et poste une sentinelle
Harper Lee
Grasset (Octobre 2015)
ISBN :978-2-246-85868-3
12:16 Publié dans Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harper lee, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, va et poste une sentinelle, littérature américaine, romans à thèmes, racisme, ségrégation, tolérance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
23/01/2016
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
On pourra toujours se demander pourquoi il a fallu tant de temps aux lecteurs français pour apprécier ce roman devenu immédiatement incontournable lors de sa parution aux USA en 1960. Voilà un livre qui se ferme à regret, et une héroïne, Scout, que l’on voudrait accompagner bien plus longtemps.
De ses cinq à ses huit ans, c’est à la hauteur du nez de cette fillette intrépide, résolue, et tenace que nous nous immergeons dans la vie d’une petite ville du Sud de l’Alabama. Vous allez découvrir Maycomb dans les années 30, bourgade isolée avec ses rues bordées de maisons coquettes, son centre-ville que l’on peut encore rejoindre à pied depuis le quartier bourgeois, son école unique et ses paroisses propres à chaque communauté. Scout est la benjamine, de son nom de baptême Jean Louise, élevée en compagnie de son frère Jem par leur père que les enfants nomment tous deux par son prénom, Atticus. La gouvernante-cuisinière-femme à tout faire, Calpurnia, est totalement dévouée aux enfants et à son patron. Atticus est un humaniste. Avocat, il professe la raison et la tolérance envers tous, et sème dans l’esprit des enfants des repères moraux et intellectuels censés les préparer à devenir des adultes accomplis. En attendant, Jem et Scout sont souvent livrés à eux-mêmes dans le jardin de la maison et dans le quartier tranquille qu’ils habitent. Tranquille ce quartier ? Pas si sûr ! La demeure voisine semble bien mystérieuse avec ses volets toujours clos et ses habitants invisibles. Et le sort de Boo Radley, le garçon de la maison préoccupe la fratrie, rejointe en été par Dill, un gamin du même âge qui passe ses vacances chez sa tante. Les trois compères imaginent diverses stratégies pour rencontrer Boo enfin et qui sait, le sauver d’une supposée séquestration… Harper Lee joue à merveille des mots et des expressions pour relever ce récit qui pourrait s’apparenter aux sagas enfantines dans la veine de Mark Twain, par son insolence et sa critique sous-jacente des conformismes. Sauf que Jem et Scout ne sont pas malheureux. Si la mère n’est plus, Calpurnia assume de son mieux les fonctions maternelles, même si elle cache sa tendresse sous des dehors rugueux, qui font fulminer Scout, mais qui se révèlent très vite indispensables au respect du cloisonnement naturel entre Blancs et Noirs. Harper Lee décrit l’enfance comme un territoire harmonieux, où les disputes se limitent à l’assaisonnement naturel des jours trop tranquilles.
Et puis un soir, Atticus éprouve le besoin de mettre ses enfants en garde. Dans les semaines à venir, ils vont entendre des rumeurs désagréables, ils seront même sans aucun doute chahutés par leurs camarades, ils vont devoir apprendre à se comporter selon les principes qu’il espère avoir inculqués. Commence une nouvelle année scolaire où Scout va grandir plus vite que les années précédentes. La calomnie, la distance, l’hostilité sournoise se font sentir… Des enfants du quartier défavorisé d’Old Sarum sont intégrés à l’école et les différences d’éducation révèlent des fractures dans l’équilibre de la société. Toutefois, Scout paraît souvent plus intéressée par ces failles que par le bavardage insipide des chipies habituelles. Progressivement, l’atmosphère de la petite ville s’est tendue, les menaces contre Atticus deviennent de plus en plus évidentes et ne peuvent plus être cachées aux enfants. Mais Scout peine à saisir la raison de ces changements, jusqu’à ce soir où, Atticus les pensant couchés, Jem et Jean Louise se relèvent et courent vers la ville, pour découvrir leur père assis sur une chaise en train de monter la garde devant la prison. Il est seul, héros solitaire d’un drame prêt à exploser. Heureusement, l’imprimeur local va prêter main-forte à l’avocat en mauvaise posture. Scout tourne et retourne la situation, ne comprenant pas qu’Atticus soit inquiété alors qu’il a été commis d’office à la défense de l’homme accusé de viol que certains citoyens de Maycomb aimeraient lyncher sans autre forme de procès. Le procès s’ouvre cependant le lendemain. Jem, Dill et Jean Louise doivent ruser pour assister, malgré l’interdit paternel, aux débats.
Sans changer de ton, Harper Lee parvient à donner au roman l’épaisseur d’une critique acérée contre le racisme, l’intolérance, la bêtise. Racontées par une enfant de huit ans, les situations apparaissent parfois terriblement cocasses, le rire éclate alors même que l’émotion et l’écoeurement prévalent. Toutes les pages consacrées aux audiences sont haletantes et je défis le lecteur de poser le livre. Mais le procès achevé, la défaite consommée, les choses n’en restent pas là parce qu’on est en Alabama, où la guerre de Sécession n’a jamais quitté les esprits. La dernière partie du livre nous tient toujours davantage en haleine et les surprises nous attendent jusqu’à l’ultime page.
C’est sans doute ce qui explique la désolation du lectorat d’Harper Lee, qui n’a rien publié de plus pendant des décennies. Silence pesant enfin rompu l’année dernière par l’édition de Va et poste une sentinelle, mais c’est une autre histoire, comme l’on verra bientôt.
En ce qui concerne Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, ce n’est pas l’auteur que je vais citer, mais Isabelle Hausser, qui a révisé la traduction du roman et achève ainsi la postface: « Le texte d’Harper Lee, d’une infinie drôlerie, est un enchantement. Il a la légèreté et le poids que recherche le véritable amateur de roman et cette vertu si rare de pouvoir être lu à tout âge, quelle que soit l’éducation que l’on a reçue, de quelque pays qu’on vienne, à quelque sexe que l’on appartienne. »
La longue absence d’Harper Lee sur la scène éditoriale a contribué à fonder sa légende. La jeune femme a trente-quatre ans lorsque sort le roman en 1960. L’ampleur du succès international immédiat, l’attribution du Pulitzer l’année suivante, le film qui en est tiré ( titre français du silence et des ombres) , sont autant d’occasions d’interprétation des éléments biographiques qui ont inspiré le fond et la forme de l’affaire. Son amitié avec Truman Capote attestée, l’auteur n’a jamais caché le rôle de son propre père dans la construction de la figure d’Atticus. La genèse du livre commence à être mieux connue, en particulier à la lumière du second ouvrage, bien différent. Mais chaque chose en son temps. Il est peu vraisemblable que Nelle Harper Lee, 90 ans en Avril prochain, cède à la tentation médiatique et se livre davantage…
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (To kill a mocking bird 1960 )
Harper Lee
Le livre de poche ( Grasset)
1ÈRE parution en France 1988 chez Grasset, réédité en 2015 en poche
ISBN : 978-2-253-11584-3
18:44 Publié dans Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, va et poste une sentinelle, harper lee, roman à thèmes, littérature américaine, racisme, ségrégation, tolérance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
28/12/2015
Le Dernier Amour de George Sand
Au rayon des biographies, la Bonne Dame de Nohant reste un sujet hors norme, auquel nombre d’ouvrages ont été consacrés. Par son parcours exceptionnel, Femme de Lettres renommée vivant de sa plume autant que par l’anticonformisme affiché de sa vie sentimentale, George Sand est une figure de notre paysage littéraire, un modèle de féminisme longtemps avant l’émergence du Mouvement, une icône du Romantisme autant que des fantasmes romanesques.
Pour avoir rencontré Évelyne Bloch Dano en septembre dernier lors de la fête du Livre, j’ai perçu la subtilité de cette écrivaine qui ne cherche en aucune façon à exploiter le caractère scandaleux d’une vie privée agitée. En se penchant ici sur le Dernier Amour de George Sand, c’est en témoin vigilant et en femme solidaire qu’Évelyne Bloch Dano expose les émois, la fraîcheur, les scrupules et les détresses d’une femme privilégiant la sincérité de ses sentiments contre ses intérêts.
Elle n’est déjà plus si jeune en 1849 quand elle reçoit à Nohant une petite assemblée d’invités pour partager les fêtes de fin d’année, comme de coutume. Cependant, Aurore a fêté ses quarante-cinq ans, son grand amour Frédéric Chopin est mort quelques mois auparavant, alors qu’ils étaient déjà séparés depuis deux ans. Il en reste un sentiment amer de gâchis et de brouille, exacerbé par la mésentente avec sa fille Solange. Heureusement, Maurice, son fils, reste son complice de toujours et c’est lui qui invite l’un de ses amis, Alexandre Manceau au « château » familial. Alexandre ne paye certainement pas de mine, il est d’origine très modeste, les réparties brillantes ne sont pas son fort. Pourtant, sa gentillesse, ses attentions et sa disponibilité lui permettent vite de devenir l’hôte indispensable. Maurice n’avait certes pas prévu que se tisse ainsi un lien intime entre l’ami de beuverie et sa mère. Il en est d’autant plus meurtri qu’il ne peut lui-même couper le cordon ombilical.
Mais assumant simultanément avec fierté et modestie sa maturité littéraire et ses convictions personnelles, George impose Alexandre à ses côtés, ménageant la susceptibilité de Maurice et l’ego de son jeune amant. Évelyne Bloch Dano raconte avec humanité les soirées à Nohant, les allers-retours entre la campagne et Paris, les souffrances de la rupture entre mère et fille, la joie et la résurrection de George accueillant sa petite-fille Jeanne Gabrielle, dite Nini comme elle avait elle-même été élevée par sa propre grand-mère. Pour autant, George ne lâche jamais sa plume, consacrant toutes ses nuits à l’écriture, et cette période sera féconde. Le répertoire théâtral comme le catalogue des romans sont considérablement enrichis, d’autant que George connaît quelques soucis pécuniaires, et que ce travail assidu permet de combler quelques trous, Maurice restant longtemps à la charge de sa mère. Évelyne Bloch Dano s’appuie sur la correspondance foisonnante qu’entretient George avec Hetzel son éditeur ainsi qu’avec ses nombreux amis, comme elle partisans farouches d’une société meilleure, opposant au coup d’État de Décembre 1848 par lequel Louis Napoléon Bonaparte est devenu Napoléon III.
Il faut souligner le travail d’archive rigoureux qui sous-tend le récit. L’auteur contextualise chaque épisode de la vie de son héroïne. Au point que l’ouvrage acquiert la précision d’un outil de recherche, qui éloignera inévitablement les seuls amateurs de narration anecdotique. Mais pour ravira les amoureux des Belles-Lettres et donne vie à l’un de nos plus fins écrivains.
Le dernier amour de George Sand
Évelyne Bloch-Dano
Éditeur Grasset 2010 Le livre de poche
ISBN : 978-2-253-16200-1
19:11 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : george sand, la bonne dame de nohant, biographie, Évelyne bloch dano |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
27/12/2015
Le Livre des Baltimore
Comme beaucoup de lecteurs du précédent opus, j’étais curieuse de découvrir le livre des Baltimore, roman inscrit dans le prolongement logique de la Vérité sur l’affaire Harry Quebert. La suite? Rien n’est moins avéré. Mais la récurrence du personnage central, narrateur omniscient et écrivain à succès de surcroît, établit sans contestation la cohérence d’un « univers » Marcus Goldman.
Une amie me faisait remarquer hier soir que ce roman ne semble pas « écrit ». Elle entendait par là qu’il lui semblait rédigé sans artifice, « comme ça vient, » au rythme de l’histoire qui se déroule. Rien n’est plus faux, évidemment. L’écriture de Joël Dicker, qui a été comparée à ses modèles d’outre-atlantique lors du succès précédant, est tout sauf « pas-écrite ». La construction de l’œuvre elle-même témoigne de l’agencement minutieux de l’intrigue, d’une analyse acérée des personnages, d’une recherche pointilleuse de l’environnement historique et contextuel des événements fictifs. Bref, du bon boulot d’écrivain, et vous pouvez ouvrir en confiance le roman. Ses 470 pages se liront sans pauses, vous emportant sans rechigner à la poursuite de cette nouvelle vérité cachée que le narrateur nomme le Drame.
D’entrée de jeu, Marcus Goldman ne cache pas que sa vie a connu un avant et un après le Drame. Le prologue s’ouvre le Dimanche 24 Novembre 2004, un mois avant le Drame. Et l’injonction qui achève ce bref chapitre vaut condamnation pour tout lecteur, derechef obligé d’obtempérer :
Si vous trouvez ce livre, s’il vous plaît, lisez-le.
Je voudrais que quelqu’un connaisse l’histoire des Goldman-de-Baltimore.
Une invite pressante à la découverte du destin d’une famille qui semble d’abord correspondre à l’image lisse et heureuse des Américains tels qu’ils sont célébrés dans les magazines à lire chez le coiffeur, héros d’une Amérique glorieuse qui offre argent, notoriété et bonheur à ceux qui « réussissent » — comprendre gagnent beaucoup d’argent. Tels les voit avec son cœur d’enfant le petit Marcus, le neveu héritier d’une branche moins argentée mais aussi méritante, les Goldman-de-Montclair.
À travers cinq livres (parties), Joël Dicker tresse peu à peu les faisceaux d’une histoire familiale, d’une saga comme on les aime, fixant les avers et les revers d’une famille aux prises avec les contraintes de la vraie vie.
Selon la structure chronologique rigoureuse établie par l’auteur, le livre de la jeunesse perdue dresse le portrait de ces deux branches d’une même famille. Les Goldman-de- Baltimore, Oncle Saul, tante Anita, Hillel et Woody ont tout bon, ils sont beaux, riches et généreux. « De toutes les familles que j’avais connues jusqu’alors, de toutes les personnes que j’avais pu rencontrer, ils m’étaient apparus comme supérieurs : plus heureux, plus accomplis, plus ambitieux, plus respectés. Longtemps, la vie allait me donner raison. (…) J’étais fasciné par la facilité avec laquelle ils traversaient la vie, ébloui par leur rayonnement, subjugué par leur aisance. J’admirais leur allure, leurs biens, leur position sociale. » ( Page 25). Et l’on comprend ainsi la focalisation de l’enfant Marcus sur un mode de vie sublimé par l’admiration ostensible des grands-parents, Max et Ruth :
« Dans la prononciation du lexique familial, mes grands-parents avaient fini par associer dans leurs intonations les sentiments privilégiés qu’ils éprouvaient pour la tribu des Baltimore : au sortir de leur bouche, le mot « Baltimore » semblait avoir été coulé dans de l’or, tandis que les « Montclair » était dessiné avec du jus de limaces. Les compliments étaient pour les Baltimore, les blâmes pour les Montclair. » ( Pages 28-29)
Marcus multiplie les séjours chez son oncle, d’autant qu’il s’entend à merveille avec son cousin Hillel, né la même année que lui. À toute lectrice au tempérament un peu famille, il semblera étonnant que les parents « Montclair « acceptent ce semi abandon du fiston. Joël Dicker distille dans la progression du récit quelques morceaux de puzzle qui laissent entendre combien les apparences cachent des réalités complexes. `
Au titre de ces réalités apparaît le thème de la jalousie : avouée immédiatement quand elle est provoquée par l’arrivée de Woody dans la famille « Baltimore ». Ce cousin opportunément intégré au clan arrange quand même tout le monde et donne bonne conscience aux parents adoptifs, dont l’image s’en trouve encore grandie.
Le livre de la fraternité perdue, montre les fissures que d’autres jalousies engendrent. Même dans le meilleur des mondes, les enfants grandissent, les sentiments et les ambitions évoluent, chaque frustration rentrée germe en silence dans les personnalités en devenir. La fragilité physique et psychologique d’Hillel, la brutalité à peine canalisée de Woody, les confrontations au monde extérieur à la tribu, autant d’éléments incontrôlables qui composent peu à peu un terrain miné. La fraternité partagée par les cousins est soumise au séisme des amours refoulées et des projections sociales.
L’histoire est-elle un éternel recommencement ? À la toute fin du roman, le merveilleux oncle Saul tente de soulager Marcus du poids du Drame :
— Arrête avec le Drame, Marcus. Il n’y a pas un Drame mais des drames. Le drame de ta tante, de tes cousins. Le drame de la vie. Il y a eu des drames, il y en aura d’autres et il faudra continuer à vivre malgré tout. (…) Ce qui compte, c’est la façon dont on parvient à les surmonter. ( Page 468)
Le lecteur connaît à ce moment du récit les raisons de cet engrenage terrible qui a anéanti la famille Baltimore. Engrenage dont la source est antérieure aux événements relatés dans les deux premières parties et que Joël Dicker ne livre qu’au milieu du roman, comme un joyau serti dans l’épaisseur des épisodes vécus par le narrateur. Il fallait en effet donner de la densité à l’origine du Mal, éclairer d’un jour nouveau la complexité des rapports Baltimore- Monclair par la relation de l’histoire aux grands-parents. Une histoire d’héritage moral en quelque sorte, où les apparences doivent être restaurées et respectées. Une histoire où se devinent les ruminations, les humiliations et les revanches, et dont chacun des protagonistes porte plus ou moins consciemment le poids.
Les deux derniers grand chapitres du Livre des Baltimore vont enfin exposer le Drame et la manière dont le narrateur va pouvoir sublimer l’épreuve. Ma première réserve concernant ce roman, que je trouve plutôt réussi, tient à cette happy end tout à fait romanesque entre le narrateur et Alexandra, personnage périphérique dont le caractère n’est pas négligeable. Néanmoins, fallait-il plomber la tension permanente du récit par cette péripétie à l’eau de rose ? Dicker me paraît moins doué pour la bluette que pour le suspense.
Décidément, je préfère retenir la conclusion qui rehausse les dernières lignes de l’épilogue :
Pourquoi j’écris ? Parce que les livres sont plus forts que la vie. Ils sont la plus belle des revanches. Ils sont les témoins de l’inviolable muraille de notre esprit, de l’imprenable forteresse de notre mémoire. ( Page 476)
Une très belle dernière page qui procure une réelle émotion.
Le livre des Baltimore
Joël Dicker
Éditions de Fallois /Paris
( Août 2015)
ISBN :978-2-87706-947-2
19:05 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : joel dicker, éditions de fallois, roman francophone, littérature contemporaine, suspense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
29/11/2015
D'après une histoire vraie
De ce roman intrigant, on peut tirer toutes les pelotes pour dévider les nombreux thèmes qui sont abordés, de front ou en filigrane. Il restera sans doute comme l’un des plus brillant de cette rentrée littéraire 2015; Il démontre de surcroît l’immense talent de Delphine de Vigan.
Pour tous les lecteurs de l’ouvrage précédent, Rien ne s’oppose à la nuit, D’après une histoire vraie peut accrocher comme la suite du roman. La narratrice porte le prénom de l’auteur, elle a écrit un livre intime fondé sur la vie et la mort de sa mère, en développant le contexte familial qui met en cause de nombreux membres de cette famille, elle évoque sans détour son compagnon que tout fan reconnaîtra sans hésitation. De nombreux éléments se réfèrent ainsi à ce que le lectorat habituel de Delphine de Vigan ne peut ignorer. Tel est donc le thème principal de ce récit : l’écrivaine mêle habilement réalité et fiction et construit une intrigue prenante qui fonctionne comme un thriller. De fait, ce livre se lit d’une traite. Le plus fort est que le lecteur se sent parfaitement manipulé mais est prêt à en redemander. Il peut même, ce lecteur, se sentir interpeller par l’auteur à travers les propos prêté à l’un des personnages : « voilà ce que le lecteur attend des romanciers : qu’ils mettent leurs tripes sur la table. L’écrivain doit mentionner sans relâche sa manière d’être au monde, son éducation, ses valeurs, il doit remettre sans cesse en question la façon dont il pratique la langue qui lui vient de ses parents (…) Il doit créer une langue qui lui est propre, aux inflexions singulières, une langue qui le relie à son passé, à son histoire. Une langue d’appartenance et d’affranchissement. L’écrivain n’a pas besoin de fabriquer des pantins, aussi agiles et fascinants soient-ils. Il a suffisamment à faire avec lui-même. « ( Page 188-189) Nous voilà au cœur du premier thème. Delphine, la narratrice, a été fragilisée par certaines réactions suscitées par son livre précédent, des lettres anonymes notamment, lourdes de reproches et de menaces confuses. Malgré sa volonté de résister, elle se sent minée d’autant qu’une nouvelle donne de sa vie, le départ des enfants hors du nid, conjugue la crise du parent abandonné aux questions récurrentes du sens de son art. Ces dilemmes superposés entraînent une réaction inattendue et redoutée par tout auteur : Delphine peine à entamer un nouvel ouvrage, elle est victime du syndrome de la page blanche.
C’est alors que Delphine rencontre une jeune femme, qui s’appellera simplement « L ». Comme ça se prononce. D’après une histoire vraie se présente alors comme un récit chronologique et méthodique de la prise de possession de L sur la vie de Delphine. En trois phases, évidemment, comme dans tous processus de manipulation. L est belle et intelligente, intuitive, compréhensive. Elle devient indispensable. Puis installée chez Delphine, mais assez habile pour ne jamais rencontrer de témoins, L devient intrusive et s’identifie de plus en plus à Delphine, au point de s’immiscer dans sa vie, elle en prend les rênes. Enfin, et je vous défie de reposer le livre à ce moment-là, la relation des deux femmes devient vénéneuse… Mais qui trahit qui ? Delphine elle-même n’est-elle pas partie prenante dans la déclaration de cette guerre larvée ?
Ainsi après la question de l’implication de l’auteur dans son œuvre vient la grande question de la manipulation. Deuxième pelote qui peut s’alimenter sans fin. Car si toute histoire est vraie durant le temps qu’elle est racontée, selon Rudyard Kipling, l’écrivaine joue à merveille des mille facettes du récit, effets de miroirs et tiroirs en cascade de poupées russes. Au point que dès la moitié du roman, on se pose la question de savoir si L existe vraiment… Et vous ne le saurez jamais.
« Quiconque a connu l’emprise mentale, cette prison invisible dont les règles sont incompréhensibles, quiconque a connu ce sentiment de ne plus pouvoir penser par soi-même, cet ultrason que l’on est seul à entendre et qui interfère dans toute réflexion, toute sensation, tout affect, quiconque a eu peur de devenir fou ou de l’être déjà, peut sans doute comprendre mon silence face à l’homme qui m’aimait.
C’était trop tard. » ( Page 325)
Sur une intrigue qui semble construite chronologiquement, se greffe un art consommé des retournements de situation, des rebondissements et des faux-semblants. On peut relire trois fois le roman, on ne trouvera pas la faille qui donne la clé. Mais vous serez sans cesse interpellés par toutes les bonnes et mauvaises raisons qui gouvernent nos affects : peur de la solitude, joie et angoisse de voir les enfants partir, sens de ses choix affectifs, mauvaise conscience et mensonge ordinaires, anodins avant que leur récurrence ne devienne poison. Delphine (la vraie et la fictionnelle) pose la question du risque d’exposition du créateur. Qui ne l’a ressenti ?
Un vrai bon roman qui ne se referme pas impunément, vous pouvez m’en croire…
D’après une histoire vraie
Delphine de Vigan
J C Lattès (août 2015)
ISBN :978-2-7096-4852-3
19:47 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : delphine de vigan, littérature contemporaine française, rentrée littéraire 2015, vérité ou fiction |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
16/11/2015
Un amour impossible
Dire que j’ai abordé ce livre avec ma curiosité coutumière serait mentir. Je m’étais bien promis de ne jamais choisir, de ne jamais privilégier cette auteure, au motif qu’elle est cataloguée depuis vingt ans dans les auteurs d’autofiction qui se racontent indéfiniment en étalant leurs vicissitudes les plus intimes sur la place publique, et que non, pour moi, la littérature, ça ne doit pas servir à régler ses propres comptes… Et puis s’arc-bouter sur ses positions, rester figée au garde à vous sur des règles auto édictées, ce n’est pas tenable dès lors que sont présentés des arguments intelligents qui invitent à « goûter avant de rejeter ». Catherine, ma libraire du jardin des Lettres, m’a justement engagée à revoir mes positions sur l’écriture de Christine Angot, me prêtant même son exemplaire personnel, c’est dire !
Et de fait, la lecture de ce roman- qui- n’en- est- pas- un m’a paru très facile et a vaincu rapidement mes préventions. En défilant chronologiquement et sans fioriture l’histoire de ses parents, Christine Angot parvient à dresser le portrait d’une femme simple, trop simple même pour ne pas paraître benête. Parce qu’elle tient tout le discours à hauteur de langage oral, le lecteur ne peut éviter de prendre parti pour Rachel, jeune provinciale qui découvre dans l’immédiat après-guerre les charmes et les risques d’une relation libre avec son amant. D’emblée, celui-ci hérite du mauvais rôle, mufle supérieur, beaucoup plus conformiste et calculateur que sa jeune amoureuse. Christine sait donc depuis toujours que son père a abandonné sa mère, même si la naïveté de celle-ci a enjolivé et occulté la relation au père.
Un beau jour l’enfant, devenue adolescente, est amenée à mieux connaître ce père. Sans trahir immédiatement les ressorts de cette relation nouvelle, le père séduit sa fille bâtarde en lui ouvrant les portes (au sens propre) d’une vie qu’elle ne pouvait qu’ignorer auprès d’une mère aux moyens pécuniaires limités. La comparaison joue en défaveur de la mère qui subit alors le rejet violent de sa fille. Christine Angot maintient le ton de son récit au niveau de la conversation. Elle déroule son histoire sobrement, sans commentaires psychologiques, sans clins d’œil au lecteur. Celui-ci, privé de connivence, est renvoyé à sa propre morale, d’autant que les mots jetés sur le papier sont durs, abrupts, impitoyables. Et l’on prend (j’ai pris ?) encore parti pour cette femme isolée, dédaignée, résistant malgré l’ignominie des faits. Jusqu’au moment où éclate la faute du père, le reproche de la fille à la mère, la fuite de celle-ci dans la maladie, et l’on se prend au jeu de l’empathie enfin pour l’enfant victime .
On l’aura compris, aucun membre de cette fausse famille n’est épargné. Le père évidemment, mérite l’oubli où sa fin l’a mené. Mais des relations passionnelles amour haine entre les deux femmes, il ressort un revirement rafraîchissant bienvenu. Christine peut enfin accéder au pardon, le pont se crée entre la mère et la fille, même si il est aisé de deviner que leurs rapports n’auront plus jamais la spontanéité et le naturel des années d’enfance.
Alors, ce style Angot ? Il m’a semblé, sur la foi de ce livre lu, que les redondances, les répétitions, l’application au renoncement de toute élégance stylistique, la platitude scrupuleuse de la syntaxe, convenaient à l’incarnation du noyau familial. Rachel n’est pas une simplette, mais à l’inverse du conformisme bourgeois du père, elle a manqué d’ambition sociale, elle a subi la dévalorisation du regard sans se trahir. Elle apparaît en réalité comme une femme de cœur, et la réconciliation finale est plus qu’une fin heureuse, c’est une revanche sur les calculs et les manœuvres paternels, c’est le rejet définitif d’un monde aux valeurs frelatées. Sans retour, sans concessions.
De là à lire tout Angot ? Je ne crois pas… Mais finalement, Catherine avait raison, ce livre délivre une certaine émotion authentique qu’il serait stupide de dédaigner, juste par parti pris. À vous de vous faire une opinion.
Un amour impossible
Christine Angot
Flammarion (rentrée septembre 2015)
ISBN : 978- 2-08-128917-8
19:41 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christine angot, roman français, autofiction, rentrée littéraire 2015 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer