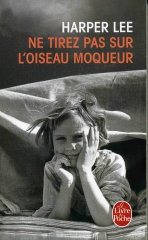25/01/2016
Va et poste une sentinelle
S’il est une erreur à éviter, c’est d’enchaîner la lecture de la deuxième œuvre publiée d’Harper Lee juste après avoir achevé Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur. Erreur absolue que je vous conseille de ne pas commettre à votre tour, à double titre : protégez votre plaisir de lecture d’une éventuelle déception, et offrez à ce roman une chance de vous toucher.
Lire donc Va et poste une sentinelle sans essayer d’établir un lien chronologique entre les deux ouvrages. Difficile certes pour les lecteurs qui ont vraiment apprécié le premier titre paru. Ne pas se laisser influencer par la genèse de l’œuvre, qui nous présente celui-ci comme une ébauche.
Parmi les éléments qui vous surprendront sans doute, sachez que l’héroïne de Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, devenue adulte, ne s’entend plus guère appelée Scout mais Jean Louise. Après ses études, la jeune femme s’est installée à New York et le roman débute alors qu’elle revient à Maycomb où elle pense se ressourcer quelques jours chez son père Atticus. Elle sait qu’elle retrouvera près de lui sa tante Alexandra qui l’agaçait déjà dans son enfance. D’entrée, le style est très différent, le charme de l’enfance envolé, certes, mais le ton si particulier du premier ouvrage, incisif, railleur et faussement naïf, tellement réjouissant, n’est plus. Ce n’est plus Scout qui raconte, le roman est écrit à la troisième personne, ce qui permet de réaliser paradoxalement l’intérêt d’un récit à la première personne, l’intimité immédiate que crée le processus entre le narrateur et son lecteur.
Les perspectives de Jean Louise sont partagées par ce retour à Maycomb. Elle guette les signes de faiblesse de son père qui vieillit physiquement, mais elle en attend rigueur intellectuelle et honnêteté morale qu’elle a toujours connues. Elle retrouve également sa complicité avec un nouveau venu pour nous, Henry Clinton, Hank pour les intimes, qu’Atticus considère comme son successeur potentiel depuis la mort de Jem. Car, et c’est un nouveau choc, nous apprenons que le frère aîné de Jean Louise est décédé brutalement. Henry Clinton, orphelin depuis son adolescence, a été aidé par Atticus et lui voue en retour une piété filiale. Ses rapports amoureux avec Jean Louise date de cette époque et nous pensons à Dill, second grand absent du roman. Nous sommes ainsi préparés à observer les changements survenus dans la petite bourgade.
Au-delà des éléments de ton, de style, le fond de l’intrigue majeure reste la manière dont l’héroïne va être conduite à grandir en se confrontant à la réalité. Jean Louise est désormais New Yorkaise, elle s’est habituée au mixage des visages, des habitudes, des micro-sociétés qui se côtoient dans la grande ville du Nord ; Nous sommes maintenant dans les années cinquante, mais l’Alabama est toujours enraciné dans sa mentalité du Sud et la jeune femme va devoir réapprendre un nouveau code comportemental. Certes, elle reste provocatrice et entière, mais elle a appris à composer avec sa tante, elle joue aussi au chat et à la souris avec Henry, réellement amoureux d’elle. Malgré elle, elle ne peut s’empêcher de se questionner au sujet d’un éventuel mariage avec l’ami d’enfance, le substitut de son frère disparu. Ce sont là des éléments d’incarnation du personnage qui ne manquent pas d’intérêts.
Mais ces questionnements personnels se retrouvent brutalement balayés par un événement qui prend la mesure d’un ouragan. Obéissant à sa curiosité, Jean Louise s’est glissé dans la salle du tribunal, comme autrefois pendant le fameux procès où Atticus avait tenté de défendre un noir injustement accusé de viol. Alors que dans le passé, son père avait revêtu les atours d’un archange défenseur du Droit, elle le surprend ce dimanche-là en pleine compromission avec des racistes notoires. Stupeur et accablement, Jean Louise est bouleversée. Son père serait-il devenu raciste, adepte des idées du Klan dont elle a trouvé un fascicule de propagande sur un guéridon du salon ? Tenaillée entre un amour inconditionnel pour la figure paternelle qui s’impose depuis son enfance comme un repère, et cette découverte qui l’horrifie, elle vit en deux journées sombres une véritable révolution —au sens géométrique du terme— qui la conduit à intégrer la nécessité des compromis. Son père perd son statut, son univers bascule, c’est encore une étape vers la maturité que doit gravir douloureusement l’ex petite Scout.
Roman donc de passage initiatique, Va et poste une sentinelle, expose la vision de l’auteur, elle-même femme de ce Sud ambivalent. Ce sont les thèmes centraux des deux ouvrages, bien que traités différemment. Si la réussite de l’Oiseau moqueur est incontestable, Va et poste une sentinelle souffre d’une facture plus didactique, d’une sensibilité moindre dans l’expression des états d’âme de l’héroïne, comme des personnages secondaires : Cet Henry Clinton, amoureux gentiment repoussé est trop placide, trop parfait. Les explications de l’oncle Jack, philosophe loufoque, tournent autour du pot et peuvent être lassantes malgré les anecdotes cocasses. Quant à Atticus, est-il aussi convaincant quand il laisse sa fille patauger et s’enferrer au lieu de mettre les points sur les i ? En un mot ce roman forgé de bonnes intentions paraît infiniment moins réussi que celui qu’Harper Lee publiera quelques années plus tard. Il reste néanmoins intéressant en ce qui concerne l’éclosion au monde adulte, aux vérités ambiguës et aux nécessaires compromissions.
Va et poste une sentinelle
Harper Lee
Grasset (Octobre 2015)
ISBN :978-2-246-85868-3
12:16 Publié dans Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : harper lee, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, va et poste une sentinelle, littérature américaine, romans à thèmes, racisme, ségrégation, tolérance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
23/01/2016
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur
On pourra toujours se demander pourquoi il a fallu tant de temps aux lecteurs français pour apprécier ce roman devenu immédiatement incontournable lors de sa parution aux USA en 1960. Voilà un livre qui se ferme à regret, et une héroïne, Scout, que l’on voudrait accompagner bien plus longtemps.
De ses cinq à ses huit ans, c’est à la hauteur du nez de cette fillette intrépide, résolue, et tenace que nous nous immergeons dans la vie d’une petite ville du Sud de l’Alabama. Vous allez découvrir Maycomb dans les années 30, bourgade isolée avec ses rues bordées de maisons coquettes, son centre-ville que l’on peut encore rejoindre à pied depuis le quartier bourgeois, son école unique et ses paroisses propres à chaque communauté. Scout est la benjamine, de son nom de baptême Jean Louise, élevée en compagnie de son frère Jem par leur père que les enfants nomment tous deux par son prénom, Atticus. La gouvernante-cuisinière-femme à tout faire, Calpurnia, est totalement dévouée aux enfants et à son patron. Atticus est un humaniste. Avocat, il professe la raison et la tolérance envers tous, et sème dans l’esprit des enfants des repères moraux et intellectuels censés les préparer à devenir des adultes accomplis. En attendant, Jem et Scout sont souvent livrés à eux-mêmes dans le jardin de la maison et dans le quartier tranquille qu’ils habitent. Tranquille ce quartier ? Pas si sûr ! La demeure voisine semble bien mystérieuse avec ses volets toujours clos et ses habitants invisibles. Et le sort de Boo Radley, le garçon de la maison préoccupe la fratrie, rejointe en été par Dill, un gamin du même âge qui passe ses vacances chez sa tante. Les trois compères imaginent diverses stratégies pour rencontrer Boo enfin et qui sait, le sauver d’une supposée séquestration… Harper Lee joue à merveille des mots et des expressions pour relever ce récit qui pourrait s’apparenter aux sagas enfantines dans la veine de Mark Twain, par son insolence et sa critique sous-jacente des conformismes. Sauf que Jem et Scout ne sont pas malheureux. Si la mère n’est plus, Calpurnia assume de son mieux les fonctions maternelles, même si elle cache sa tendresse sous des dehors rugueux, qui font fulminer Scout, mais qui se révèlent très vite indispensables au respect du cloisonnement naturel entre Blancs et Noirs. Harper Lee décrit l’enfance comme un territoire harmonieux, où les disputes se limitent à l’assaisonnement naturel des jours trop tranquilles.
Et puis un soir, Atticus éprouve le besoin de mettre ses enfants en garde. Dans les semaines à venir, ils vont entendre des rumeurs désagréables, ils seront même sans aucun doute chahutés par leurs camarades, ils vont devoir apprendre à se comporter selon les principes qu’il espère avoir inculqués. Commence une nouvelle année scolaire où Scout va grandir plus vite que les années précédentes. La calomnie, la distance, l’hostilité sournoise se font sentir… Des enfants du quartier défavorisé d’Old Sarum sont intégrés à l’école et les différences d’éducation révèlent des fractures dans l’équilibre de la société. Toutefois, Scout paraît souvent plus intéressée par ces failles que par le bavardage insipide des chipies habituelles. Progressivement, l’atmosphère de la petite ville s’est tendue, les menaces contre Atticus deviennent de plus en plus évidentes et ne peuvent plus être cachées aux enfants. Mais Scout peine à saisir la raison de ces changements, jusqu’à ce soir où, Atticus les pensant couchés, Jem et Jean Louise se relèvent et courent vers la ville, pour découvrir leur père assis sur une chaise en train de monter la garde devant la prison. Il est seul, héros solitaire d’un drame prêt à exploser. Heureusement, l’imprimeur local va prêter main-forte à l’avocat en mauvaise posture. Scout tourne et retourne la situation, ne comprenant pas qu’Atticus soit inquiété alors qu’il a été commis d’office à la défense de l’homme accusé de viol que certains citoyens de Maycomb aimeraient lyncher sans autre forme de procès. Le procès s’ouvre cependant le lendemain. Jem, Dill et Jean Louise doivent ruser pour assister, malgré l’interdit paternel, aux débats.
Sans changer de ton, Harper Lee parvient à donner au roman l’épaisseur d’une critique acérée contre le racisme, l’intolérance, la bêtise. Racontées par une enfant de huit ans, les situations apparaissent parfois terriblement cocasses, le rire éclate alors même que l’émotion et l’écoeurement prévalent. Toutes les pages consacrées aux audiences sont haletantes et je défis le lecteur de poser le livre. Mais le procès achevé, la défaite consommée, les choses n’en restent pas là parce qu’on est en Alabama, où la guerre de Sécession n’a jamais quitté les esprits. La dernière partie du livre nous tient toujours davantage en haleine et les surprises nous attendent jusqu’à l’ultime page.
C’est sans doute ce qui explique la désolation du lectorat d’Harper Lee, qui n’a rien publié de plus pendant des décennies. Silence pesant enfin rompu l’année dernière par l’édition de Va et poste une sentinelle, mais c’est une autre histoire, comme l’on verra bientôt.
En ce qui concerne Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, ce n’est pas l’auteur que je vais citer, mais Isabelle Hausser, qui a révisé la traduction du roman et achève ainsi la postface: « Le texte d’Harper Lee, d’une infinie drôlerie, est un enchantement. Il a la légèreté et le poids que recherche le véritable amateur de roman et cette vertu si rare de pouvoir être lu à tout âge, quelle que soit l’éducation que l’on a reçue, de quelque pays qu’on vienne, à quelque sexe que l’on appartienne. »
La longue absence d’Harper Lee sur la scène éditoriale a contribué à fonder sa légende. La jeune femme a trente-quatre ans lorsque sort le roman en 1960. L’ampleur du succès international immédiat, l’attribution du Pulitzer l’année suivante, le film qui en est tiré ( titre français du silence et des ombres) , sont autant d’occasions d’interprétation des éléments biographiques qui ont inspiré le fond et la forme de l’affaire. Son amitié avec Truman Capote attestée, l’auteur n’a jamais caché le rôle de son propre père dans la construction de la figure d’Atticus. La genèse du livre commence à être mieux connue, en particulier à la lumière du second ouvrage, bien différent. Mais chaque chose en son temps. Il est peu vraisemblable que Nelle Harper Lee, 90 ans en Avril prochain, cède à la tentation médiatique et se livre davantage…
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur (To kill a mocking bird 1960 )
Harper Lee
Le livre de poche ( Grasset)
1ÈRE parution en France 1988 chez Grasset, réédité en 2015 en poche
ISBN : 978-2-253-11584-3
18:44 Publié dans Livre, Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, va et poste une sentinelle, harper lee, roman à thèmes, littérature américaine, racisme, ségrégation, tolérance |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
25/03/2012
Nettoyage au Jardin …
Bienvenue au beau temps !
La semaine écoulée a été rude pour tous, l’atmosphère générale assombrie par une actualité où l’horreur et la barbarie le disputent à l’incompréhension. Et pourtant, là où le recueillement dans l’émotion et la compassion s’impose comme seule réponse à cette folie meurtrière, nous sommes baignés dans les flux d’infos, d’opinions, de reportages creux— non, rien de nouveau, le présumé coupable ne bouge plus— en interminables expertises de spécialistes. Et comme chaque fois que le danger est passé, nos hérauts médiatiques relaient la diatribe: — fallait-pas, y’avait-qu’à…
Le printemps sonne à point l’heure des pulsions ménagères.
Descendons au jardin arracher les mauvaises herbes, détruire les graines de folie qui pourrissent nos plantes bandes et le cours de nos pensées.
Mes gouttes d’O évitent habituellement la pollution politique, mais certains mots poussent sous le sarcloir ; ils réclament d’être dits, écrits, chantés et contés afin de fissurer la gangue du quant à soi et des avis raccourcis.
Notre société ne va pas bien, elle engendre des monstres, celui de cette semaine n’est pas le premier, de sinistre mémoire. Mais la solution n’est pas dans la vitupération, les faux débats agités pour faire de l’audience. Pollution de nos âmes, le racisme ordinaire est latent, larvé, prêt à émerger de son trou à la première occasion, et son réveil constitue un méfait supplémentaire — dégât collatéral— du tueur de Toulouse et Montauban.
Il appartient à chacun de nous de ne pas se réveiller un jour dans la peau de Madame Dupont La Joie. Ne pas continuer à faire la sourde oreille aux petits avis chauvins et gratuits distillés au compte-goutte, se dire que ce n’est pas notre faute, qu’on n’a pas vu, rien compris, mal évalué les aspects du problème.
Dupont La Joie n’est que le prototype du méchant-lâche-mesquin-râleur-raciste-et-borné ordinaire. Il concentre les tares usuelles, ce qui finit par allumer le projecteur sur ses nuisances. Mais dans la vraie vie, nous côtoyons une multitude de clones inaboutis du personnage, qui véhiculent leur racisme ordinaire par flots de mails et de remarques saumâtres déversées à l’attention d’un public déjà convaincu, classées à la rubrique il faut bien que je m’exprime, moi !
Le climat des élections est évidemment propice à l’exercice.
Les meurtres barbares de Mohammed Merah aussi, hélas.
Et le discours va s’amplifiant : tu vois bien c’est encore un Maghrébin, un Arabe, un musulman.
La télévision, la radio, l’ensemble des médias audio et écrits ont délivré à foison la parole des représentants des diverses communautés impliquées, unis pour essayer de calmer par anticipation ces querelles latentes…
Rien n’y fait, du tsunami d’informations qui tournent en boucle, notre contempteur n’extrait que sa preuve irréfutable — tu vois bien, ils vont bientôt tous nous bouffer!
Je nettoie mon jardin, je nettoie la maison, je jette mes vieux papiers, traces dérisoires d’un passé qui fût mien, et j’essaie de nettoyer mon âme des remugles de notre époque.
Inlassablement, un parallèle me vient. L’histoire n’est-elle pas un éternel recommencement ?
Au siècle précédent, les années trente, années de crises par excellence— crise financière de 1929, effondrement économique des USA et des pays d’Europe, chômage et insécurité, ont abouti aux solutions que l’on sait. La montée des fascismes ne doit rien au hasard.
Nous avons quatre-vingts ans de recul, une guerre mondiale, des idéaux perdus, de multiples conflits de moins en moins locaux ont enflammé la planète de l’Europe et l’Asie en passant par l’Amérique latine et l’Afrique, mais nous avons développé des moyens de communication et d’étude infinis, et pourtant ?
Plus jamais ça, entendait-on au sortir de la Grande Guerre …
Plus jamais ça…
Mais nous sommes Dimanche, il fait beau, c’est l’heure d’été et la soirée s’annonce douce et longue…Versons un peu de vin doux sur ces gouttesd’O amères.
Hier soir, en me régalant de ma daurade grillée au fenouil, j’ai soudain réalisé que je ne savais pas si mon poisson avait été tué suivant la méthode Casher ou Hallal … Quelle Horreur ! Comment savoir si ma daurade a souffert longuement ou si elle a trépassé sereinement, assurée d’être cuisinée et dégustée avec tout le respect dû à sa dépouille ?… Du coup, je la sens qui trésaille dans mon estomac, qui réclame justice à grands cris, et mon corps bataille vigoureusement entre deux options : soit je cède à ma conscience traumatisée et je rends à Dame Nature le cadavre à peine décomposé, soit je conserve l’énergie et les calories que ce met délicieux me transmet et, mes forces revenues, je sors au jardin pour nettoyer la Nature des scories hivernales.
19:07 Publié dans Blog, Courant d'O | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : écriture, barbarie, racisme, printemps, crise sociétale, affaire merahl |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
05/02/2012
Ragtime
EL Doctorow
Édition originale 1975
Première de mes lectures « Kindle », j’ai téléchargé Ragtime en version originale, manœuvre d’une simplicité déconcertante. Ce qui m’a permis de renouer avec un exercice que je n’avais plus commis depuis lurette, et ma foi, si mon rythme de lecture est moins rapide qu’en français, j’ai beaucoup apprécié l’usage de la liseuse électronique. La simplicité d’utilisation du dictionnaire intégré permet de ne pas vraiment interrompre le fil du texte. De même les fonctions surlignage et notes offrent la possibilité d’oublier crayon de papier, carnet ou post it qui me ramenaient (avec un certain contentement, je l’admets) aux années studieuses. L’objet est donc adopté, ce qui ne va évidemment pas m’aider à résoudre l’effondrement de la pile des livres-papier qui attendent patiemment leur tour…
La première impression produite à la lecture de Ragtime évoque la peinture, une fresque impressionniste et fourmillante d’une Amérique bouillonnante aux portes du XXème siècle.
Lentement, les chapitres initiaux du roman dressent une suite de petits tableaux dont on se dit d’abord qu’ils nous dépeignent, par le prisme d’une mosaïque, une société dynamique et novatrice, une représentation du rêve américain, d’autant que Doctorow renforce ces symboles de réussite en mêlant des personnages réels ( Freud , Houdini) à ceux qu’il crée de toutes pièces.… Le procédé intrigue et amuse, surtout quand le point de vue narratif situe le lecteur dans la réflexion du créateur : à maintes reprises, l’auteur précise par exemple qu’on ne sait pas grand chose des origines de certains personnages — Coalhouse ou Sarah par exemple— mais j’en retiendrais comme illustration plus évidente la dénomination des personnages centraux : en français Père, Mère, le plus jeune frère de Mère… sans indiquer jamais leur véritable nom. Ce procédé est intéressant en ce qu’il situe d’office le lecteur comme membre de cette famille nantie et bien installée d’une banlieue confortable de New York.
De fait, plus on avance dans le déroulement de la fresque, plus les fêlures de cette société idéale apparaissent : la marginalisation de certains personnages sert de ressort aux rencontres des protagonistes que tout oppose, comme Evelyn Nesbit, dont le sort est chamboulé par la jalousie de son mari. Elle est amenée à côtoyer d’abord un architecte de renommée internationale avant de se laisser fasciner par un artiste maudit, épisode qui la confronte à notre curieux plus jeune frère de Mère le temps d’une idylle invraisemblable, dont le descriptif initial est franchement hilarant et saugrenu. Le plus surprenant, et pas le moins intéressant réside dans l’évolution de la relation entre Evelyn et Emma Goldman, militante anarchiste dont la présence souligne à maintes reprises la complexité et la violence sous-jacente des rapports de classe dans cette Amérique laborieuse :
« In Seattle, for instance, Emma Goldman spoke to an IWW local and cited Evelyn Nesbit as a daughter of the working class whose life was a lesson in the way all daughters and sisters of poor men were used for the pleasure of the wealthy. »
Ces épiphénomènes de l’intrigue ne masquent pas le ton âpre de l’analyse sociale que dresse en fait E.L Doctorow : dès que nous faisons connaissance avec Tateh (prototype du Juif errant ?) et sa petite fille, l’écrivain aborde la description d’une société plus fragile, plus tendue, où les bouillonnements sociaux mènent aux grèves et aux affrontements répressifs. Et de fait, l’errance de Tateh et de sa fillette préfigure les crises sociales à venir. Le combat de Coalhouse Walker est emblématique du problème racial inhérent aux USA, question qui alimente d’ailleurs une bonne part de la créativité littéraire, musicale et cinématographique de ce vaste état. Sans avoir l’air d’y toucher, le sujet principal du roman s’organise autour de ce personnage apparemment si bien intégré, si raffiné. L’astuce de E L Doctorow consiste à le marginaliser à partir de ces qualités :
« It occured to Father one day that Coalhouse Walker Jr didn’t know he was a Negro. The more he thought about this the more true it seemed. Walker didn’t act or talk like a colored man. He seemed to be able to transform the customary deferences practiced by his race so that they reflected to his own dignity rather than the recepient’s … »
Effectivement le drame se noue à partir de cette appréciation fondamentale. Coalhouse ne peut supporter l’injure qui lui est faite par le biais de son automobile et la cécité de la société à l’égard des coupables est responsable du déchaînement de la violence aveugle qui s’ensuit.
Insensiblement, les touches impressionnistes de la première partie cèdent la place aux portraits plus sombres d’une société qui vit au bord d’un précipice. Dans la lumière, les avancées des progrès industriels, avec la longue description du réseau de transports desservant la mégapole, les expéditions polaires aux côtés de Peary comme vitrine de l’esprit pionnier, l’emballement du financier Pierpont Morgan à l’égard de l’industriel Henry Ford. Dans le clair obscur qui se dessine au-delà de ces épisodes, les luttes ouvrières, la misère sociale, la réalité d’une émigration qui ne trouve pas l’Eldorado promis, le racisme et les ostracismes de toutes sortes…
« Tracks ! tracks ! It seemed to the visionaries who wrote for the popular magazines that the future lay at the end of parallel rails. There were longdistance locomotive railroads and interurban electric railroads and streetrailways and elevated railroads, all laying their steel stripes on the land, crisscrossing like the texture of an indefatigable civilization… »
Au fil de ce récit pointilliste, E L doctorow ne cèle d’ailleurs aucunement ses prises de positions quant à la résolution sociale des heurts qu’il suggère, quitte à user d’une ironique naïveté.
« I do not think you can be so insolent as to beleive your achievements are the result only of your own effort. Did you attribute your success in this manner, I would warn you, sir, of the terrible price to be paid. … »
Malgré le resserrement progressif de l’intrigue vers le nœud final, Edgar Laurence Doctorow ne se fait pas le chantre de l’apocalypse. Il laisse même entrevoir une sorte de miracle de la rédemption quand nous retrouvons Tateh et sa fille bien des années après leur fuite. Doctorow s’amuse à brouiller les pistes, mais il soulève un coin de voile qui semble dire : mais oui, le rêve américain n’est pas mort, il y a un champ des possibles, même s’il ne garantit pas le Bonheur…
« When he was alone he reflected on his audacity. Sometimes he suffered periods of trembling in which he sat alone in his room smoking cigarettes without a holder, slumped and bent over in defeat like the old Tateh. But his new existence thrilled him. His whole personnality had turned outward and he had become a voluble and energetic man full of the future. He felt he deserved his happiness. He’d constructed it without help. »
Loin de conforter l’image rassurante des premiers chapitres, Ragtime nous mène progressivement à la lucidité poignante d’un monde aux portes de la Barbarie, qui se précise dans l’inévitable implication des États Unis dans le premier conflit mondial. Ce roman qui commence en 1902 par la description de la belle maison de New Rochelle s’achève sur des perspectives tout autres. Un récit passionnant, étonnant parfois, remarquable par l’acuité de son regard.
19:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, ebooks, ragtime, e l doctorow, littérature américaine, société, racisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer