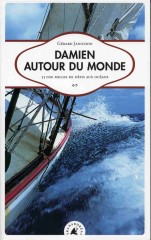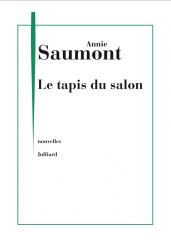11/02/2013
La guérison du monde
Frédéric Lenoir
Fayard (Janvier 2013)
ISBN : 978-2-213-66134-6
Écrivain de l’Optimisme, Frédéric Lenoir ?
Assurément, ce philosophe expert de la transcendance, œuvre depuis longtemps pour aider ses congénères à s’ouvrir à l’autre et accepter la part du religieux dans nos cultures.
Ses ouvrages antérieurs autant que la direction du Monde des Religions ont fondé son message de tolérance et de compréhension des aspirations de l’Homme à dépasser son quotidien.
Cette fois, Frédéric Lenoir prend un pari plus pragmatique. La proposition de son dernier titre engage un pronostic et une démarche. Est-ce dire que l’auteur entend nous livrer un protocole de médications propres à sortir nos sociétés du marasme où nous pensons patauger ?
Pour ce faire, en pédagogue avisé, Frédéric Lenoir dresse un tableau exhaustif des différents malaises recensés par la lecture des événements qui se bousculent au fil de l’actualité. Il donne à voir combien toutes les crises qui bouleversent nos existences sont liées, et ne sont en fin de compte que les multiples aspects d’un désaccord systémique entre l’Homme et la planète.
L’analyse devient limpide en suivant la logique de l’auteur, qui rappelle comment depuis les débuts de l’humanité, l’homme s’est adapté physiquement et mentalement aux conditions de son existence et de sa survie. Ce détour par la préhistoire et ce qu’il appelle la « révolution néolithique » ne paraît pas superflue, tant à lire ces lignes, ce raisonnement légitime la perception de nos recherches identitaires. La pertinence de la démarche s’illustre par le paradigme des « frontières » : au cours de son évolution, l’homme s’est délimité différentes frontières, celles qu’il définit comme verticales, positionnements individuels d’une connexion au monde qui le dépasse, mais dans lequel il se sent intégré. Puis avec l’aisance du progrès matériel, ce sont des frontières horizontales, la conquête de nouveaux territoires, le sens de la domination sur autrui qui le guide. Aujourd’hui, nous n’avons plus guère de perspectives d’expansion territoriale, mais nos besoins de puissance ne se sont pas pour autant atténués. D’où la quête d’un Ego civilisationnel, alibi collectif justifiant la course aveugle au « toujours plus ». Si l’Occident a réussi à imposer ses valeurs consuméristes, que nombres de pays émergents se sont également appropriés, cela ne suffit nullement à résoudre les problèmes que ce mode de vie engendre, dont les crises économiques, financières, écologiques, politiques et sociétales analysées en début d’ouvrage.
Frédéric Lenoir souligne à ce propos un aspect sociétal de l’argument des religions. Lui qui ne peut être suspect d’irrespect à l’égard des courants spirituels qui transcendent toutes les traditions, émet l’idée que le prosélytisme religieux sert plus souvent une volonté de domination qu’un réel élan idéaliste. ( référence aux évangélistes télégéniques autant qu’aux islamistes radicaux, sans oubli des terreurs de L’inquisition.) La mondialisation des idées sert plus la propagande que l’élévation des débats.
Reste donc à définir ce qui pourrait réellement permettre la guérison de nos plaies et le dépassement d’une société où l’injustice sociale et le repli individualiste ont remplacé les batailles de grands idéaux des siècles passés. Avant que ne s’achève le pillage inconsidéré de notre planète, il appartient à chacun de nous, autant qu’aux états que nous légitimons, de réinvestir une conduite autonome et responsable. « Pour que le mode guérisse, il nous faut ainsi passer de la logique quantitative dominante à une logique qualitative encore marginale. » (page 303). En cessant de se considérer comme victimes impuissantes de situations avérées, Frédéric Lenoir nous enjoint de nous « transformer (nous)—même » , de revenir à un nécessaire rééquilibrage entre nos vérités intérieures et les buts fixés par la société. L’auteur s’appuie sur la dualité de nos facultés et nous enjoint d’ouvrir notre mental à nos ressentis autant qu’à nos réalisations. « Pour s’épanouir, l’être humain a autant besoin d’intériorité que d’extériorité, de méditation que d’action, de se connaître lui-même que d’aller à la rencontre des autres. » (Page 292)
Citant les exemples de contemporains à l’œuvre comme Pierre Rabhi et son expérience d’autonomisation , Frédéric Lenoir prône un essor de l’individu global, aussi attentif à son bien-être physique dans un monde débarrassé des substrats qui l’empoisonnent que sa quiétude intellectuelle et mentale par le développement et le respect de sa dimension intime. Page 231, il nous renvoie à la perception de l’Homo universalis de la Renaissance, par lequel « l’homme affirme sa liberté dans la conscience qu’il a du fait qu’il contient en lui tout l’univers. Il est microcosmos.(…) de ce point de vue, la liberté équivaut à la prise de conscience du caractère relationnel de l’identité humaine . (…) Dans le cosmos, tout est relié, les choses visibles aux réalités invisibles, des couleurs aux étoiles, des plantes aux organes du corps, des métaux aux humeurs et aux saisons. » C’est par une hiérarchisation individuelle de ses valeurs que l’homme pourra conquérir à nouveau l’harmonie première indispensable à la sortie des impasses où notre inconséquence nous conduit depuis trop longtemps.
18:22 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Waddine, ou la pratique du conte
Toutes nos lectures sont autant de rencontres, portes ouvertes sur des univers différents et spécifiques. Le hasard dépose parfois de minuscules balises sur nos chemins, jalons convergents vers des horizons insoupçonnés, des trouvailles insolites ou évidentes, des liens tissés à notre insu. Quelquefois l’aventure reste sans lendemain, mais il arrive qu’elle creuse son nid, flâne dans notre inconscient et finisse par émerger un beau jour sous une forme inattendue, île au trésor posée sur l’océan de nos imaginaires.
Cette remarque est doublement vraie.
D’abord, elle peut résumer ma rencontre avec l’auteur du conte que ma note souhaite vous inciter à découvrir. Mais cela, mes souris fidèles et discrètes, je vous en soufflerais peut-être quelques mots en d’autres occasions.
Pour l’heure, que vous cherchiez un conte pour enfant ou une fantaisie pour égayer un soir d’hiver un brin morose, partez avec moi dans l’univers d’un prince des mots, d’un magicien intemporel, d’un souffleur d’enchantements…
Waddine est à l’origine le nom d’un personnage imaginaire, mais à l’existence réelle, même si sa présence est restée occulte… Waddine était le compagnon secret d’un petit garçon à l’âme solitaire, il faut croire. Pour ma part, après avoir lu le conte écrit par Serge Casoetto, j’ai acquis une autre perception de cette transposition : il se pourrait que l’auteur ait un don de voir ce que nous autres, pauvres mortels, sommes incapables de reconnaître.
En pénétrant dans l’univers de Waddine, le conte, nous arrivons d’abord à Lamina, un village de montagne reculé et intemporel où parvient un beau jour un personnage sans attache ni référence, dont beaucoup commencent à se méfier, comme il est de mise dans les campagnes.
« En réalité, Waddine parle peu. Il arrive rarement qu’il prononce même un seul mot durant ces visites nocturnes. Le timbre de sa voix est comme celui des sirènes. Il s’évanouit au gré des vagues et du vent.… » ( Page 19)
Or le bel inconnu se joue des défiances. Waddine semble posséder un atout inné, un pouvoir de séduction qui s’exerce naturellement sur les différents membres de cette communauté, où habitent comme partout des personnes fort dissemblables.
Dans une langue colorée et parsemée d’images poétiques, Serge Casoetto présente peu à peu les habitants de Lamina. Car, si les villageois lui ouvrent leur coeur, nul ne parvient à connaître vraiment l’étranger qui s’est installé dans une misérable remise à l’écart du village.
Cependant un drame éclate et Gordjaev, chef d’une petite bande de gamins dépassés par leur propre jeu, se retrouve confronté à une terrible responsabilité. Un terrible enchaînement de violence, que l’auteur évoque en scènes saisissantes.
« Dans la rue silencieuse, Gordjaev est resté seul. Il s’approche lentement du corps de Samuel, étendu contre le trottoir. La pierre l’a atteint en pleine tempe. Incrédules, les yeux bleus de l’enfant contemplent le ciel et la cime des verts peupliers. Gordjaev se sent profondément seul. Le petit Russe s’écroule en pleurs sur le cadavre de celui qu’il voulait châtier. Puis, relevant la tête en hoquetant, Gordjaev le fier aperçoit à travers ses yeux obstrués de larmes une silhouette descendre la petite rue. Il la reconnaît. La longue cape noire efface l’habit blanc de lumière. Waddine s’arrête aux pieds de Samuel, mais ses yeux ne regardent que Gordjaev. Et Gordjaev ne voit plus que Waddine. Alors, Gordjaev Yemkov se lève. Il paraît implorer en une soumission la clémence du pèlerin. » (Page 29)
Ce paragraphe me paraît particulièrement explicite de l’intrusion du merveilleux dans une histoire humaine. Si le lecteur ne peut déceler immédiatement la quête qui se dessine dès ce moment, il se posera sans doute des questions: Quel est le sens de cette indifférence apparente envers la victime ? La première partie du conte ancre l’histoire et les personnages dans un monde réel où le merveilleux est implicitement distillé pour créer chez le lecteur ce chatouillement d’hésitation qui nous surprend au moment de franchir un passage défendu.
Les réponses se dessineront progressivement, au terme de multiples péripéties vécues par d’étranges personnages convergeant vers… Un lieu secret, île paradisiaque ou repaire bien gardé ? Je me garderais de développer plus avant les étapes et les portraits de ces nouveaux protagonistes, il suffit de les accompagner au long de leur quête, voyage fantastique entre deux mondes, où Serge Casoetto ménage de multiples clins d’œil: à la mythologie et à l’Histoire antique, certains personnages portent des patronymes évocateurs, Nabuchodonosor, Mnémosyne, Sémiramis… Mais aussi Mac Luke ou Gomina, manière humoristique de refuser de s’enfermer dans un genre trop codifié.
Naturellement, ce conte original s’adresse d’abord à de jeunes lecteurs prêts à s’affranchir de l’enfance, qui sauront s’amuser dans le dédale des mondes juxtaposés. En tant que lectrice adulte je me suis rafraîchi l’esprit en m’immergeant dans un univers simplement merveilleux qui, sous son aspect ingénu, offre une belle matière de réfléchir à l’authenticité et la sincérité de nos valeurs.
Waddine
Serge Casoetto
Tous les renseignements pour se procurer l'ouvrage, et bien d'autres oeuvres du même auteur, sont détaillés sur le site de Serge casoetto:
http://www.serge-casoetto.com/
15:41 Publié dans Conte-gouttes, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/10/2012
"Damien" autour du monde
Gérard Janichon
Édition Transboréal, collection sillages.
Réédition 2010
Première parution 1998
ISBN : 978-2-913955-86-8
Envie de vous évader un peu de la grisaille ambiante, des embouteillages routiers, des perspectives misérabilistes dont on nous rebat les oreilles ? Ménagez-vous alors un bon moment car l’embarquement sur le « Damien » est un voyage au long cours : « 55 000 milles de défis aux océans » selon le sous-titre que Gérard Janichon a donné à son récit. Sans compter les 50 pages d’appendices techniques qui ne manquent pas d’intérêt une fois que l’on s’est accroché aux aventures du binôme, le récit de Janichon s’étale sur 609 pages … Le temps ne compte pas quand on aime !
En réalité, l’entreprise n’est pas récente et cette troisième édition nous offre l’occasion de remonter dans le temps, pour constater in petto que malgré les avancées technologiques qui ont marqué les quarante années qui nous séparent de leur départ mythique, le décalage entre les partants et les restants n’a rien perdu de son acuité, de sa véracité. C’est pourquoi Gérard Janichon ajoute en guise de post-face ces vers de Paul Fort :
Ils ont choisi la mer,
Ils ne reviendront plus.
Et même s’ils reviennent,
Les reconnaîtrez-vous ?
La mer les a marqués
Avant de vous les rendre.
C’est l’aveu final qui conclut effectivement la relation de ce voyage extraordinaire.
Et l’on mesurera d’abord la teneur du défi en suivant l’élaboration du projet : Ces copains grenoblois n’étaient pas prédisposés à se retrouver en équipage sur les mers du monde, entre les deux pôles ! Mais les rêves poussent certains avec une force insoupçonnable. Les garçons ont conçu leur dessein au cours de leurs années lycée, et c’est planche par planche qu’ils ont conquis à la sueur de petits boulots annexes le droit de réaliser l’épopée. Il leur a fallu quelques années pour fabriquer leur voilier, grâce à certaines amitiés gagnées par la ténacité du trio de départ. Ils se sont donné des contraintes de raison, ont étudié la faisabilité (l’affreux vocable), ont cherché maints et maints soutiens, ont osé innover, ont beaucoup lu, et se sont quand même entraîné entre la Rochelle et les îles vendéennes à la maîtrise des manœuvres.
Vint le jour J. Je n’ambitionne pas de vous rapporter leur périple par le menu… C’est autrement captivant de suivre ces aventures par les mots de celui qui les a vécus. Mais une fois embarqués vers le Spitzberg et les premières glaces, attendez-vous à partager les veilles des quarts solitaires sous les aurores boréales, à découvrir l’hospitalité des gens de mer et les rencontres hasardeuses. Étonnez-vous des difficultés de navigation lors de la remontée de l’Amazone, constatez les bienfaits du rhum qui coule abondamment à bord et surtout, sautez de joie et de soulagement quand les deux rescapés du Cap Horn sortent enfin du chavirage au large de la Géorgie du Sud, territoire hostile dont je n’avais même pas idée avant de plonger dans les péripéties de ce tour du monde.
Voilà un récit de voyage qui ne sent pas l’esbroufe et l’appel des caméras. L’édition est agrémentée de cartes « à main levée » et de quelques photos au centre de l’ouvrage, comme une respiration entre les deux hémisphères, le temps de reprendre souffle par cette escale visuelle.
Bonne lecture et bon vent…
19:59 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, récit, voilier, tour du monde, lecture, gérard janichon, jérôme poncet, édition transboréal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
20/05/2012
Un p'tit coin de Paraïs
Si la météo exécrable n’avait écourté notre visite à Sainte Maxime, je serais passée à côté d’un joli moment au Paraïs…Il y a des rencontres qui embellissent d’un coup vos journées. Celle que j’ai eu la chance de vivre vendredi dernier est de celle-là.
La médiathèque de Saint Maximin, en lien avec la libraire Jardin des Lettres, avait organisé la réception de Sylvie Giono, fille de l’écrivain, à propos du livre qu’elle a écrit sur leur maison de Manosque. On sait, et je l’ai entendu rapporter encore très récemment, que Giono écrivait retranché dans son bureau, sans puiser directement son inspiration dans le suc de la rue. Certains y voient l’occasion de formuler un reproche, un dédain pour ce rêveur qui n ‘ancrait pas ses personnages dans la réalité autour de lui. D’autres en profitent pour souligner que ses créatures sont de pures inventions, que l’humanité ne peut pas se réduire à des caractères posés sur le papier…
Pour ma part, j’ai dévoré les romans de l ‘écrivain dans ma jeunesse, et je dois dire qu’ils ont creusé alors un sillon très profond dans ma mémoire. Je n’ai découvert la Provence géographique que plus tard. Mais pas une fois au cours de mes incursions dans l’arrière-pays, pas une fois vous dis-je, je n’ai manqué d’y voir ses silhouettes solitaires et affairées dans les collines âpres de l’arrière pays, sur les plateaux illuminés de lavande du Lubéron, dans la découpe grise des crêtes préalpines… Regain, Collines, les âmes fortes…Et la fuite éperdue de Pauline de Théus à travers tout le pays pendant l’épidémie de peste de Manosque. C’est que Giono est de la trempe des Écrivains, ceux qui dessinent un univers tellement fort que la réalité s’estompe avant de s’efforcer d’entrer dans le cadre de nos imaginaires.
D’abord, Sylvie Giono impressionne par le calme et la simplicité de sa présence; cette grande dame s’exprime face à l’auditoire avec la spontanéité et l’aisance d’une amie qui partage un moment de souvenirs. Elle est aidée au long de son discours par deux complices, professeurs de lettres régionaux, qui se passionnent pour l’œuvre de l’écrivain. S’ils sont manifestement trop jeunes pour l’avoir jamais rencontré, il est clair qu’ils vivent, respirent, se nourrissent et s’abreuvent « Giono ». La maison du Paraïs n’a pas de secrets pour eux, et leurs relations avec la fille de l’écrivain semblent révéler une pratique respectueuse mais amicale.
Le jeu des questions-réponses se déroule donc dans une atmosphère bon enfant, les deux acolytes formulant les thèmes qui servent de fil conducteur à cette visite guidée de l’univers de l’écrivain, Sylvie Giono décrit avec précision et humour les rites du créateur, son besoin de calme tempéré par l’assurance que sa famille réunie formait un rempart protecteur contre les intrusions. Les anecdotes abondent pour décrire l’ambiance familiale, depuis les moments d’écoute musicale rassemblant toute la tribu sur la terrasse de la maison, les repas agrémentés du récit des progrès du roman en cours, les relations aux objets d’art fétiches du romancier, la découverte de la bibliothèque somptueuse, car Giono père est un mentor avisé des lectures de ses filles. On apprend ainsi qu’Élise Giono, l’épouse, veille à la ponctuation et l’accentuation des tapuscrits de son époux, tandis que Madame Mère exerce une sorte de régence autoritaire sur la tribu. Il faut dire que l’univers du grand homme est féminin : outre sa femme et ses deux filles, la maisonnée abrite mère et belle-mère, mais aussi Fine, la domestique piémontaise incontournable, qui prend ses repas à la table familiale. Cet homme-là, me direz-vous, peut facilement se retrancher des contingences matérielles, six femmes s’activent à lui fournir les conditions de paix dont il a besoin pour œuvrer.
À travers le regard bienveillant de sa fille, il semble que Jean Giono a pu créer dans un cocon idéal. Son œuvre cependant ne donne pas vie à des personnages au destin lumineux et aisé. La nature semble souvent façonner les êtres en sécheresse et en dureté, pour s’affronter à la rocaille et aux désirs inassouvissables… C’est que le rêveur plumitif ne s’est pas fait que des amis, dans la bonne ville de Manosque. Un début de carrière très malheureux dans la banque s’est achevé par une banqueroute familiale, l’homme n’aura manifestement jamais l’argent pour divinité. Mais ça ne suffira pas pour tenir à distance les envieux, les jaloux et les susceptibles. Jean Giono a traversé le premier conflit mondial en soldat, il en est revenu fondamentalement pacifiste. Cette position affirmée ne l’a pas protégé des attaques des deux camps : on lui a reproché des photographies prises au Paraïs parues dans la presse allemande, en négligeant la chronologie des clichés, bien antérieure au début du conflit ; On n’a pas voulu prendre en compte les risques courus quand il a caché chez lui des réfugiés comme la femme de Max Ernst ou le pianiste Meyerowitz qui refusait de se cacher sans son piano!*. De sorte que par deux fois, Giono sera emprisonné quand sonnera l’heure des comptes.
C’est avec une distance positive que Sylvie Giono évoque ces heures sombres. Elle semble perpétrer ainsi ce caractère essentiel qu’elle prête volontiers à son père. À tous moments, elle souligne en effet la générosité de cet homme qui tenait table ouverte, savait accueillir les visiteurs alors même que son cerveau continuait à jointer ses intrigues en arrière-plan. Par son intelligence affable, cette grande dame contribue à la mémoire de l’écrivain autant qu’à celle de l’homme. Ces deux heures sont passées trop vite et nous ont apporté une grande fraîcheur. Reste une véritable envie de retrouver le plaisir des lectures : mon été 2012 sera sans doute agrémenté de retrouvailles « Giono », qu’on se le dise !!!
Jean Giono à Manosque, sous titré LE PARAÏS, la maison d’un rêveur, paru chez Belin en février 2012 ISBN 978-2-7011-5980-5
* anecdote rapportée page 48
Pour les amateurs disponibles à cette période, Sylvie Giono fait part d’un festival musical à Gréoux les bains en Juin, en relation avec les animations de la maison jean Giono.
18:18 Publié dans Blog, goutte à goutte, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean giono, le paraïs, manosque, littérature, la provence, conférence, saint maximin la sainte baume, culture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
24/02/2012
Le tapis du salon
Annie Saumont
Julliard 2012
ISBN : 978-2-260-01997-8
À sa manière discrète, Annie Saumont occupe le territoire des Lettres Françaises avec une indéfectible constance. Depuis les années 60, elle s’est imposé en donnant à la Nouvelle la reconnaissance d’un réel genre littéraire. Ce qui n’a rien d’évident au pays de l’Académie française, où la tentation est grande de minimiser ce mode narratif.
Une fois de plus, Annie Saumont démontre comment la Nouvelle repose sur la concision extrême du récit. Loin de tronquer l’intrigue ou de simplifier la psychologie des personnages, elle aiguise avec une acuité particulière les mots qui déroulent son histoire. Elle nous livre ici un recueil composé d’une vingtaine de nouvelles rassemblées sous ce titre, le tapis du salon, qui intitule également trois des pièces de l’ouvrage.
Des histoires brèves certes, aux horizons divers. Mais c’est surtout le ton adopté par l’auteure, et son style haché, elliptique jusqu’au système, qui définit l’unicité du recueil. En réalité Annie Saumont traque dans un dédale d’objets anodins ou de faits mesquins le détail qui scelle le sort de ses personnages. Elle dresse par exemple dans la mort du poisson rouge, une atmosphère de sérénité champêtre, où de charmantes familles divertissent leurs non moins charmants bambins en leur offrant un poisson rouge. :
« Calme journée. Pas un souffle de vent.
Mélanie et Antoine sont au jardin. Ce pourrait être la première phrase du premier conte d’un premier livre de lecture.
Mélanie arrache une herbe folle. Antoine écrase du pied une motte de terre grasse.
Pas le moindre frémissement des rideaux à la fenêtre du salon qu’Antoine a ouverte après le petit-déjeuner.… »
En quelques pages, nous identifions trois familles sans histoires, si ce n’est celles de nos quotidiens, myopie de la tendresse parentale et éclairage malicieux des inventions enfantines, jusqu’à ce jeu…
« On joue à la fin du monde ?
Quand le jeu a commencé, si on dit pouce c’est de la triche.
Fallait réfléchir avant.
Fallait dire non pour les cow-boys, la balançoire.
T’as dit oui pour la fin du monde. On continue. »
Une pirouette, un battement de cils plus tard, l’Éden est soufflé par un vent d’apocalypse, qui secoue le lecteur et bouscule l’ordonnance de ce petit monde trop bien léché.
Parfait exemple de cet art de l’ellipse, le début de Quartiers d’automne
« Promenade-danse. Danse-promenade. Le parc est vert. Quatre danseurs ont monté un ballet. Pas vraiment un ballet, des séquences. Ici et là.
Il y a notre petite Ida.
Pelouse. Arbres. Un épicéa. Un sophora-pleureur. Un saule. »
On entre ainsi par le décor dans la quête des personnages qui se cherchent, s’épient, se débattent contre le mal-être, l’absurdité, la méchanceté, la perversité des situations.
Annie Saumont adore avancer sans avoir l’air d’y toucher.
Elle privilégie volontiers les situations où la rumeur et le non-dit travaillent en minant le terrain à l’insu du personnage central. À cet égard, les trois nouvelles qui portent le titre générique sont exemplaires.
Dans la première, c’est un pauvre gosse, le narrateur, recueilli par Yole et Sarie, qui élèvent comme elles peuvent leur petit cousin orphelin. Le tapis offert par l’amoureux de Sarie est trop beau pour la modeste maison. Bien encombrant. Un vrai piège. On le range et on l’oublie… Mais un jour, le narrateur qui a bien grandi, retrouve ses deux cousines enveloppées dans le tapis…
La seconde de ces nouvelles consacrées au tapis du salon repose sur une inadéquation de situation similaire. Le narrateur est élevé par sa sœur Isa, faute d’un père capable d’assumer son veuvage. Par les mots de ce gamin à la vie rustique, on saisit combien la sœur aînée tente d’organiser leur vie et de s’ouvrir un avenir, jusqu’au jour où l’adolescent mal dégauchi tache le tapis… La chute tombe comme un couperet, rapide et impitoyable.
Ma préférée à cet égard reste la seconde, intitulée vacances…
Il vous reste à entrer à pas légers dans ces tranches de vie esquissées à traits vifs et rapides, comme ces croquis au charbon ou à la sanguine qui servent d’étude du sujet. Et vous découvrez que l’esquisse transmet plus de force que la peinture bien léchée.
Mais surtout prenez votre temps pour savourer distinctement ces nouvelles. Mon seul regret est d’avoir lu trop vite le recueil, les enchaînant les histoires sans respiration, ce qui a eu pour effet de mettre en évidence la technique d’écriture, gâchant mon innocence de lectrice.
18:47 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : annie saumont, nouvelles, lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
05/02/2012
Ragtime
EL Doctorow
Édition originale 1975
Première de mes lectures « Kindle », j’ai téléchargé Ragtime en version originale, manœuvre d’une simplicité déconcertante. Ce qui m’a permis de renouer avec un exercice que je n’avais plus commis depuis lurette, et ma foi, si mon rythme de lecture est moins rapide qu’en français, j’ai beaucoup apprécié l’usage de la liseuse électronique. La simplicité d’utilisation du dictionnaire intégré permet de ne pas vraiment interrompre le fil du texte. De même les fonctions surlignage et notes offrent la possibilité d’oublier crayon de papier, carnet ou post it qui me ramenaient (avec un certain contentement, je l’admets) aux années studieuses. L’objet est donc adopté, ce qui ne va évidemment pas m’aider à résoudre l’effondrement de la pile des livres-papier qui attendent patiemment leur tour…
La première impression produite à la lecture de Ragtime évoque la peinture, une fresque impressionniste et fourmillante d’une Amérique bouillonnante aux portes du XXème siècle.
Lentement, les chapitres initiaux du roman dressent une suite de petits tableaux dont on se dit d’abord qu’ils nous dépeignent, par le prisme d’une mosaïque, une société dynamique et novatrice, une représentation du rêve américain, d’autant que Doctorow renforce ces symboles de réussite en mêlant des personnages réels ( Freud , Houdini) à ceux qu’il crée de toutes pièces.… Le procédé intrigue et amuse, surtout quand le point de vue narratif situe le lecteur dans la réflexion du créateur : à maintes reprises, l’auteur précise par exemple qu’on ne sait pas grand chose des origines de certains personnages — Coalhouse ou Sarah par exemple— mais j’en retiendrais comme illustration plus évidente la dénomination des personnages centraux : en français Père, Mère, le plus jeune frère de Mère… sans indiquer jamais leur véritable nom. Ce procédé est intéressant en ce qu’il situe d’office le lecteur comme membre de cette famille nantie et bien installée d’une banlieue confortable de New York.
De fait, plus on avance dans le déroulement de la fresque, plus les fêlures de cette société idéale apparaissent : la marginalisation de certains personnages sert de ressort aux rencontres des protagonistes que tout oppose, comme Evelyn Nesbit, dont le sort est chamboulé par la jalousie de son mari. Elle est amenée à côtoyer d’abord un architecte de renommée internationale avant de se laisser fasciner par un artiste maudit, épisode qui la confronte à notre curieux plus jeune frère de Mère le temps d’une idylle invraisemblable, dont le descriptif initial est franchement hilarant et saugrenu. Le plus surprenant, et pas le moins intéressant réside dans l’évolution de la relation entre Evelyn et Emma Goldman, militante anarchiste dont la présence souligne à maintes reprises la complexité et la violence sous-jacente des rapports de classe dans cette Amérique laborieuse :
« In Seattle, for instance, Emma Goldman spoke to an IWW local and cited Evelyn Nesbit as a daughter of the working class whose life was a lesson in the way all daughters and sisters of poor men were used for the pleasure of the wealthy. »
Ces épiphénomènes de l’intrigue ne masquent pas le ton âpre de l’analyse sociale que dresse en fait E.L Doctorow : dès que nous faisons connaissance avec Tateh (prototype du Juif errant ?) et sa petite fille, l’écrivain aborde la description d’une société plus fragile, plus tendue, où les bouillonnements sociaux mènent aux grèves et aux affrontements répressifs. Et de fait, l’errance de Tateh et de sa fillette préfigure les crises sociales à venir. Le combat de Coalhouse Walker est emblématique du problème racial inhérent aux USA, question qui alimente d’ailleurs une bonne part de la créativité littéraire, musicale et cinématographique de ce vaste état. Sans avoir l’air d’y toucher, le sujet principal du roman s’organise autour de ce personnage apparemment si bien intégré, si raffiné. L’astuce de E L Doctorow consiste à le marginaliser à partir de ces qualités :
« It occured to Father one day that Coalhouse Walker Jr didn’t know he was a Negro. The more he thought about this the more true it seemed. Walker didn’t act or talk like a colored man. He seemed to be able to transform the customary deferences practiced by his race so that they reflected to his own dignity rather than the recepient’s … »
Effectivement le drame se noue à partir de cette appréciation fondamentale. Coalhouse ne peut supporter l’injure qui lui est faite par le biais de son automobile et la cécité de la société à l’égard des coupables est responsable du déchaînement de la violence aveugle qui s’ensuit.
Insensiblement, les touches impressionnistes de la première partie cèdent la place aux portraits plus sombres d’une société qui vit au bord d’un précipice. Dans la lumière, les avancées des progrès industriels, avec la longue description du réseau de transports desservant la mégapole, les expéditions polaires aux côtés de Peary comme vitrine de l’esprit pionnier, l’emballement du financier Pierpont Morgan à l’égard de l’industriel Henry Ford. Dans le clair obscur qui se dessine au-delà de ces épisodes, les luttes ouvrières, la misère sociale, la réalité d’une émigration qui ne trouve pas l’Eldorado promis, le racisme et les ostracismes de toutes sortes…
« Tracks ! tracks ! It seemed to the visionaries who wrote for the popular magazines that the future lay at the end of parallel rails. There were longdistance locomotive railroads and interurban electric railroads and streetrailways and elevated railroads, all laying their steel stripes on the land, crisscrossing like the texture of an indefatigable civilization… »
Au fil de ce récit pointilliste, E L doctorow ne cèle d’ailleurs aucunement ses prises de positions quant à la résolution sociale des heurts qu’il suggère, quitte à user d’une ironique naïveté.
« I do not think you can be so insolent as to beleive your achievements are the result only of your own effort. Did you attribute your success in this manner, I would warn you, sir, of the terrible price to be paid. … »
Malgré le resserrement progressif de l’intrigue vers le nœud final, Edgar Laurence Doctorow ne se fait pas le chantre de l’apocalypse. Il laisse même entrevoir une sorte de miracle de la rédemption quand nous retrouvons Tateh et sa fille bien des années après leur fuite. Doctorow s’amuse à brouiller les pistes, mais il soulève un coin de voile qui semble dire : mais oui, le rêve américain n’est pas mort, il y a un champ des possibles, même s’il ne garantit pas le Bonheur…
« When he was alone he reflected on his audacity. Sometimes he suffered periods of trembling in which he sat alone in his room smoking cigarettes without a holder, slumped and bent over in defeat like the old Tateh. But his new existence thrilled him. His whole personnality had turned outward and he had become a voluble and energetic man full of the future. He felt he deserved his happiness. He’d constructed it without help. »
Loin de conforter l’image rassurante des premiers chapitres, Ragtime nous mène progressivement à la lucidité poignante d’un monde aux portes de la Barbarie, qui se précise dans l’inévitable implication des États Unis dans le premier conflit mondial. Ce roman qui commence en 1902 par la description de la belle maison de New Rochelle s’achève sur des perspectives tout autres. Un récit passionnant, étonnant parfois, remarquable par l’acuité de son regard.
19:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, ebooks, ragtime, e l doctorow, littérature américaine, société, racisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/01/2012
Café-lecture
Bourgade provençale, Saint Maximin ne déroge pas à la tradition. Le coeur de l’agglomération reste la place Malherbe, à deux pas de la Basilique et des petites rues médiévales. Comme il se doit dans la région, cette grande esplanade, conçue en quadrilatère ouvert, est bordée d’immeubles sur trois côtés. La frontière avec l’artère principale qui forme le quatrième côté est symbolisée par une fontaine centrale à quatre pans, surmontée d’une colonne pyramidale. Parallèles, deux grandes allées de platanes centenaires ourlent les trottoirs principaux, diffusant l’été leur ombre bienveillante sur les terrasses des trois cafés où s’abreuve l’essentiel de la clientèle touristique. À cette époque de l’année, malgré la douceur relative de l’hiver, les commerces baissent leurs rideaux très tôt. Quand je suis descendue hier soir, seules les enseignes lumineuses et mobiles des deux pharmacies de la place indiquaient la persistance d’une activité au sein de la ville. Quelques minutes avant dix-neuf heures, le Malherbe et la Renaissance, les deux établissements qui se font face au début de la place s’étaient endormis sous les halos orangers des réverbères. Le bar-tabac du centre, quant à lui, témoignait d’une activité anémique, nourrie d’allées et venues furtives de fumeurs retardataires.
Au fond de la place toutefois, à l’angle du boulevard Bonfils et d’une minuscule ruelle à peine assez large pour les voitures, le Cercle Philharmonique est encore bien éclairé, derrière ses vitrines anciennes et sa porte vitrée. L’établissement paraît plus discret et vieillot que ses concurrents, à l’écart de l’activité générale.
Ce soir évidemment, personne ne s’attarde auprès des trois tables abandonnées sur le semblant de trottoir. Mais à l’intérieur, une curieuse mise en scène attire le regard; les guéridons marbrés ont été regroupés sur l’entrée de la salle et les côtés, ménageant un espace vide entre deux piliers centraux et le comptoir de bois. Trois tabourets hauts sont alignés sur cette scène symbolique. Aux tables disposées en amphithéâtre, les participants à la soirée s’attablent, se hèlent, se lèvent pour saluer de nouveaux arrivants ou des connaissances déjà installées. Intimidée, je m’avance néanmoins bravement et me sens soulagée d’y reconnaître aussitôt les trois habitués qui m’ont conviée ce soir… Ouf, je suis aussitôt invitée à partager leur table, je suis ravie de cet accueil amical.
Assise devant ma boisson, j’ai encore le loisir d’observer l’endroit avant le début de la séance. La salle est assez grande pour accueillir la quarantaine d’assistants qui prennent place peu à peu aux différentes tablées. L’espace ménagé devant le comptoir est assez large pour donner lieu à des allées et venues sans bousculade. Tout en conversant, j’observe le local, sensible à l’aspect désuet du décor : une salle rectangulaire au plafond bas, des éclairages sans âge diffusent une lumière jaune, chaleureuse. Seule concession à la modernité, un large écran plat surmonte la porte d’entrée vitrée ; pour le moment, il est éteint, ce qui me semble de bon augure. Mais je suppose immédiatement que les jours où l’OM est de match, les footeux locaux ont sans doute leurs sièges réservés.
À l’opposé, le comptoir de bois ferme la pièce. Derrière le meuble, un large miroir réfléchit les bouteilles et les verres, doublant d’office le volume des flacons dispensateurs de bienfaits. Le percolateur et ses interminables gargouillis complètent l’équipement des lieux. Une jeune femme brune officie seule, tranquille, elle ne se départ pas de son calme malgré l’afflux des commandes, l’assistance s’empressant de faire provision de boissons avant le début de la séance…
Sur les murs adjacents, huit immenses miroirs encadrés de bois dorés se renvoient les éclairages. Mes yeux reviennent inlassablement sur une dalle de marbre gravée entre les deux premiers miroirs du mur qui me fait face. Elle porte les noms des morts au combat de la grande guerre. Sur deux colonnes, trente-huit noms ont été ciselés et dorés en mémoire des enfants du pays. Pourtant, il y a bien un monument aux morts dans la commune. La redondance marquée par cette plaque me fait tout à coup réaliser que ce café, dans lequel il ne m’était jamais venu à l’idée d’entrer, n’est pas un lieu public ordinaire. Quelque chose d’indicible exsude de ces murs : cette salle est le refuge des natifs, leur privilège, le lieu de rencontre des familles-d’-ici, de génération en génération. D’ailleurs, à l’approche de la jeune femme qui introduit le débat, quelques résidents permanents, jusqu’alors ancrés au marbre de leur table, se lèvent sans discrétion et règlent leur consommation en marquant d’une certaine nonchalance leur réprobation de céder la place aux envahisseurs.
Car les intrus sont venus assister ici à une lecture.
À l'initiative du Jardin des Lettres, le Cercle Philharmonique de Saint Maximin héberge une fois par mois une lecture publique. Ces séances sont l’occasion de partager quelques pages d’un livre, souvent d’entendre l’auteur de l’œuvre choisie raconter lui-même les étapes de sa création, et poser sa propre voix sur ses mots…
Ce soir-là, l’auteur élu était René Frégni, écrivain presque local puisqu’il vit à Manosque, et se rend volontiers dans les institutions scolaires de toute la région pour participer à l’émulation des lecteurs en herbe.
René Frégni est un autodidacte, personnalité buissonnière écartelée entre vocation pour les mots, révélée tardivement, et volonté de transmettre, ce qui le conduit à animer des ateliers d’écriture jusque dans les prisons. Il aime d’ailleurs la fréquentation des marginaux délinquants, au point de s’être parfois laissé piéger par une ambiguïté créative. Personnage haut en couleurs, il est paraît-il grand séducteur devant l’Éternel et assez frondeur…
Malgré l’absence excusée de l’auteur, je me suis laissé séduire par les passages de son dernier roman, la fiancée des corbeaux. L’ouvrage appartient à sa veine quasi autobiographique et se présente sous forme d’un journal. Notre groupe de lecteurs s’est habilement réparti les interventions pour donner un souffle particulier aux évocations du récit, des réflexions intimistes sur la solitude du parent délaissé par le départ de sa fille, les joies simples de l’amitié, la beauté de la campagne du Verdon, la cocasserie de rencontres inattendues. Sa langue est souple et ronde, méditerranéenne quand elle sert les paysages et les voluptés gustatives. Nos intervenants l’ont habilement servi sans jamais forcer le ton, alternant voix féminines et masculines, au gré d’un récit qui ne vagabonde qu’en apparence.
René Frégni est l’auteur de nombreux romans, certains de la même veine personnelle, d’autres s’inscrivant dans le genre policier… Ce qui n’exclut pas une connaissance du terrain. René Frégni a même connu les affres du suspect et le raconte dans un roman intitulé Tu tomberas avec la nuit.
Quant à moi, ravie de mon escapade littéraire et de ce moment privilégié, je sais que je n’oublierai certes pas d’aller fureter plus avant dans l’œuvre de ce romancier, et je ne manquerai pour rien au monde le prochain rendez-vous du café-lecture.
18:58 Publié dans Blog, goutte à goutte, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : café lecture saint maximin la sainte baume, llittérature, lecture, lecture publique, saint maximin la sainte baume, rené frégni, le cercle philharmonique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
05/01/2012
Liseuse
Finies les parures de fêtes, hier j’ai définitivement rangé les décors du sapin et les santons de la crèche. Le temps des agapes est révolu, bulle de réjouissances crevée, parenthèse refermée, nous sommes rendus de force aux soucis d’un quotidien drapé dans sa morosité…

- Tiens, tu donnes dans le flashy, maintenant ?
- Eh oui, le High-tech tout gris, ça ressemble aux couleurs de ce début d’année: de l’énergie dépourvue d’optimisme… Alors, puisque Papa Noël a finalement déposé dans mes pantoufles MA liseuse, la couleur Barbie de l’étui ajoute cette pointe de fantaisie qui enveloppe les rêveries insouciantes et frivoles, enfin !!!…
- Ça ne te ressemble pas, m’a soufflé Nouchette, tu ne vas pas abandonner les vrais livres, les pages qu’on tourne, la couleur du papier, les formats d'éditions…
- Sans compter les libraires qui risquent d’y perdre plus que leurs âmes…
Un paradoxe de plus à assumer, cette liseuse me tentait bien. Depuis quelques mois, je furetais volontiers un peu partout en quête d’avis au sujet de ces tablettes miraculeuses. Pensez, des centaines, des milliers de livres à mots ouverts sous le miroir translucide d’un objet plus léger qu’un livre de poche !
Passant par l’une des enseignes spécialisées en produits High-tech, j’ai comparé de visu les dispositifs proposés. Effectivement, les tailles d’écran, leur système d’éclairage, l’exclusivité de la fonction… Quel dilemme ! Sans compter l’accès à la bibliothèque numérisée, l’étendue des données…
J’ai lu chez certaine geek audacieuse, que je fréquente parfois sur la blogosphère, une sourde rébellion contre les e-biblothèques, érigées en forteresses détentrices de droits et de formats et qui rendent leurs adeptes aussi prisonniers que ma p’te pomme et l’infernal itunes. Mais la question déborde largement les querelles de domaines réservés.
Les livres téléchargés via une plateforme électronique coûtent en moyenne 2/3 du prix d’un livre en version papier. Formidable pour tous les gros consommateurs, la différence de prix est substantielle. Le temps de téléchargement est ridicule, quasi instantané avec la liseuse que j’ai choisie, et donc j’ai le pouvoir de détenir une bibliothèque universelle… Sans compter la gratuité concernant les œuvres des écrivains tombées dans le domaine public : Tout Hugo et tout Balzac archivés le temps d’un clic. Ça donne envie de relire Loti, Jane Austen, Gide et Queffelec (Henri). Tiens, lui, il est passé de mode, il n’apparaît pas dans le répertoire du site.
Mais pour tous nos contemporains, qu’en sera-t-il en effet des droits d’auteur ?
Comment la filière de l’édition va-t-elle faire face à un marché qui a explosé cette année , comme en témoigne le volume des ventes de tablettes.
Entrevue dès 2004, la bataille juridique fait rage, de Princeton à Bruxelles, on réfléchit sur les droits des auteurs, les exigences éditoriales, les structures de l’accès à la numérisation.
Pour ma part, comme le suggérait Nouchette, je ne me vois pas renoncer totalement au contact physique du livre. Mais je sais aussi que nous ne cessons d’évoluer. Il y a vingt ou trente ans, nous n’imaginions pas l’omniprésence du téléphone portable dans nos vies. Aujourd’hui, Allo compte parmi les premiers mots de Mathis …
Encore une fois, c’est à chacun de nous qu’il revient de faire la part des choses: réserver la liseuse électronique aux œuvres plus anciennes, et il n’en manque pas ; continuer de rendre visite à la librairie du quartier en préservant la solidarité du lien humain dans notre environnement géographique.
Le débat est ouvert, la solution nous appartient. Ce monde où nous vivons, après tout est le nôtre.
N’empêche, elle est pas belle ma Kindle ????
,
17:37 Publié dans goutte à goutte, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livres, libraires, liseuse électronique, débat des éditeurs, des libraires, ebooks, e livres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer