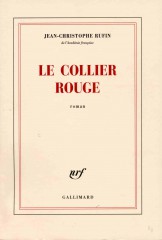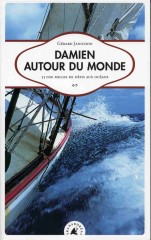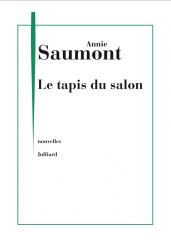10/06/2014
Le collier rouge
Le collier rouge
Jean-Christophe Rufin
Gallimard (NRF) 2014
ISBN :978-2-07-013797-8
Avec ce roman, qui pourrait paraître court, Jean Christophe Ruffin revient à la fiction. En réalité, malgré la limpidité de son écriture, le sujet traité ici est dense. Si l’on peut se méfier de l’effet tendance qui consiste à projeter les intrigues sur le centenaire de la déclaration de la première guerre mondiale, Jean Christophe Rufin nous entraîne très vite à la recherche de la Vérité, celle qui ne s’expose pas aux regards de témoins omniscients mais qui motive profondément certains actes aussi impulsifs qu’insensés. Cette quête universelle et intemporelle est menée ici par le juge militaire Hugues Lantier du Grez , qui entend résoudre sa dernière affaire en tant qu’officier, avant de réintégrer la vie civile. C’est dire que sa conscience professionnelle est composée de rigueur et de respect des valeurs de sa classe, autant que d’une lassitude morale, maladie contractée à force d’examiner les dossiers de pauvres diables ayant subi l’enfer des tranchées pendant quatre longues années.
Au cours de l’été 1919, le Commandant Lantier débarque donc dans une petite bourgade berrichonne endormie sous la chaleur. Seuls les aboiements désespérés d’un chien perturbent la léthargie de la petite ville. À l’intérieur de la caserne désaffectée, un gardien veille l’unique prisonnier du lieu. Cet homme mutique doit répondre d’une agression inexplicable dont la nature ne nous sera révélée que bien plus tard. Mais la curiosité du juge militaire concerne le curieux rapports établis entre Morlac, ce paysan taiseux revenu dans sa région, et son chien manifestant une fidélité exemplaire. Pourquoi et comment cet animal, devenu tout au long du conflit la mascotte des bataillons où son maître était envoyé, a-t-il pu susciter sa haine? Pourquoi cet homme est-il revenu de son propre chef dans son village, en évitant de rentrer chez lui, de retrouver sa ferme, de se jeter dans les bras de sa femme et de son fils ?
Menée comme une intrigue policière, la recherche des motifs de l’étrange comportement du prisonnier met l’accent sur les difficultés de réinsertion de ces hommes traumatisés par leur vécu. Rufin ne joue pas la carte du misérabilisme ni de la culpabilité sociale et politique, mais laisse percevoir à travers l’obstination du juge, combien il devient nécessaire de gratter délicatement les défenses acquises par ces hommes qui ont compris qu’ils avaient été floués, qu ’on avait joué de leurs vies et de leurs sorts pour servir des intérêts abscons.
Rufin nous offre un étonnant argumentaire du juge, qui propose à l’homme d’abandonner les charges, ce que l’accusé récuse. Il n’entend pas se dérober à la sentence qu’il croit mériter. Car le commandant découvre peu à peu que l’accusé n’est pas le paysan analphabète qu’il avait cru devoir juger. Et puis ce chien qui se tient obstinément aux abords de la place, qui meurt de faim, de soif et d’épuisement malgré les soins empathiques de certains villageois, ce fidèle compagnon devient un personnage à part entière et Lantier devine que le canidé détient la clé de l’affaire. Finalement, après bien des détours autour du personnage, c’est au long d’une enquête « à la Maigret », reposant sur les menues confidences recueillies dans le village, que l’officier parvient à saisir qui est Morlac, et quels sont les vraies raisons de ses agissements. Le lecteur n’attend pas de Jean-Christophe Rufin une autre vision que celle d’un humaniste. Et ce sera la toute dernière joute reposant la sentence qu’il confie à son juge. « En tous cas, conclut Lantier d’une voix ferme, je ne serai pas complice de votre provocation. Puisqu’on attend de moi que je vous punisse, je sais quel châtiment je vais vous infliger. C’est celui qui fera le plus de mal à votre orgueil. Vous allez la voir et l’entendre. L’entendre jusqu’au bout et mesurer votre erreur. « (page 149)
Un beau roman humaniste et touchant, un de ceux que l’on regrette de refermer, et qui ne pèsera pas lourd dans vos bagages de l’été.
12:12 Publié dans goutte à goutte, Livre, Source de jouvence | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, notes de lectures, roman, jean christophe rufin, fidélité, roman sur la guerre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
28/02/2013
À la pointe de la technologie…
Pour faire bref, je vous convie à jeter un petit coup d'oeil sur la vidéo en lien.
Cette présentation concise et illustrée d'un concept révolutionnaire vous apportera un réel confort pour meubler le prochain week-end neigeux…
Très bonne journée à toutes mes discrètes- souris- fidèles…
http://youtu.be/Q_uaI28LGJkhttp://youtu.be/Q_uaI28LGJk
11:41 Publié dans Blog, goutte à goutte | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, vidéo, défense des libraires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
23/02/2013
L'inespérée
L’inespérée, comme le titre du dernier des 11 textes qui composent ce recueil. N’allez pas en déduire que le lecteur s’ennuie, loin de là. Christian Bobin entretient une conversation intime et aérienne avec les lecteurs qui ouvrent leurs cœurs à l’ami. Les mots fraient ici, comme dans toutes ses œuvres, un sillon subtil que vous empruntez à votre tour, comme il vous convient. Jamais vous n’ouvrez un volume signé de ce poète pour combler un moment de désoeuvrement. Il en va de Bobin comme de Schubert, ce sont des enchanteurs du cœur, que l’on invite pour la couleur de l’âme dont il propose le partage. Si donc vous cherchez paillettes et dépaysement, passez votre chemin…
Or, si votre humeur est à l’écoute, vous entrez à mots de velours dans le murmure des confidences que l’auteur livre au fil des pages, comme autant de lettres adressées à l’Ami, celui ou celle qui comprend les nuances des émotions et la fragilité des aveux.
« La beauté, madame, n’a d’autre cœur que le vôtre, glisse –t-il dans sa lettre à la lumière qui traînait dans les rues du Creusot…, Nous ne cherchons tous qu’une seule chose dans cette vie : être comblé par elle— recevoir le baiser d’une lumière sur notre cœur gris, connaître la douceur d’un amour sans déclin. » ( Pages 11-12 de l’édition Folio.)
Le second texte, le mal, commence par une longue diatribe contre la télévision et son « règne en vertu d’une attirance éternelle vers le bas, vers le noir du temps.(…) On appelle ça une fenêtre sur le monde, mais c’est, plus qu’une fenêtre, le monde en son bloc, les détritus du monde versés à chaque seconde sur la moquette du salon. (…) Alors qu’est-ce qu’il faut faire avec la vieille gorgée d’images, torchée de sous ? Rien. Il ne faut rien faire. Elle est là, de plus en plus folle, malade à l’idée qu’un jour elle pourrait ne plus séduire »…
La traversée des images nous convie à poser notre regard sur la profondeur de nos motivations : « Vous arrivez là comme vous arrivez partout, avec l’impatience de repartir bientôt. C’est une infirmité que vous avez de ne pouvoir envisager un voyage autrement que comme un détour pour aller de chez vous à chez vous.(…)Vous n’avez jamais deviné vers quoi pouvaient aller les phrases écrites, l’encre répandue comme du parfum sur la chair de papier blanc. C’est pour parler de ça que vous alliez en Haute-Savoie, voir cet écrivain que vous aimez sans encore l’avoir rencontré. Et bien sûr les choses se passent autrement que prévu »…( Page 31)
Permettez-moi une halte prolongée sur ce texte, car bien sûr, voilà qu’il me parle du fond des choses : « Comment c’est, un écrivain, dans votre tête : étrange à dire, mais ce n’est pas d’abord lié à l’écriture. Un écrivain c’est quelqu’un qui se bat avec l’ange de sa solitude et de sa vérité. Une lutte confuse, sans nette conclusion.(…) Il vous est arrivé de rencontrer des personnes bouleversées par leur propre parole. Leur conversation irradiait une intelligence vraie, non convenue, et quand ces gens entreprenaient d’écrire, plus rien : comme si la peur de mal écrire et la croyance qu’il y a des règles leur faisaient perdre d’un seul coup toute vérité personnelle. Ces gens, vous les reconnaissez comme d’authentiques écrivains. Ce n’est pas l’encre qui fait l’écriture, c’est la voix, la vérité solitaire de la voix, l’hémorragie de vérité au ventre de la voix. » (Page 33)
De ces vérités personnelles et structurantes, il est question encore dans l’approche de l’innocence du thé sans thé et d’une fête sur les hauteurs. Bobin débusque toujours la part des faux-semblants et de l’ajustement nécessaire propre à ceux que ne guident aucun intérêt. Il a, pour décrire ces rencontres inattendues, des images ciselées inoubliables : « Elle parle et vous écoutez ce gravier d’étoiles crissant dedans sa voix. » L’auteur ne se dédit pas quand il poursuit sa réflexion dans j’espère que mon cœur tiendra sans craquelure : « « Parler de peinture, ce n’est pas comme parler de littérature. C’est beaucoup plus intéressant. Parler de peinture c’est très vite en finir avec la parole, très vite revenir au silence. Un peintre c’est quelqu’un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence. » ( Page 63)
Observer et transcrire en poète n’empêche pas d’exercer son regard avec lucidité. Christian Bobin se fait plus incisif dès lors qu’il se penche sur le sort éphémère de l’amour, ou plutôt des amours communes auxquelles nous nous accrochons : « dans les histoires d’amour, il n’y a que des histoires, jamais d’amour. Si je regarde autour de moi, qu’est-ce que je vois : des morts ou des blessés. Des couples qui prennent leur retraite à trente ans ou qui font carrière dans la souffrance.( Page 83 la retraite à trente ans)
Alors, au bout du compte, arrive cette déclaration d’amour à l’Inespérée, à la présence plus forte que tous les éloignements : « Cela fait bien longtemps que je ne sors plus sans toi. Je t’emporte dans la plus simple cachette qui soit : je te cache dans ma joie comme une lettre en plein soleil. » La nature de l’amour réside dans une quête d’absolu, où il s’avère que « les mots sont en retard sur nos vies. Tu as toujours été en avance sur ce que j’espérais de toi. Tu as depuis toujours été l’inespérée. » Nous pouvons enfin comprendre la nature de la révélation, qui tient plus à l’aimant qu’à l’aimé : « L’enfer c’est cette vie quand nous ne l’aimons plus. Une vie sans amour est une vie abandonnée, bien plus abandonné qu’un mort. » (Page 115)
L’écriture de Christian Bobin n’est jamais docte. S’il touche à nos émotions, ce n’est pas par souci d’esthétisme, ses flèches sont décochées pour mettre à jour nos vérités profondes, que l’on se cache parfois par pudeur de soi ou peur des autres, peur du jugement ou de n’être pas à la hauteur… Le plus beau cadeau qu’un tel écrivain offre à son public ne se niche-t--il pas dans le pari de son authenticité ?
19:41 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian bobin, écriture, lecture, poésie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/10/2012
"Damien" autour du monde
Gérard Janichon
Édition Transboréal, collection sillages.
Réédition 2010
Première parution 1998
ISBN : 978-2-913955-86-8
Envie de vous évader un peu de la grisaille ambiante, des embouteillages routiers, des perspectives misérabilistes dont on nous rebat les oreilles ? Ménagez-vous alors un bon moment car l’embarquement sur le « Damien » est un voyage au long cours : « 55 000 milles de défis aux océans » selon le sous-titre que Gérard Janichon a donné à son récit. Sans compter les 50 pages d’appendices techniques qui ne manquent pas d’intérêt une fois que l’on s’est accroché aux aventures du binôme, le récit de Janichon s’étale sur 609 pages … Le temps ne compte pas quand on aime !
En réalité, l’entreprise n’est pas récente et cette troisième édition nous offre l’occasion de remonter dans le temps, pour constater in petto que malgré les avancées technologiques qui ont marqué les quarante années qui nous séparent de leur départ mythique, le décalage entre les partants et les restants n’a rien perdu de son acuité, de sa véracité. C’est pourquoi Gérard Janichon ajoute en guise de post-face ces vers de Paul Fort :
Ils ont choisi la mer,
Ils ne reviendront plus.
Et même s’ils reviennent,
Les reconnaîtrez-vous ?
La mer les a marqués
Avant de vous les rendre.
C’est l’aveu final qui conclut effectivement la relation de ce voyage extraordinaire.
Et l’on mesurera d’abord la teneur du défi en suivant l’élaboration du projet : Ces copains grenoblois n’étaient pas prédisposés à se retrouver en équipage sur les mers du monde, entre les deux pôles ! Mais les rêves poussent certains avec une force insoupçonnable. Les garçons ont conçu leur dessein au cours de leurs années lycée, et c’est planche par planche qu’ils ont conquis à la sueur de petits boulots annexes le droit de réaliser l’épopée. Il leur a fallu quelques années pour fabriquer leur voilier, grâce à certaines amitiés gagnées par la ténacité du trio de départ. Ils se sont donné des contraintes de raison, ont étudié la faisabilité (l’affreux vocable), ont cherché maints et maints soutiens, ont osé innover, ont beaucoup lu, et se sont quand même entraîné entre la Rochelle et les îles vendéennes à la maîtrise des manœuvres.
Vint le jour J. Je n’ambitionne pas de vous rapporter leur périple par le menu… C’est autrement captivant de suivre ces aventures par les mots de celui qui les a vécus. Mais une fois embarqués vers le Spitzberg et les premières glaces, attendez-vous à partager les veilles des quarts solitaires sous les aurores boréales, à découvrir l’hospitalité des gens de mer et les rencontres hasardeuses. Étonnez-vous des difficultés de navigation lors de la remontée de l’Amazone, constatez les bienfaits du rhum qui coule abondamment à bord et surtout, sautez de joie et de soulagement quand les deux rescapés du Cap Horn sortent enfin du chavirage au large de la Géorgie du Sud, territoire hostile dont je n’avais même pas idée avant de plonger dans les péripéties de ce tour du monde.
Voilà un récit de voyage qui ne sent pas l’esbroufe et l’appel des caméras. L’édition est agrémentée de cartes « à main levée » et de quelques photos au centre de l’ouvrage, comme une respiration entre les deux hémisphères, le temps de reprendre souffle par cette escale visuelle.
Bonne lecture et bon vent…
19:59 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, récit, voilier, tour du monde, lecture, gérard janichon, jérôme poncet, édition transboréal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
24/02/2012
Le tapis du salon
Annie Saumont
Julliard 2012
ISBN : 978-2-260-01997-8
À sa manière discrète, Annie Saumont occupe le territoire des Lettres Françaises avec une indéfectible constance. Depuis les années 60, elle s’est imposé en donnant à la Nouvelle la reconnaissance d’un réel genre littéraire. Ce qui n’a rien d’évident au pays de l’Académie française, où la tentation est grande de minimiser ce mode narratif.
Une fois de plus, Annie Saumont démontre comment la Nouvelle repose sur la concision extrême du récit. Loin de tronquer l’intrigue ou de simplifier la psychologie des personnages, elle aiguise avec une acuité particulière les mots qui déroulent son histoire. Elle nous livre ici un recueil composé d’une vingtaine de nouvelles rassemblées sous ce titre, le tapis du salon, qui intitule également trois des pièces de l’ouvrage.
Des histoires brèves certes, aux horizons divers. Mais c’est surtout le ton adopté par l’auteure, et son style haché, elliptique jusqu’au système, qui définit l’unicité du recueil. En réalité Annie Saumont traque dans un dédale d’objets anodins ou de faits mesquins le détail qui scelle le sort de ses personnages. Elle dresse par exemple dans la mort du poisson rouge, une atmosphère de sérénité champêtre, où de charmantes familles divertissent leurs non moins charmants bambins en leur offrant un poisson rouge. :
« Calme journée. Pas un souffle de vent.
Mélanie et Antoine sont au jardin. Ce pourrait être la première phrase du premier conte d’un premier livre de lecture.
Mélanie arrache une herbe folle. Antoine écrase du pied une motte de terre grasse.
Pas le moindre frémissement des rideaux à la fenêtre du salon qu’Antoine a ouverte après le petit-déjeuner.… »
En quelques pages, nous identifions trois familles sans histoires, si ce n’est celles de nos quotidiens, myopie de la tendresse parentale et éclairage malicieux des inventions enfantines, jusqu’à ce jeu…
« On joue à la fin du monde ?
Quand le jeu a commencé, si on dit pouce c’est de la triche.
Fallait réfléchir avant.
Fallait dire non pour les cow-boys, la balançoire.
T’as dit oui pour la fin du monde. On continue. »
Une pirouette, un battement de cils plus tard, l’Éden est soufflé par un vent d’apocalypse, qui secoue le lecteur et bouscule l’ordonnance de ce petit monde trop bien léché.
Parfait exemple de cet art de l’ellipse, le début de Quartiers d’automne
« Promenade-danse. Danse-promenade. Le parc est vert. Quatre danseurs ont monté un ballet. Pas vraiment un ballet, des séquences. Ici et là.
Il y a notre petite Ida.
Pelouse. Arbres. Un épicéa. Un sophora-pleureur. Un saule. »
On entre ainsi par le décor dans la quête des personnages qui se cherchent, s’épient, se débattent contre le mal-être, l’absurdité, la méchanceté, la perversité des situations.
Annie Saumont adore avancer sans avoir l’air d’y toucher.
Elle privilégie volontiers les situations où la rumeur et le non-dit travaillent en minant le terrain à l’insu du personnage central. À cet égard, les trois nouvelles qui portent le titre générique sont exemplaires.
Dans la première, c’est un pauvre gosse, le narrateur, recueilli par Yole et Sarie, qui élèvent comme elles peuvent leur petit cousin orphelin. Le tapis offert par l’amoureux de Sarie est trop beau pour la modeste maison. Bien encombrant. Un vrai piège. On le range et on l’oublie… Mais un jour, le narrateur qui a bien grandi, retrouve ses deux cousines enveloppées dans le tapis…
La seconde de ces nouvelles consacrées au tapis du salon repose sur une inadéquation de situation similaire. Le narrateur est élevé par sa sœur Isa, faute d’un père capable d’assumer son veuvage. Par les mots de ce gamin à la vie rustique, on saisit combien la sœur aînée tente d’organiser leur vie et de s’ouvrir un avenir, jusqu’au jour où l’adolescent mal dégauchi tache le tapis… La chute tombe comme un couperet, rapide et impitoyable.
Ma préférée à cet égard reste la seconde, intitulée vacances…
Il vous reste à entrer à pas légers dans ces tranches de vie esquissées à traits vifs et rapides, comme ces croquis au charbon ou à la sanguine qui servent d’étude du sujet. Et vous découvrez que l’esquisse transmet plus de force que la peinture bien léchée.
Mais surtout prenez votre temps pour savourer distinctement ces nouvelles. Mon seul regret est d’avoir lu trop vite le recueil, les enchaînant les histoires sans respiration, ce qui a eu pour effet de mettre en évidence la technique d’écriture, gâchant mon innocence de lectrice.
18:47 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : annie saumont, nouvelles, lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
05/02/2012
Ragtime
EL Doctorow
Édition originale 1975
Première de mes lectures « Kindle », j’ai téléchargé Ragtime en version originale, manœuvre d’une simplicité déconcertante. Ce qui m’a permis de renouer avec un exercice que je n’avais plus commis depuis lurette, et ma foi, si mon rythme de lecture est moins rapide qu’en français, j’ai beaucoup apprécié l’usage de la liseuse électronique. La simplicité d’utilisation du dictionnaire intégré permet de ne pas vraiment interrompre le fil du texte. De même les fonctions surlignage et notes offrent la possibilité d’oublier crayon de papier, carnet ou post it qui me ramenaient (avec un certain contentement, je l’admets) aux années studieuses. L’objet est donc adopté, ce qui ne va évidemment pas m’aider à résoudre l’effondrement de la pile des livres-papier qui attendent patiemment leur tour…
La première impression produite à la lecture de Ragtime évoque la peinture, une fresque impressionniste et fourmillante d’une Amérique bouillonnante aux portes du XXème siècle.
Lentement, les chapitres initiaux du roman dressent une suite de petits tableaux dont on se dit d’abord qu’ils nous dépeignent, par le prisme d’une mosaïque, une société dynamique et novatrice, une représentation du rêve américain, d’autant que Doctorow renforce ces symboles de réussite en mêlant des personnages réels ( Freud , Houdini) à ceux qu’il crée de toutes pièces.… Le procédé intrigue et amuse, surtout quand le point de vue narratif situe le lecteur dans la réflexion du créateur : à maintes reprises, l’auteur précise par exemple qu’on ne sait pas grand chose des origines de certains personnages — Coalhouse ou Sarah par exemple— mais j’en retiendrais comme illustration plus évidente la dénomination des personnages centraux : en français Père, Mère, le plus jeune frère de Mère… sans indiquer jamais leur véritable nom. Ce procédé est intéressant en ce qu’il situe d’office le lecteur comme membre de cette famille nantie et bien installée d’une banlieue confortable de New York.
De fait, plus on avance dans le déroulement de la fresque, plus les fêlures de cette société idéale apparaissent : la marginalisation de certains personnages sert de ressort aux rencontres des protagonistes que tout oppose, comme Evelyn Nesbit, dont le sort est chamboulé par la jalousie de son mari. Elle est amenée à côtoyer d’abord un architecte de renommée internationale avant de se laisser fasciner par un artiste maudit, épisode qui la confronte à notre curieux plus jeune frère de Mère le temps d’une idylle invraisemblable, dont le descriptif initial est franchement hilarant et saugrenu. Le plus surprenant, et pas le moins intéressant réside dans l’évolution de la relation entre Evelyn et Emma Goldman, militante anarchiste dont la présence souligne à maintes reprises la complexité et la violence sous-jacente des rapports de classe dans cette Amérique laborieuse :
« In Seattle, for instance, Emma Goldman spoke to an IWW local and cited Evelyn Nesbit as a daughter of the working class whose life was a lesson in the way all daughters and sisters of poor men were used for the pleasure of the wealthy. »
Ces épiphénomènes de l’intrigue ne masquent pas le ton âpre de l’analyse sociale que dresse en fait E.L Doctorow : dès que nous faisons connaissance avec Tateh (prototype du Juif errant ?) et sa petite fille, l’écrivain aborde la description d’une société plus fragile, plus tendue, où les bouillonnements sociaux mènent aux grèves et aux affrontements répressifs. Et de fait, l’errance de Tateh et de sa fillette préfigure les crises sociales à venir. Le combat de Coalhouse Walker est emblématique du problème racial inhérent aux USA, question qui alimente d’ailleurs une bonne part de la créativité littéraire, musicale et cinématographique de ce vaste état. Sans avoir l’air d’y toucher, le sujet principal du roman s’organise autour de ce personnage apparemment si bien intégré, si raffiné. L’astuce de E L Doctorow consiste à le marginaliser à partir de ces qualités :
« It occured to Father one day that Coalhouse Walker Jr didn’t know he was a Negro. The more he thought about this the more true it seemed. Walker didn’t act or talk like a colored man. He seemed to be able to transform the customary deferences practiced by his race so that they reflected to his own dignity rather than the recepient’s … »
Effectivement le drame se noue à partir de cette appréciation fondamentale. Coalhouse ne peut supporter l’injure qui lui est faite par le biais de son automobile et la cécité de la société à l’égard des coupables est responsable du déchaînement de la violence aveugle qui s’ensuit.
Insensiblement, les touches impressionnistes de la première partie cèdent la place aux portraits plus sombres d’une société qui vit au bord d’un précipice. Dans la lumière, les avancées des progrès industriels, avec la longue description du réseau de transports desservant la mégapole, les expéditions polaires aux côtés de Peary comme vitrine de l’esprit pionnier, l’emballement du financier Pierpont Morgan à l’égard de l’industriel Henry Ford. Dans le clair obscur qui se dessine au-delà de ces épisodes, les luttes ouvrières, la misère sociale, la réalité d’une émigration qui ne trouve pas l’Eldorado promis, le racisme et les ostracismes de toutes sortes…
« Tracks ! tracks ! It seemed to the visionaries who wrote for the popular magazines that the future lay at the end of parallel rails. There were longdistance locomotive railroads and interurban electric railroads and streetrailways and elevated railroads, all laying their steel stripes on the land, crisscrossing like the texture of an indefatigable civilization… »
Au fil de ce récit pointilliste, E L doctorow ne cèle d’ailleurs aucunement ses prises de positions quant à la résolution sociale des heurts qu’il suggère, quitte à user d’une ironique naïveté.
« I do not think you can be so insolent as to beleive your achievements are the result only of your own effort. Did you attribute your success in this manner, I would warn you, sir, of the terrible price to be paid. … »
Malgré le resserrement progressif de l’intrigue vers le nœud final, Edgar Laurence Doctorow ne se fait pas le chantre de l’apocalypse. Il laisse même entrevoir une sorte de miracle de la rédemption quand nous retrouvons Tateh et sa fille bien des années après leur fuite. Doctorow s’amuse à brouiller les pistes, mais il soulève un coin de voile qui semble dire : mais oui, le rêve américain n’est pas mort, il y a un champ des possibles, même s’il ne garantit pas le Bonheur…
« When he was alone he reflected on his audacity. Sometimes he suffered periods of trembling in which he sat alone in his room smoking cigarettes without a holder, slumped and bent over in defeat like the old Tateh. But his new existence thrilled him. His whole personnality had turned outward and he had become a voluble and energetic man full of the future. He felt he deserved his happiness. He’d constructed it without help. »
Loin de conforter l’image rassurante des premiers chapitres, Ragtime nous mène progressivement à la lucidité poignante d’un monde aux portes de la Barbarie, qui se précise dans l’inévitable implication des États Unis dans le premier conflit mondial. Ce roman qui commence en 1902 par la description de la belle maison de New Rochelle s’achève sur des perspectives tout autres. Un récit passionnant, étonnant parfois, remarquable par l’acuité de son regard.
19:15 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, ebooks, ragtime, e l doctorow, littérature américaine, société, racisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/01/2012
Café-lecture
Bourgade provençale, Saint Maximin ne déroge pas à la tradition. Le coeur de l’agglomération reste la place Malherbe, à deux pas de la Basilique et des petites rues médiévales. Comme il se doit dans la région, cette grande esplanade, conçue en quadrilatère ouvert, est bordée d’immeubles sur trois côtés. La frontière avec l’artère principale qui forme le quatrième côté est symbolisée par une fontaine centrale à quatre pans, surmontée d’une colonne pyramidale. Parallèles, deux grandes allées de platanes centenaires ourlent les trottoirs principaux, diffusant l’été leur ombre bienveillante sur les terrasses des trois cafés où s’abreuve l’essentiel de la clientèle touristique. À cette époque de l’année, malgré la douceur relative de l’hiver, les commerces baissent leurs rideaux très tôt. Quand je suis descendue hier soir, seules les enseignes lumineuses et mobiles des deux pharmacies de la place indiquaient la persistance d’une activité au sein de la ville. Quelques minutes avant dix-neuf heures, le Malherbe et la Renaissance, les deux établissements qui se font face au début de la place s’étaient endormis sous les halos orangers des réverbères. Le bar-tabac du centre, quant à lui, témoignait d’une activité anémique, nourrie d’allées et venues furtives de fumeurs retardataires.
Au fond de la place toutefois, à l’angle du boulevard Bonfils et d’une minuscule ruelle à peine assez large pour les voitures, le Cercle Philharmonique est encore bien éclairé, derrière ses vitrines anciennes et sa porte vitrée. L’établissement paraît plus discret et vieillot que ses concurrents, à l’écart de l’activité générale.
Ce soir évidemment, personne ne s’attarde auprès des trois tables abandonnées sur le semblant de trottoir. Mais à l’intérieur, une curieuse mise en scène attire le regard; les guéridons marbrés ont été regroupés sur l’entrée de la salle et les côtés, ménageant un espace vide entre deux piliers centraux et le comptoir de bois. Trois tabourets hauts sont alignés sur cette scène symbolique. Aux tables disposées en amphithéâtre, les participants à la soirée s’attablent, se hèlent, se lèvent pour saluer de nouveaux arrivants ou des connaissances déjà installées. Intimidée, je m’avance néanmoins bravement et me sens soulagée d’y reconnaître aussitôt les trois habitués qui m’ont conviée ce soir… Ouf, je suis aussitôt invitée à partager leur table, je suis ravie de cet accueil amical.
Assise devant ma boisson, j’ai encore le loisir d’observer l’endroit avant le début de la séance. La salle est assez grande pour accueillir la quarantaine d’assistants qui prennent place peu à peu aux différentes tablées. L’espace ménagé devant le comptoir est assez large pour donner lieu à des allées et venues sans bousculade. Tout en conversant, j’observe le local, sensible à l’aspect désuet du décor : une salle rectangulaire au plafond bas, des éclairages sans âge diffusent une lumière jaune, chaleureuse. Seule concession à la modernité, un large écran plat surmonte la porte d’entrée vitrée ; pour le moment, il est éteint, ce qui me semble de bon augure. Mais je suppose immédiatement que les jours où l’OM est de match, les footeux locaux ont sans doute leurs sièges réservés.
À l’opposé, le comptoir de bois ferme la pièce. Derrière le meuble, un large miroir réfléchit les bouteilles et les verres, doublant d’office le volume des flacons dispensateurs de bienfaits. Le percolateur et ses interminables gargouillis complètent l’équipement des lieux. Une jeune femme brune officie seule, tranquille, elle ne se départ pas de son calme malgré l’afflux des commandes, l’assistance s’empressant de faire provision de boissons avant le début de la séance…
Sur les murs adjacents, huit immenses miroirs encadrés de bois dorés se renvoient les éclairages. Mes yeux reviennent inlassablement sur une dalle de marbre gravée entre les deux premiers miroirs du mur qui me fait face. Elle porte les noms des morts au combat de la grande guerre. Sur deux colonnes, trente-huit noms ont été ciselés et dorés en mémoire des enfants du pays. Pourtant, il y a bien un monument aux morts dans la commune. La redondance marquée par cette plaque me fait tout à coup réaliser que ce café, dans lequel il ne m’était jamais venu à l’idée d’entrer, n’est pas un lieu public ordinaire. Quelque chose d’indicible exsude de ces murs : cette salle est le refuge des natifs, leur privilège, le lieu de rencontre des familles-d’-ici, de génération en génération. D’ailleurs, à l’approche de la jeune femme qui introduit le débat, quelques résidents permanents, jusqu’alors ancrés au marbre de leur table, se lèvent sans discrétion et règlent leur consommation en marquant d’une certaine nonchalance leur réprobation de céder la place aux envahisseurs.
Car les intrus sont venus assister ici à une lecture.
À l'initiative du Jardin des Lettres, le Cercle Philharmonique de Saint Maximin héberge une fois par mois une lecture publique. Ces séances sont l’occasion de partager quelques pages d’un livre, souvent d’entendre l’auteur de l’œuvre choisie raconter lui-même les étapes de sa création, et poser sa propre voix sur ses mots…
Ce soir-là, l’auteur élu était René Frégni, écrivain presque local puisqu’il vit à Manosque, et se rend volontiers dans les institutions scolaires de toute la région pour participer à l’émulation des lecteurs en herbe.
René Frégni est un autodidacte, personnalité buissonnière écartelée entre vocation pour les mots, révélée tardivement, et volonté de transmettre, ce qui le conduit à animer des ateliers d’écriture jusque dans les prisons. Il aime d’ailleurs la fréquentation des marginaux délinquants, au point de s’être parfois laissé piéger par une ambiguïté créative. Personnage haut en couleurs, il est paraît-il grand séducteur devant l’Éternel et assez frondeur…
Malgré l’absence excusée de l’auteur, je me suis laissé séduire par les passages de son dernier roman, la fiancée des corbeaux. L’ouvrage appartient à sa veine quasi autobiographique et se présente sous forme d’un journal. Notre groupe de lecteurs s’est habilement réparti les interventions pour donner un souffle particulier aux évocations du récit, des réflexions intimistes sur la solitude du parent délaissé par le départ de sa fille, les joies simples de l’amitié, la beauté de la campagne du Verdon, la cocasserie de rencontres inattendues. Sa langue est souple et ronde, méditerranéenne quand elle sert les paysages et les voluptés gustatives. Nos intervenants l’ont habilement servi sans jamais forcer le ton, alternant voix féminines et masculines, au gré d’un récit qui ne vagabonde qu’en apparence.
René Frégni est l’auteur de nombreux romans, certains de la même veine personnelle, d’autres s’inscrivant dans le genre policier… Ce qui n’exclut pas une connaissance du terrain. René Frégni a même connu les affres du suspect et le raconte dans un roman intitulé Tu tomberas avec la nuit.
Quant à moi, ravie de mon escapade littéraire et de ce moment privilégié, je sais que je n’oublierai certes pas d’aller fureter plus avant dans l’œuvre de ce romancier, et je ne manquerai pour rien au monde le prochain rendez-vous du café-lecture.
18:58 Publié dans Blog, goutte à goutte, Livre, Loisirs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : café lecture saint maximin la sainte baume, llittérature, lecture, lecture publique, saint maximin la sainte baume, rené frégni, le cercle philharmonique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
28/09/2011
Urgences
Urgences:

Comme la visite nocturne des services hospitaliers de Brignoles, où les épanchements du nez de GéO nous ont menés la semaine dernière. Heureusement, ce n’était pas trop grave et le vaillant sourire de Marie-Ange nous a promptement réconfortés. Débarrassé des deux énormes mèches qui obstruaient ses narines, GéO a retrouvé avec bonheur sa liberté de respiration… Il n’en apprécie que mieux LA VIE qui va…
Urgences
Comme ces alarmes qui résonnent dans toutes nos actualités…
Que penser de ces affligeantes nouvelles concernant une juge dessaisie ici d’une affaire mettant en cause des privilégiés, un procureur soupçonné de collusion là où les affaires sentent la corruption des états ? Le président de l’USM, principal syndicat de magistrats, exprime leur consternation « de voir la justice se poursuivre elle-même et de l'image ainsi donnée du parquet, censé représenter la société. « ( citation du site de USM). Pis encore, Christophe Régnard souligne la dérive de la sacro-sainte indépendance de la justice face au politique dans une interview ce midi sur France Inter. Dans un pays qui se prétend toujours être le champion des droits de l’Homme, ce constat est accablant, angoissant, mortifère. Mes gouttesdo n’ont aucune prétention politique ni même philosophique, vous le savez bien, mais il me semble bien n’être pas la seule à comprendre à quel point notre société vit un tournant de civilisation. Jusqu’où la corde des désillusions va-t-elle se tendre, avant que le dégoût et la désespérance ne ruinent notre vivre ensemble ?
J’en tiens un petit exemple sous la main…Ou plutôt sous le clavier.
Hier soir, je vous ai posté une note de lecture (voir ci-contre) concernant le pamphlet remarquable de Zoé Shepard, Absolument dé-bor-dée ! Comme les critiques de ce site ne sont pas ouvertes aux commentaires, mes souris-fidèles savent que je dépose aussi ces notes sur http://odelectures.canalblog.com/.
Le livre de Zoé Shepard est sorti il y a plus d’un an, et il a fait grand bruit à l’époque. Habituée comme vous au rythme des scandales qui se succèdent et s’oublient plus vite qu’un jour sans pain, je n’imaginais pas rencontrer autant de réactions. Mes publications rencontrent d’ordinaire un succès intime… Brutalement, les stats de lectures en partage ont cru comme jamais encore… Surtout le témoignage rapporté dans un commentaire y est presque douloureux. Le malaise est patent, la peur de s’exprimer révélatrice d’une situation plus que tendue.
Nous allons vivre les exaspérations d’une période électorale où seuls les candidats croient en leurs mensonges… Je connais plus de sceptiques que de convaincus. Nous serons plus nombreux à voter par défaut que par enthousiasme ou foi…
Allez, je vais me mouiller : Que diriez-vous d’aller changer l’Air des Éléphants en votant tous massivement pour LE candidat qui n’a aucune chance ? Est-ce que cette manœuvre remettrait les vanités en cause ?
Urgence :
La première urgence est de ne pas céder à la démoralisation.
Il est urgent de faire attention à nos proches, à nos familles, à nos ami(e) s, à tous ceux qui vivent autour de nous.
Comme il est urgent de profiter du soleil qui brille encore.
19:08 Publié dans Blog, Courant d'O | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : urgence, lecture, zoé shepard, absolument dé-bor-dée!, fonctionnaires, malaise, élections |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer