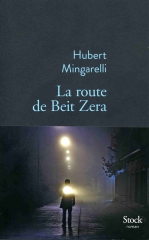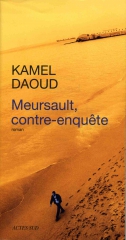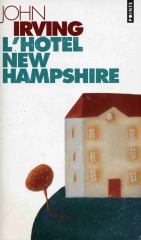13/04/2015
saynète expresso ( 2)
11:01 Publié dans Conte-gouttes, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : haïku de printemps, poésie, le printemps des poètes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
12/04/2015
saynète expresso ( 1)
19:56 Publié dans Conte-gouttes, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : haïku de printemps, poésie, premières fleurs, avril malhabile |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
29/03/2015
La route de Beit Zera
J’avais conservé un excellent souvenir d’un repas en hiver, un des précédents romans d’Hubert Mingarelli. Aussi n’ai-je pas hésité très longtemps avant de me saisir de celui-ci. Et chose rare, ma bonne impression se confirme. Il me semble même que ce livre est encore meilleur.
Stépan vit seul dans une maison isolée, quelque part sous le lac de Tibériade. Pour rejoindre la route qui mène à la prochaine ville, Beit Zera, il faut traverser à pied une forêt. Stépan est un solitaire, mais il a une chienne, à laquelle il est très attaché. Quand s’ouvre le roman, la chienne est à l’agonie, l’homme sait qu’il va devoir affronter sa disparition… Cette étape n’est pas la première séparation à laquelle il doit faire face. Progressivement, le récit nous permet de remonter dans l’histoire de cette solitude installée, qui, comme toutes les retraites, s’est imposée plus qu’elle n’a été choisie.
« Il n’avait pas fini sa cigarette. Elle n’était pas bonne et apaisante comme il l’avait espéré, mais il la gardait encore, car après elle, il ne savait pas ce qu’il ferait. Il fumait et il tendait l’oreille. Malgré le soleil rasant, il jetait des regards vers la forêt. À présent, il redoutait de voir le garçon arriver. Même si c’était chose rare le matin. Sa décision prise et son chagrin à l’intérieur de lui, il voulait rester seul. » (Page 14)
Stépan a un fils qui vit au loin, en Nouvelle-Zélande. Chaque nuit, il écrit à Yankel, dont l’absence pèse si lourd. Stépan survit grâce aux boîtes de carton dont son ami Samuelson lui confie le montage, l’assurant ainsi d’un petit revenu tout juste suffisant. Les deux hommes sont très proches depuis que leur amitié est neé au cours de l’interminable service militaire israélien. Amitié rude fondée sur la rémanence des souvenirs, entretenue par les longues soirées passées à boire sous la véranda de la maison. Les deux hommes n’ont pas de secrets l’un pour l’autre, sauf… Sauf que depuis quelque temps, un jeune garçon lui rend souvent visite, à la tombée de la nuit. Cet adolescent quasi mutique a noué une affection avec la vieille chienne, qu’il caresse longuement et emmène en balade dans la forêt. Sans trop savoir pourquoi, Stépan l’a encouragé à s’occuper ainsi de la chienne. Car Amghar, le garçon, est manifestement arabe. De plus, de soir en soir, Stépan apprend qu’il vient à pied de Beit Zera, la ville de l’autre côté de la forêt, ce qui représente un périple dangereux dans ce pays en conflit toujours larvé.
Avant l’action dont on le devine tout à fait capable, c’est la vie intérieure de Stépan qui est mise en lumière tout au long du roman. L’homme se projette avant de faire, ce qu’il vit intérieurement compense l’isolement vécu comme un emprisonnement, même si cette punition paraît volontaire.
« Amghar s’en alla. La chienne grimpa les marches et vint se coucher près du fauteuil. Pour la première fois depuis longtemps, Stépan refit en pensée le trajet jusqu’à Beit Zera. Cela lui prit du temps, même en pensée, car il devait s’arrêter à certains endroits de la forêt, sa mémoire le trompait et il n’était plus sûr de lui. Mais une fois sorti de la forêt et traversé le champ de terre, se dressait la prise d’eau en béton surmonté de tuiles, et passant devant, la route nationale. Tout au bout, Beit Zera lui apparut. Il la vit, éclairée au loin, et ce n’est pas l’imagination qui lui manqua pour y aller, mais le courage. » ( Page 54-55)
Pourquoi Stépan est-il si mal à l’aise avec ce garçon, alors qu’on verra qu’il s’inquiète pour lui ? Pourquoi Yankel est-il si loin ? Pourquoi la route de Beit Zera fait-elle si peur à Stépan, y compris pour Amghar ?
Hubert Mingarelli dévoile progressivement, par toutes petites touches, les événements qui ont participé à l’isolement de Stépan et à une culpabilité insoluble dans l’oubli. Roman à l’écriture sensible et poétique, la fatigue de l’homme comme celle de sa chienne, le dépouillement extrême des rapports humains soulignent le lien charnel à son fils, un attachement si fort qu’il en devient irraisonné. Les images sont belles et fortes, en particulier celles qui se déroulent dans la forêt où Yankel a trouvé refuge. C’est aussi dans cette forêt que Stépan part à la recherche d’Amghar un soir d’orage. Subtilement, cet étrange garçon devient le fils d’Hassan Gabai, la victime de Yankel, et nous sommes au fait du traumatisme qu’éprouvent les hommes, paralysés par la peur au point de tuer par erreur, de tuer par fantasme de l’ennemi.
« Finissant sa cigarette, il songea pour la millième fois que si Dieu avait existé, Il n’aurait pas fait des nuits pareilles. Il aurait toujours laissé briller quelque chose de plus fiable que la lune, qui ne sert à rien quand le ciel est si couvert. Pour la millième fois il mesura combien cette chose avait manqué à Yankel la nuit où, dix longues années auparavant , il était revenu à la maison pour sa première permission, et où après avoir laissé les lumières de Beit Zera derrière lui, il allait sur la route au-devant d’Hassan Gabai qui rentrait aussi chez lui. » ( Page 62)
J’ai aimé la manière dont Hubert Mingarelli avance par touches délicates pour dresser la situation de son personnage central, un homme apparemment fruste. Progressivement, Mingarelli nimbe ses créatures de tendresse et de sensibilité. Peur, amitié, solidarité et culpabilité habitent ses protagonistes, tous victimes d’un état de fait qui les a toujours dépassés. L’écriture de l’auteur se dépouille d’effets, suit au plus près les gestes quotidiens qui traduisent au mieux le désarroi de l’absence, la difficulté de la décision, la méfiance instinctive de l’Autre.
Mais au bout du voyage intérieur de son personnage, Hubert Mingarelli nous offre une image à la fois déchirante et apaisante des liens de tendresse entre un homme et la chienne malade, belle et sombre métaphore pour rappeler qu'on n'aime pas sans mal, qu'on ne vit pas en ignorant la mort.
Un beau roman, vraiment.
La route de Beit Zera
Hubert Mingarelli
Stock 2015-03-25
ISBN : 978-2-234-07810-9
18:53 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : la route de beit zera, hubert mingarelli, stock, peur de l'autre, littérature française, roman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
15/03/2015
Meursault, contre-enquête
Parfaitement intrigant, ce titre de l’ouvrage de Kamel Daoud, un énorme clin d’œil à la littérature française du vingtième siècle et à l’un de nos écrivains emblématiques, de sorte que j’étais impatiente d’entrer en connivence. Ce roman audacieux s’offre le luxe de confronter deux regards a priori opposés sinon antagonistes, en réinsérant dans une histoire vieille de soixante-dix ans un personnage déterminant. Prendre la parole au nom d’une victime, fût-elle virtuelle, m’est apparu comme une source de réflexion et de courage. Parce qu’il faut quand même un certain culot pour greffer son premier roman sur l’un des ouvrages les plus connus de la littérature. D’emblée, Kamel Daoud embarque son lecteur dans un jeu de miroirs où le lecteur comprend qu’il va perdre ses repères : Où se situe la réalité quand les victimes fictionnelles ont le pouvoir de changer le cours de l’histoire?
Dès l’incipit, le lien est établi avec l’œuvre de référence, rien de moins que l’Étranger d’Albert Camus:
— Aujourd’hui, M’ma est encore vivante.
À moins de ne pas l’avoir jamais lu, qui pourrait ne pas reconnaître la phrase initiale du roman de Camus : Aujourd’hui maman est morte.
Kamel Daoud, écrivain contemporain algérien, place donc la barre très haute, en développant son intrigue comme une réponse parallèle à la confession du Meursault de l’écrivain français. Construit en brefs chapitres, le récit se situe dans un petit bar à l’avenir incertain puisqu’il est l’un des derniers à servir du vin, ce que Haroun, le narrateur, souligne avec malice, comme une annonce préalable des transgressions à venir. Il y poursuit chaque soir une confession adressée à un universitaire en quête de matière pour sa thèse. L’écrivain oranais connaît son Albert Camus sur le bout des doigts, et s’amuse à émailler son texte de références multiples qui ne se cantonnent pas au seul roman visé. Au fur et à mesure que prend forme le récit, Daoud ouvre des perspectives qui débordent du cadre de la simple réponse à un mythe disparu depuis longtemps.
L’idée forte du départ consiste à donner une existence concrète à la victime que Meursault cite avec condescendance comme l’Arabe, personnage négligeable dont la mort gratuite ne sert qu’à accentuer la vacuité morale du meurtrier, son incapacité à ressentir les émotions et la valeur morales de ses actes. L’auteur répond à l’anonymat incongru qu’il relève : C’est important de donner un nom à un mort, autant qu’à un nouveau-né. ( Page 32) Avec une implacabilité toute camusienne, Daoud expose progressivement une thématique bien plus large. Le roman initial, écrit en 1942, s’inscrit dans une Algérie coloniale où son monde est propre, ciselé de clarté matinale, précis, net, tracé à coups d’arômes et d’horizons. La seule ombre est celle des «Arabes », objets flous et incongrus, venus « d’autrefois » comme des fantômes avec, pour toute langue, un son de flûte. (Page 12). Mais au fil du discours émergent des considérations sur les ressauts de l’Histoire algérienne, de la guerre de Libération et ses attentes déçues à sa situation actuelle déchirée entre tentation radicaliste et laisser-faire fataliste. Et l’on comprend peu à peu que, porte-parole de son frère Moussa, la victime emblématique et pesante, Haroun raconte le sort et le destin de l’Algérie, coupable à son tour d’aveuglement et de morts absurdes: sous l’influence de M’ma, Haroun a tué une nuit un rôdeur qui s’est avéré être un colon désarmé en fuite. Par malheur, le meurtre a lieu le lendemain de la Proclamation d’Indépendance, il perd la légitimité qu’il aurait eue la veille !
Je ne te raconte pas cette histoire pour être absous « a posteriori » ou me débarrasser d’une quelconque mauvaise conscience. Que non ! À l’époque où j’ai tué, Dieu, dans ce pays, n’était pas aussi vivant et aussi pesant qu’aujourd’hui et de toute façon, je ne crains pas l’enfer. J’éprouve juste une sorte de lassitude, l’envie de dormir souvent et, parfois, un immense vertige. ( Page 97)
Ainsi Kamel Daoud renvoie dos-à-dos les protagonistes des deux romans, chaque victime recèle sa part de culpabilité. Haroun, qui se qualifie lui-même de vieil homme, transparaît comme une métaphore du destin de son pays: atteint dans l’enfance par la brutale disparition de son aîné, il se reconnaît bien davantage jouet des manipulations maternelles. Le besoin de vengeance de M’ma nourrit une folie qui pèse sur Haroun et le prive de son libre arbitre. À ce jeu de dupe, comment être certain que Moussa, dont le corps n’ a jamais pu être pleuré, est bien le mort de Meursault ? M’ma s’est-elle emparée de ce crime avoué pour donner du sens à sa solitude, aux abandons successifs de ces hommes ?
Telles des poupées gigognes, les thèmes du livre se libèrent au fil des conversations successives qu’ Haroun livre à son visiteur. Le style fluide du discours oral ne prive pas le journaliste écrivain de livrer de belles envolées poétiques : Le lendemain du meurtre, tout était intact. C’était le même été brûlant avec l’étourdissante stridulation des insectes et le soleil dur et droit planté dans le ventre de la terre. (Page 97)
Le succès de ce roman, dont le format est calqué sur celui de son modèle, ultime œillade d’un petit frère de plume à son devancier est déjà gagné. J’ai lu sur divers sites les remarques étonnantes qu’a livré l’auteur sur son rapport à la langue française, qu’il qualifie de bien vacant laissé derrière eux comme leurs maisons, par les colons en partance. Force est de constater combien ce passé pèse encore sur la conscience culturelle du pays, comme une chaise désertée par un absent dans une maison de famille, autour de laquelle chacun tourne sans pouvoir décider de se l’approprier. Et pourtant, Kamel Daoud vient de faire la preuve retentissante qu’il a sa place dans la maison littérature francophone.
Pour suivre, ce site très riche et documenté que certains d’entre vous pratiquez peut-être déjà.
http://www.contreligne.eu/2014/06/kamel-daoud-meursault-c...
Meursault, contre-enquête
Kamel Daoud
Actes Sud Mai 2014
ISBN :978-2-330-03372-9
19:23 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : kamel daoud, littéraure francophone, littérature algérienne, référence camus, meursault contre -enquête, l'étranger droit de suite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
11/02/2015
L'Hôtel New Hampshire
Ouvrir un roman de John Irving, c’est toujours l’assurance de plonger dans un monde fourmillant, tragi-comique, où le burlesque côtoie le drame, où les sentiments des personnages ne seront jamais sordides et mesquins, où se croiseront des personnalités polymorphes mises en scène habilement. John Irving possède le talent de dresser un portrait caustique de la société américaine au mitan du vingtième siècle, et de retourner la violence de la satire par de soudaines pirouettes, versant au registre clownesque les frasques et les humeurs de ses protagonistes et nous régalant de diverses facéties. Bref, écrit en 1980, l’hôtel New Hampshire s’inscrit bien dans la veine du Monde selon Garp, pour les lecteurs qui ont déjà fréquenté l’univers d’Irving.
Le narrateur de ce présent ouvrage s’appelle John, comme l’auteur. Il est le troisième d’une fratrie de cinq enfants, conçus par le couple de Winslow Berry, fils de Robert Berry dit Coach Bob, et Mary Bates, tous deux enracinés à Dairy, petite ville sans avenir du fin fond du New Hampshire. Le ton particulier de cette saga familiale nous réjouit d’entrée :
« Notre histoire favorite concernait l’idylle entre mon père et ma mère : comment notre père avait fait l’acquisition de l’ours, comment notre père et notre mère s’étaient retrouvés amoureux, et, coup sur coup, avaient engendré Franck, Franny et moi-même (« Pan, Pan, Pan », disait Franny) ; puis, après un bref intermède, Lilly et Egg (Paf et Pschitt ! » disait Franny). ( Page 10 de l’édition Points)
L’histoire de l’Hôtel New Hampshire se décline en trois grands épisodes, trois états différents du même rêve, l’utopie de Win Berry qui embarque sa famille dans l’hôtel conçu comme une arche de Noé. Et comme toute navigation est hasardeuse, la famille Berry traverse son lot de catastrophes, surmontées vaille que vaille grâce à une curieuse solidarité familiale, stimulée par la force morale de Franny, qui exerce un rôle de leader incontesté. Car s’il y a deux filles pour trois garçons dans cette fratrie, ce sont les femmes ici qui incarnent le réalisme et la volonté d’avancer, Franny d’abord, puis la petite Lilly qui essaie toujours de grandir. De fait, chaque personnage cherche sa place et son identité, ce qui confère au roman une dimension attachante qui dépasse les aspects brillants du récit.
Et cette histoire d’ours, me direz-vous ? Les ours et le chien Sorrow sont membres à part entière de cet échantillon d’humanité. Curieuse métaphore que file l’auteur, tout au long du roman : D’abord State O’ Maine, transmis par l’ami Freud, ( un homonyme du fondateur de la psychanalyse), ours un peu psychotique quand même, dont les frasques provoquent maintes aventures… Et prédispose le chien à s’appeler Sorrow, le chagrin. On ne s’étonne même plus alors de l’aphorisme résultant : le chagrin flotte, vous verrez pourquoi…Mais quand l’Ours Susie entre en scène, nul ne peut prévenir la suite des catastrophes qui s’enchaînent. La famille émigre à Vienne, en Autriche, pour recommencer un nouvel hôtel New Hampshire, entendez un nouvel état des choses. À la manière d’un nouveau Candide, le narrateur souligne l’abîme infranchissable qui s’étend entre le monde réel et la micro-société familiale ancrée dans son image. Tu sais, me disait parfois Fehlgeburt, l’unique ingrédient, qui distingue la littérature américaine des autres littératures de notre époque est une sorte d’optimisme béat et illogique. Quelque chose de techniquement très sophistiqué sans cesser pour autant d’être idéologiquement naïf…(Pages 394-395)
Retrouver l’Amérique, c’est se prouver que l’on a évolué, grandi comme Lilly, en intégrant ses deuils. Au cours d’une grande scène typiquement « Irvingnienne », Franny affronte son violeur, comme chaque membre de la famille règle son destin. Dans le dernier Hôtel New Hampshire, Win Berry, à l’abri de sa cécité, poursuit son rêve de bonheur, ses enfants ont pris l’avenir en main.
L’Hôtel New Hampshire
John Irving
Points (seuil) 1995
1e édition US 1981
Traduction Maurice Rambaud
ISBN :2-02-025586-3
12:29 Publié dans Source de jouvence, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lecture, littérature américaine, john irving, l'hôtel new hampshire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
15/01/2015
Collisions
Pourquoi donc lire un polar ? La vraie vie n’est-elle pas assez noire en ce début d’année ? En fait, il me semble que lire des horreurs bien au chaud dans son lit ou blotti sur son canapé revient à s’octroyer des vacances de la vraie vie, plombée par son cortège d’incertitudes et d’angoisses, en accédant temporairement à la vision délirante d’événements dont on sait bien, à tout prendre, qu’on sortira indemne. C’est le propre de la fiction. La construction d’une histoire inventée dont la fonction permet la prise de recul face à une réalité étouffante, sordide, révoltante… Donc, j’ai achevé Collisions, un polar signé Emma Dayou alors que commençait tout juste le cauchemar de la semaine dernière. Et de me dire que cette intrigue fondée sur d’obscurs secrets, pour effroyable qu’elle soit, se révèle moins barbare que l’actualité.
Pourtant, l’ambiance de cette nuit lilloise est sinistre, plombée par la pluie et la découverte d’un premier cadavre de femme pour la jeune Claire, dont cette affaire constitue le baptême au sein de la police judiciaire. Emma Dayou pose d’entrée le décor et l’atmosphère avec justesse et poésie :
« La pluie répandait des milliers de gouttes d’eau. Elles martelaient sans répit le sol, rebondissaient, dégoulinaient des toits, s’infiltraient dans le col du blouson de Claire (…)Les lampes aveuglantes de l’équipe scientifique éclairaient le cadavre d’une femme blonde et nue. Une photographie de l’ensemble s’imposa à elle. Le blanc du corps. Le noir de la nuit. La blondeur des cheveux auréolée par le halo des lumières des projecteurs troublé par la pluie. » (Incipit du Roman, page 9)
En une suite de courts chapitres aux connotations précises, personnage concerné date et heure, l’auteure confère au développement de son intrigue un aspect détaché de l’affect, une précision documentaire, comme s’il s’agissait d’un rapport. Paradoxalement, la psychologie des personnages, en particulier les caractères féminins en paraissent d’autant plus touchants. Claire, en premier lieu que le caractère sexuel de l’agression déstabilise plus qu’elle ne le souhaiterait. Très rapidement se juxtapose le drame caché de Rose, une jeune adolescente élevée par un père solitaire. Les progrès de l’enquête se dévoilent peu à peu au rythme des pistes suivies par les différents membres de l’équipe. Emma Dayou tire un parti intéressant des différences entre les quatre policiers. Les « vieux de la vieille » aux pratiques expérimentées, l’informaticien aux astuces geek, la jeune femme et ses intuitions qu’elle doit imposer.
Bien sûr, je ne vous dévoilerai pas davantage les ressorts du suspense, qui promet fausses pistes et frissons de bout en bout. L’auteur joue à maintenir l’équilibre entre les deux intrigues, et le lien ténu tissé subtilement entre les protagonistes. Les derniers chapitres sont prenants à souhait, la résolution de l’enquête se double d’une menace mortifère concernant une nouvelle victime, le lecteur est contraint de se hâter pour en finir… Bref, mission réussie pour ce roman noir.
Si Collisions répond aux critères du genre policier, je voudrais pour ma part souligner l’écriture d’Emma Dayou. Au-delà du rythme des phrases et du découpage de l’intrigue, qui appartiennent bien à l’évolution du genre— j’ai noté plus haut les descriptions du décor—je reviens sur la psychologie des personnages féminins. Chacune d’elles oppose sa fragilité à une force intérieure qui lui permet de résister : ainsi Rose, l’adolescente mentionnée plus haut, dont nous mesurons simultanément la confusion et le désir de surmonter son épreuve :
« Son seul désir maintenant était de tenir dans le monde des Autres. Ne pas tomber. Des gestes simples comme se lever le matin, s’habiller, monter dans un bus, s’asseoir à côté de quelqu’un en classe lui demandaient beaucoup d’efforts, mais elle y arrivait. Elle devait y arriver sinon elle serait en danger. Personne ne devait apprendre ce qui s’était passé. Les flocons de coton devaient rester dans la taie d’oreiller. Elle devait avoir les cheveux lissés. Ne rien dire, ne rien montrer. Rester debout. « ( Page 23)
Des mots qui suscitent une empathie instinctive par des portraits en creux de personnages humains, forcément attachants. Une incursion captivante dans ce quartier de la cité nordiste qui vaut le détour…
Collisions
Emma Dayou
L’aube (septembre 2014)
ISBN :978-2-8159-1075-0
11:38 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : roman policier, polar, emma dayou, éditions de l'aube, suspense |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
10/01/2015
Un secret du docteur Freud
De la lecture de ce roman, ma première impression concerne le ton, la nature du récit. Malgré sa qualification de roman, j’ai maintes fois pensé qu’il s’agissait d’un documentaire, une compilation d’informations somme toute fort plausible. Éliette Abécassis réussit à mener son ouvrage sur une ligne à la fois intimiste et inquiétante, même si le lecteur sait pertinemment que le Père de la psychanalyse a bel et bien réussi à quitter l’Autriche.
Le récit se situe à Vienne, au lendemain de l’Anschluss. Les nazis entendent établir leur loi sans tarder, régler le sort des juifs, et Freud représente une double cible, à la fois par ses origines familiales et par sa position professionnelle. La psychanalyse, jeune science encore, est honnie par les nouveaux maîtres de Berlin et Vienne, considérée comme un cancer de la pensée. L’ouverture du roman montre justement Sigmund Freud exhortant ses disciples et amis à fuir le plus rapidement possible. Le vieil homme est conscient du danger, mais sent confusément qu’il ne peut s’extraire aussi rapidement à sa vie. De fait, son fils Martin trouve dans les archives un document dont le rappel le bouleverse. Cette lettre ranime une querelle douloureuse qui l’a irrémédiablement séparé d’un ami très proche. Éliette Abécassis nous montre un Freud très humain, devenu fragile malgré son aura et l’influence qu’il exerce en Europe comme dans le monde déjà. La maladie et l’âge en sont responsables, mais l’auteure s’attache à restituer les pensées d’un homme qui ne peut trancher le cours de son existence, reléguer d’un seul coup les étapes qui ont jalonné son parcours intellectuel. L’écrivain nous décrit les scrupules et les désirs de son personnage, tandis que la menace se fait chaque jour plus pressante. Nous entrons dans l’univers d’un homme pressé par le temps, par les différents membres de sa famille, par ses amis, parfaitement conscient que les intimidations dont il est l’objet ne sont pas de simples bravades. Éliette Abécassis met admirablement en scène cette intensité dramatique lorsqu’elle développe les interventions de la princesse Bonaparte, amie historique et disciple du médecin et surtout lorsqu’elle décrit les deux face à face qui opposent Freud au représentant de ses ennemis, le sinistre Sauerwald.
Ce sont les points fort de cet ouvrage. On sourira à l’évocation d’un Freud gâteux de son chien, on s’étonnera de la discrétion obligeante de Martha, la femme du docteur, ou à l’impétuosité capricieuse de Marie Bonaparte, autant d’éléments destinés à donner vie aux différents protagonistes. Mais j’ai trouvé un peu longue la résolution du fameux secret, que nous finissons par comprendre, alors même que sa teneur donne un éclairage particulier à l’élaboration de toute l’œuvre du docteur Freud, ce qui m’a laissé une impression d’inachevé.
Un secret du docteur Freud
Éliette Abécassis
Flammarion
Août 2014
ISBN :978-2-0813-3085-6
19:30 Publié dans Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sigmund freud, Éliette abécassis, freud et les nazis, exil de freud, marie bonaparte |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
31/12/2014
À la prochaine!
Mon beau sapin, sonne l'heure de te ranger
Nos salons tapissés à volonté de tes aiguilles lustrées.
Boules et guirlandes envolées
Nous piaffons à la porte de la nouvelles année
Chères fidèles-souris-discrètes, et les curieux de passage
Que les heures à venir vous soient agréables
Que cette nuit festive s'illumine de vos rires autour de belles tables
Et s'achève dans vos lits douillets sans dommage.
Et s'il reste parfois quelques regrets
Quelques oublis abandonnés avant que s'éteigne
le souffle de l'année
Dites- vous que s'ouvre un nouveau règne
365 jours encore à remplir de projets, de merveilles,
de ces mille petits records quotidiens que nous accomplissons sans même y penser .
Haut les coeurs et Bonne Année!
2015 sera ce que nous en ferons!
18:42 Publié dans goutte à goutte, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer