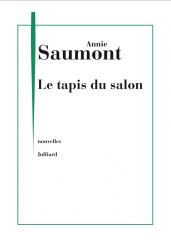09/09/2012
Merci Firmin!
Chères et fidèles souris discrètes, peut-être vous souviendrez-vous d’une allusion à un certain Firmin, remarque anodine qui m’avait échappé au printemps dernier, alors que je peaufinais la mise en mots de ma sentinelle du quai H, au destin solitaire et mélancolique.
Jeanne n’a pas gagné le concours d’Orgon, mais elle m’a valu une discussion émouvante et charmante avec l’organisatrice du concours, Dominique Désormière et quelques échanges sympathiques de lectrices.
Firmin est d’une autre trempe. Il est solide, tenace et chanceux.
Firmin m’a accompagné un moment et s’est imposé, de façon tout à fait irrationnelle quand j’ai imaginé concourir pour le prix Yolande Barbier.
Cette manifestation organisée à Hyères par Serge Casoetto m’avait été présentée et même chaudement recommandée. Allez savoir pourquoi une petite voix vous glisse que ça ira, que c’est le bon choix ?
Firmin a guidé mes doigts sur le clavier, s’est dessiné un passé, des amours, des passions, des désirs et une volonté. J’ai obéi, j’ai écrit, je lui ai concocté une trop longue nuit. J’ai adressé mon fichier Word bien dans les temps. Non, auparavant, j’ai demandé à Christophe une lecture à sa manière, lucide et bienveillante et ses précieuses remarques m’ont permis de décider de clore enfin les cinq pages de ce récit.
Et l’été s’est avancé, ponctué des visites et des rencontres qui nourrissent, des rires et des plaisirs menus du temps sans entrave.
Un matin, le téléphone sonne, et GéO me passe promptement l’appareil.
Une voix grave autant qu’inconnue m’informe que ma nouvelle est « nominée ». Empruntée par mon esprit d’escalier, je ne pose évidemment aucune des bonnes questions qui s’imposeraient en pareil cas, et me voilà livrée à mille incertitudes, si ce n’est que Firmin, comme l’avait été Jeanne, est retenu, son histoire joue dans la cour des grands, le dernier carré…
Alors, pendant que Philippe Mona et les enfants s’ébattent autour de la piscine, au cours des jours où Audrey et Mathis se reposent en attendant le déclin de la chaleur, tout au long des découvertes du malicieux Mathis, j’entends une petite musique obsédante, qui me répète en boucle…
— Firmin y tient, Firmin ne baissera pas les bras, tu dois rester confiante…
Confiante ? Pas si facile.
Arrive le grand jour; Il fait un temps splendide sur le port d’Hyères.
Soutenue par le son coloré d'un saxophone, la figure de proue du voilier étend ses ailes mordorées pour appeler la foule auprès des artistes.
Dans la lumière dorée de cette fin d’après-midi, nous assistons depuis la salle Porquerolles de l’espace nautique aux différentes prestations d’artistes du verbe, de la musique, de la danse, des peintres et des créateurs d’objets et de bijoux. Serge Casoetto, poète et conteur, a voulu ouvrir à tous les modes créatifs l’hommage à sa mère Yolande Barbier, qui a consacré une majeure partie de sa vie à promouvoir la vie artistique de sa ville.( Détails sur le site référencé)
Vient la distribution des Prix.
Une cérémonie quand même !
Mon cœur saute de joie en entendant le nom de Véronique. Je connais sa nouvelle, je la sais très émouvante, et je suis heureuse que ses doutes soient contrariés. Dans le même temps, et l’âme humaine est ainsi faite, je me dis que c’est fichu pour moi, car il m’apparaît que la loi du nombre interdise que deux « élèves » de Christophe soient récompensées. N’importe, le protocole se poursuit… Quatrième et troisième prix sont décernés à la grande joie des heureux récipiendaires. Le second prix voit s’envoler mes dernières illusions. Le maître de cérémonie reprend le micro et joue des nerfs de l’assistance. Moi, je me retranche déjà dans mon for intérieur, avoir été nominée, c’est déjà une forme de reconnaissance, n’est-ce-pas ?
J’entends de façon lointaine :
—Le premier prix de Littérature Yolande Barbier est attribué à Odile…
Un grand OUIII retentit et couvre le reste. Marie B à mes côtés prend mon bras, m’embrasse, me pousse en me glissant un « j’en étais sûre, c’est toi ! »
Au passage, les visages illuminés de bonheur d’Annie et de Christine qui m’embrassent me font tellement plaisir… Déjà je ne touche plus terre.
Alors, éclate la joie, immense, de réaliser que c’est fait: mes mots ont touché, mes phrases ont provoqué un écho, mes personnages sont de chair…
Un instant de grâce s’établit quand Serge Casoetto annonce la lecture d’un extrait de la nouvelle. Firmin va s’incarner par la voix grave et vibrante du conteur. Je suis incroyablement émue-sereine parce qu’il a la tessiture qu’il faut. Parce que le rythme de sa lecture, le timbre de sa voix, les silences qu’il respecte sont la respiration de la mer, les efforts des pêcheurs, le désespoir de Firmin et sa Résurrection… Je suis comblée et ça, c’est le plus plus cadeau de ce premier prix.
Il me reste à ajouter quelques mots pour Christophe, qui figure à gauche sur la photo. Par sa patience, sa rigueur, son souci d’intégrité face aux écrits, il nous aide à assumer nos mots, à les choisir sciemment, à maîtriser leur portée . Que ces quelques lignes soient l’occasion de le remercier pour sa présence amicale et compréhensive.. Sa joie manifeste me va droit au cœur… Qu’il en soit remercié.
19:16 Publié dans Conte-gouttes, O de joie, Sources | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, nouvelles, hyères, prix yolande barbier, serge casoetto |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
12/08/2012
Pluie d'étoiles…
Ce soir, notre ciel sera couvert.
Pourtant les nuits d'été en Provence ont une magie bien particulière.
Hiver glacial au vent d'Ouest frisquet ou obscurité douce et vibrante comme les nuits d'août,
Nous vivons nuitamment le nez en l'air, le regard accroché aux milliards d'étincelles clignotant au fond du noir absolu.
Hier soir, le départ des invités nous a rendu à notre calme méditatif.
Au bord de la piscine, nous nous sommes allongés un moment, repos suprême, à peine troublé par un petit clapot dû au système d'aspiration, souligné par le léger frémissement des insectes voltigeant dans l'obscurité.
Si le chien ne déclenche pas l'allumage intempestif, la nuit nous est offerte, dans toute la profondeur de son écrin; Les étoiles s'allument lentement, elles s'installent comme des choristes pendant les répétitions.
Et puis commence le spectacle.
La danse céleste se manifeste.
Il faut rester en alerte, les comètes surgissent de nulle part et se perdent brusquement dans le néant; c'est toujours une surprise, fugace,furtive, magnifique.
Au début, on dénombre, une à gauche, là à droite. Et celle -ci, tu l'as vue?
Satisfait de son compte, GéO est allé se coucher.
Et moi, je suis restée encore un moment dans cette paix incroyable, à bénéficier de ce gala silencieux et chaleureux, ces petits signes de l'univers qui nous envoient juste quelques clins d'oeil.
Et je pense qu'à quelques centaines de kilomètres, Christine, Max, André et tout le groupe rêvent et reposent sous les mêmes étoiles…
Ils sont en Espagne déjà, et je pense fort à eux et à tous ceux qui se surpassent, tout le temps, parce qu'il n'y a pas de choix, il faut vivre ce qui nous est donné.
19:49 Publié dans Blog, goutte à goutte, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nuit d'été, étoiles, firmament, comètes, léonides |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/03/2012
Coup d'oeil…
Devinette à usage des promeneurs du Sud:
— Où sommes-nous?
Pas à Nice, ni chez nos voisins transalpins, malgré le linge qui sèche aux fenêtres…
Cette maison magnifique, évocation d'un art de vivre au soleil se situe au fond d'une rue très étroite, terminée en cul-de-sac (Ah la saveur de ce mot ! ).
La rue du Puits à Hyères
Illustration particulière d'un aspect méconnu de la ville, loin des palmiers revendiqués en symbole. La vieille ville est dépaysante, quasiment inaccessible aux voitures, veinée de ruelles pentues et tortueuses, aux maisons serrées, ventrues, souvent avares de regards … Les promeneurs débouchent tout à coup sur une placette carrée, comme l'oustaou rou, que rien n'a annoncé. Et là, au débouché de l'entrelac des venelles, une enseigne colorée à la simplicité presque naïve signale l'entrée d'un domaine du rêve…
Se laisser tenter.
Pénétrer dans l'antre des livres enchantés .
Franchir le pas de la Poésie…
19:33 Publié dans Blog, goutte à goutte, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hyères, livres, librairie, vielle ville, rue du puits, moulin des contes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
24/02/2012
Le tapis du salon
Annie Saumont
Julliard 2012
ISBN : 978-2-260-01997-8
À sa manière discrète, Annie Saumont occupe le territoire des Lettres Françaises avec une indéfectible constance. Depuis les années 60, elle s’est imposé en donnant à la Nouvelle la reconnaissance d’un réel genre littéraire. Ce qui n’a rien d’évident au pays de l’Académie française, où la tentation est grande de minimiser ce mode narratif.
Une fois de plus, Annie Saumont démontre comment la Nouvelle repose sur la concision extrême du récit. Loin de tronquer l’intrigue ou de simplifier la psychologie des personnages, elle aiguise avec une acuité particulière les mots qui déroulent son histoire. Elle nous livre ici un recueil composé d’une vingtaine de nouvelles rassemblées sous ce titre, le tapis du salon, qui intitule également trois des pièces de l’ouvrage.
Des histoires brèves certes, aux horizons divers. Mais c’est surtout le ton adopté par l’auteure, et son style haché, elliptique jusqu’au système, qui définit l’unicité du recueil. En réalité Annie Saumont traque dans un dédale d’objets anodins ou de faits mesquins le détail qui scelle le sort de ses personnages. Elle dresse par exemple dans la mort du poisson rouge, une atmosphère de sérénité champêtre, où de charmantes familles divertissent leurs non moins charmants bambins en leur offrant un poisson rouge. :
« Calme journée. Pas un souffle de vent.
Mélanie et Antoine sont au jardin. Ce pourrait être la première phrase du premier conte d’un premier livre de lecture.
Mélanie arrache une herbe folle. Antoine écrase du pied une motte de terre grasse.
Pas le moindre frémissement des rideaux à la fenêtre du salon qu’Antoine a ouverte après le petit-déjeuner.… »
En quelques pages, nous identifions trois familles sans histoires, si ce n’est celles de nos quotidiens, myopie de la tendresse parentale et éclairage malicieux des inventions enfantines, jusqu’à ce jeu…
« On joue à la fin du monde ?
Quand le jeu a commencé, si on dit pouce c’est de la triche.
Fallait réfléchir avant.
Fallait dire non pour les cow-boys, la balançoire.
T’as dit oui pour la fin du monde. On continue. »
Une pirouette, un battement de cils plus tard, l’Éden est soufflé par un vent d’apocalypse, qui secoue le lecteur et bouscule l’ordonnance de ce petit monde trop bien léché.
Parfait exemple de cet art de l’ellipse, le début de Quartiers d’automne
« Promenade-danse. Danse-promenade. Le parc est vert. Quatre danseurs ont monté un ballet. Pas vraiment un ballet, des séquences. Ici et là.
Il y a notre petite Ida.
Pelouse. Arbres. Un épicéa. Un sophora-pleureur. Un saule. »
On entre ainsi par le décor dans la quête des personnages qui se cherchent, s’épient, se débattent contre le mal-être, l’absurdité, la méchanceté, la perversité des situations.
Annie Saumont adore avancer sans avoir l’air d’y toucher.
Elle privilégie volontiers les situations où la rumeur et le non-dit travaillent en minant le terrain à l’insu du personnage central. À cet égard, les trois nouvelles qui portent le titre générique sont exemplaires.
Dans la première, c’est un pauvre gosse, le narrateur, recueilli par Yole et Sarie, qui élèvent comme elles peuvent leur petit cousin orphelin. Le tapis offert par l’amoureux de Sarie est trop beau pour la modeste maison. Bien encombrant. Un vrai piège. On le range et on l’oublie… Mais un jour, le narrateur qui a bien grandi, retrouve ses deux cousines enveloppées dans le tapis…
La seconde de ces nouvelles consacrées au tapis du salon repose sur une inadéquation de situation similaire. Le narrateur est élevé par sa sœur Isa, faute d’un père capable d’assumer son veuvage. Par les mots de ce gamin à la vie rustique, on saisit combien la sœur aînée tente d’organiser leur vie et de s’ouvrir un avenir, jusqu’au jour où l’adolescent mal dégauchi tache le tapis… La chute tombe comme un couperet, rapide et impitoyable.
Ma préférée à cet égard reste la seconde, intitulée vacances…
Il vous reste à entrer à pas légers dans ces tranches de vie esquissées à traits vifs et rapides, comme ces croquis au charbon ou à la sanguine qui servent d’étude du sujet. Et vous découvrez que l’esquisse transmet plus de force que la peinture bien léchée.
Mais surtout prenez votre temps pour savourer distinctement ces nouvelles. Mon seul regret est d’avoir lu trop vite le recueil, les enchaînant les histoires sans respiration, ce qui a eu pour effet de mettre en évidence la technique d’écriture, gâchant mon innocence de lectrice.
18:47 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : annie saumont, nouvelles, lecture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
18/07/2011
Berceau des civilisations…(1)
La frange sud-ouest du Pays, c’est un peu la finis-terre de l’Asie… Carrefour de tant de civilisations ( notre guide, Yalçin en dénombre 47 !), cette terre accidentée de chaînes montagneuses abruptes aboutit aux confins orientaux de la Méditerranée. Impressionnée encore par les réminiscences de ma lecture de Yachar Kemal,( cf. Regarde donc l’Euphrate charrier le sang…) mon regard fasciné rattache sans cesse la terre aux îles d’en face, si proches et si semblables. Je conçois ce festonnage d’îles côtières comme une couture divine reliant la Turquie à son voisin Grec. La Mer Égée n’est que l’écrin commun à ces terres au relief tourmenté. La géologie tellurique les a façonnées, les hommes s’en disputent la domination depuis des millénaires, mais rien n’est plus artificiel face aux strates déposées depuis les temps immémoriaux.
les hommes regardent la côte au plus près…
Dalyan Caunos: tombeaux rupestres IVe siècle avant JC
Voyage donc en Turquie égéenne…
Vestiges de cités au renom prestigieux.
Première découverte, le recul de la mer a condamné irrémédiablement chacune d’elles au déclin. Les échanges marchands et la propagation des idées sont alors intimement liés. L’accès à la mer est primordial dans le monde méditerranéen. Mais l’ingéniosité des hommes s’affronte à Mère Nature et les sables gagnent sur la mer…
C’est ainsi que Priène domine actuellement la plaine de la Söke, riche vallée fertile propre aux cultures vivrières (céréales, fruits, légumes) et au coton. Un escalier monumental mène au site.
Adossés au Nikkale, la montagne (ou forteresse) de Satan, les vestiges de l’ancienne cité sont réellement impressionnants. Le théâtre accueillant 5 000 spectateurs donne une idée de l’importance du site, le nombre de places équivalant au dixième de la population concernée. Nous calculerons ainsi que Milet atteignait 250 000 personnes à son apogée et la population d’Éphèse est estimée à 500 000 habitants . Comment ne pas être interpellé par les dispositifs d’adduction et d’évacuation des eaux, dont on peut relever les traces aux portes de Priène.
Occupée d’abord par les Hittites, puis sous influence hellénistique par les Ioniens, la cité est vouée au double culte de Dionysos et d’Athéna. À quelques enjambées du théâtre, le temple d’Athéna se signale par ces quatre colonnes restées fièrement debout. Les tremblements de terre successifs, qui secouent toujours la région, ont eu raison du bâtiment, comme en témoigne ce champ de fragments…
Le Bouleutérion, équivalent d’une salle du conseil, témoigne de l’organisation politique de la ville : cinq vastes portes en assuraient l’accès et l’éclairage, relayé la nuit par les torches car l’obscurité ne pouvait envahir l’endroit des débats.
À l’époque byzantine (IVe siècle après JC jusqu’au XIe), la cité est encore active. Dans les ruines du petit temple attenant au théâtre une église byzantine est érigée
15:54 Publié dans goutte à goutte, O de joie, Sources, Voyage | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : récit de voyage, turquie, écriture, photos |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
06/03/2011
Oscars, Césars, Ciné-fête-arts
- C’est maintenant que tu te réveilles ? La grande distribution des étoiles, c’était la semaine dernière … Ce qui est fait a été bien fait, aujourd’hui, il faut passer à autre chose
- L’esprit d’escaliers, vous répondrai-je…
Inévitable me concernant… La première fois que j’ai lu cette expression, vers mes 15 ans, je crois, noyée dans les Confessions de l’ami Jean-Jacques si je ne me trompe, j’avais été frappée par la justesse de l’image : c’est toujours après coup que vient la bonne réplique, le juste argument…Et concernant le Net, à l’aune des médias contemporains, la réactivité est impérieuse : rapidité, efficacité… Inanité. Plus l’information brille, plus elle est éphémère. Alors pour le sujet du jour…
D’abord, la semaine dernière, nous avions d’autres chats personnels à fêter.
Et puis, si les récompenses distribuées l’ont justement été, si elles sont vraiment méritées, pourraient-elles s’évanouir de nos mémoires en une semaine à peine ?
Certes non, d’autant que pour une fois, nous avions vu les films gagnants et les choix des professionnels nous réjouissent, tant il est vrai que la programmation de ce début d’année recèle d’oeuvres ordinaires, banales, bancales.
Je ne reviens pas ici sur les Césars, concernant des films plus anciens, qui ne sont plus à l’affiche.
En revanche, sur la dizaine de films que nous avons vus en janvier –février, incontestablement, le discours d’un roi a retenu mon attention et mon admiration. Ce n’est pourtant pas un film très facile, mais il est intelligemment construit, et recèle des valeurs auxquelles on ne s’attarde plus guère dans la majorité des productions grand public. Black Swan pour sa part paraît plus brillant et fascinant, mais l’interprétation de Natalie Portman nous emporte dans un vertige halluciné qui ébranle fortement nos imaginations.
Alors, si d’aventure, vous avez loupé la séance, sans négliger le petit avant-goût des bandes-annonces disponibles où vous savez, je vous ai préparé un encas à ma façon, histoire de définir quelques bonnes raisons de fréquenter les salles obscures.
Black swan
La fêlure du visage de l’actrice ne cache aucune ambiguïté. Le film pourrait être sous-titré: choisir de perdre l’innocence ou la vie. L’écrin du synopsis est le ballet, écrin magnifiant et amplificateur de la Beauté, du dépassement de soi, et son revers, le monde de la scène fourmillant de rivalités sordides, de désillusions cruelles, la férocité de l’âge, la tolérance zéro en réponse à tout pas de travers. La danse classique, rêve de toutes les petites filles et cauchemar de nombre d’entre elles quand elles ne comptent pas dans le cercle restreint des élues. Avec cynisme, Darren Aronofsky construit pour son héroïne Nina (Natalie Portman) un univers feutré, entre les cours du New York City ballet et l’appartement que Nina partage avec sa mère (incroyable Barbara Hershey). Celle-ci projette sur sa fille ses ambitions déçues, et naturellement nous devinons rapidement que Nina n’a pas eu de choix. La jeune femme doit à tout prix obtenir enfin un premier rôle, avant que l’âge ne la condamne irrémédiablement à l’anonymat du corps de ballet.
Quand le chorégraphe Thomas Leroy ( Vincent Cassel) décide à la fois d’évincer Beth Mac Intyre ( Winona Ryder), la danseuse étoile tellement admirée mais vieillissante, et de monter Sa version du lac des cygnes, la troupe frémit et bruisse. Toutes les postulantes se jaugent et s’évaluent. La rivalité se lit sur les visages juvéniles, la jalousie se devine aux regards croisés dans les interminables couloirs de l’institut. Nina est toujours seule, oppressée par la nécessité d’être la meilleure, elle n’a pas d’amies. Par une pirouette du destin, voilà que le Maître Thomas, après bien des hésitations, lui confie le double rôle de la princesse ensorcelée en cygne. La gageure est redoutable ; si le chorégraphe ne nourrit aucun doute sur le talent de Nina à incarner le cygne blanc, il craint qu’elle ne parvienne à exprimer la sensualité perverse de son double noir. Dès lors Nina doit louvoyer sur un terrain miné de toutes parts: dépourvue de confiance en elle, oppressée par l’exigence maternelle, la perversité ambiguë de Thomas, elle vit mal la perfidie de Lily (Mila Kunis). Mais la meilleure ennemie de Nina, c’est elle-même. Nous suivons alors de miroirs en vitres réfléchissantes le cheminement de la ballerine vers l’accomplissement de son rôle.
Darren Aronofsky possède un talent fou pour disséquer et exposer les troubles de l’âme. L’année précédente, il nous montrait le sulfureux Mickey Rourke en lutte pour sa réhabilitation dans the Wrestler. Cette fois, il utilise la terrible discipline de l’art de la danse pour décortiquer minutieusement la lente aspiration de la jeune femme par son rôle. Il émane une telle tension des scènes que le spectateur perd, aux côtés de Nina, le fil de la réalité. Des images aux effets redoutables, obscurité, grisé, éclairage glaçant, miroirs à l’infini où les reflets deviennent autonomes, blessures aux mains, aux pieds, transformations physiques, hallucinations envoûtantes, le spectateur halète avec elle, tremble pour elle, espère qu’elle parvienne à reprendre pied…
Le ballet final nous étourdit. L’émergence du Cygne noir, royal par l’expression de sa souveraineté sensuelle suffira-t-il à vaincre les démons de Nina ?
À vous d’aller vous perdre dans les dédales du sortilège, mais à coup sûrs ce film appartient à la catégorie des films à voir et à revoir, ne serait-ce que pour la fabuleuse métamorphose de Natalie Portman.
19:46 Publié dans Blog, goutte à goutte, Loisirs, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, oscars 2011, black swan, natalie portman, darren aronofsky |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
21/02/2011
Lucas Cranach l'Ancien et son temps…
Portrait de Jeune Femme
1530, huile sur bois
Le hasard fait parfois si bien les choses… Ma petite escapade chez Audrey début février a coïncidé avec la réouverture du musée du Luxembourg, offrant aux Parisiens une exposition remarquable consacrée à Lucas Cranach l'Ancien et son temps.
Les souris-lectrices qui me connaissent savent que je nourris une ferveur toute particulière pour la peinture de ceux que l’on appelle encore souvent les Primitifs flamands : du XVème au XVIème siècles ce sont les peintres-chantres d’une époque mouvante et mystérieuse, charnière entre deux mondes, équilibristes raffinés évoluant entre les certitudes strictement codifiées du Moyen-Âge et l’éclosion de la pensée moderne. Nourris d’échanges intenses, ces humanistes ne connaissaient pas alors les revendications individualistes et fonctionnaient en école, en ateliers, par la pratique d’un compagnonnage parfois itinérant. Mais chez tous( Rogier Van der Weyden, Jan Van Eyck, Hans Memling…), nous pouvons admirer une finesse graphique, la délicatesse des traits, la densité des couleurs, le traitement des matières et des fonds. Chez les peintres du Nord de l’Europe, les fonds sont d’abord unicolores et sombres comme un écrin dont le velouté rehausse la pâleur du teint de la jeune femme ci-dessus. Progressivement, et Cranach( malgré son appartenance plus marquée à l'école germanique) en constitue un exemple magnifique, ces artistes s’imprègnent des techniques différentes : les artistes septentrionaux confient les secrets de leurs pigments aux artistes italiens qui leur exposent en retour la richesse des perspectives paysagères conférant une profondeur thématique aux scènes évoquées. Ce partage des techniques autant que des aspirations idéologiques concourent à magnifier les sujets et créer des œuvres vives et touchantes.
C’est donc avec un plaisir infini que nous nous sommes offert la visite de cette exposition exceptionnelle, en compagnie du plus jeune visiteur de la journée en la personne de Mathis. Lequel a été si sage, passant des bras de l’une à l’autre, puisque le musée n’accepte pas les poussettes dans les salles. Mathis n’a guère dérangé les autres visiteurs, amusant au passage quelques visiteuses de ses gazouillis discrets. Il a biberonné devant le remarquable martyre de sainte Catherine, emplissant ses yeux des contrastes lumineux opposant la sérénité sobre de la Sainte en posture retenue et atours austères, à la brutalité rutilante des personnages au second plan, soldats et spectateurs venus assister au massacre païen, et la détermination du bourreau, arrêté dans son élan vengeur par les manifestations divines irradiant d’un ciel tourmenté, jets de feu d’une étrange modernité.
(huile sur bois, 1508-1509 )
Datée de 1508, cette représentation me paraît annonciatrice d’une tendance aux représentations de scènes mythologiques plus propres aux peintres du siècle suivant, comme Nicolas Poussin.
Lucas Cranach dit l’Ancien (1472-1553) appartient à une époque bouillonnante à de nombreux égards. Homme universel, il est un ami proche de Martin Luther, mais honore cependant de nombreuses commandes de l'Épiscopat Catholique. Peintre officiel des Princes de Wittenberg en Saxe, il s’est formé chez Albrecht Dürer vers 1504-1505. L’exposition est conçue pour permettre une approche comparée des œuvres, et saisir les liens qui se tissent alors entre ces artistes novateurs. De nombreuses gravures illustrent ce propos. La rénovation des salles, en particulier la pénombre ambiante et les éclairages individuels des tableaux, permettent une contemplation intimiste des œuvres.
Si l’aperçu que je vous livre ici vous en donne l’envie, surtout ne luttez pas. Ces œuvres ne séjourneront au musée que jusqu’au 23 Mai…
Peut-être avez-vous été sensibles aux articles des magazines qui se sont fait l’écho de cette manifestation ? En ce qui me concerne, je suis frappée par la part qui est réservée à ses nus, par ailleurs magnifiques, il est vrai :
(Nymphe à la source, huile sur bois de tilleul, 1537)
La nymphe à la source en est une illustration sensuelle : sur quatre plans différents, la nymphe gît, abandonnée à la volupté de son repos sur un fond traité à la manière mille fleurs, clin d’œil aux représentations des tapisseries du Moyen-Âge (notez les deux oiseaux picorants en bas à droite au tout premier plan), puis la grotte opposant à la douceur charnelle du corps étendu, un contraste minéral et énigmatique par l’obscurité mystérieuse dont sourd le menu filet d’eau. Enfin, le quatrième et dernier plan propulse nos regards vers une cité lointaine, ouverture du tableau à une appartenance sociale de son allégorie. Quelle richesse !
Cette représentation d’Adam et Ève n’est pas, pour ma part, la plus belle : Il semblerait que ce sujet ait été maintes fois traité par Cranach et ses disciples. J’en retiens surtout le diptyque exposé le premier dans la salle consacrée à ce thème. Là encore vous reconnaîtrez la symbolique animalière de part et d’autre des personnages, la morphologie longiligne des corps, la lumière très particulière de l’arrière-plan, éclairage plus vif derrière les arbres, sous un ciel s’ obscurcissant au-dessus du serpent à l’œuvre …
Ne ratez surtout pas les différentes représentations du suicide de Lucrèce. L’intensité dramatique trouve son apogée dans la version de Lucas Cranach fils, avec une héroïne au visage torturé, davantage habitée par son désespoir que dans les multiples versions attribuées à son père.
***
Enfin, je ne peux me retenir de vous offrir ce superbe visage de Vierge en prière, dont la douceur et la pureté m’ont frappée. Il nous vient de Quentin Metsys, et se rattache à un diptyque daté de 1505. Ce visage à l’ovale charnu confère une grâce intemporelle à cette représentation de la virginité, sans cacher l’intensité du recueillement dans la douceur du regard. Le rose opalescent des joues incarne pleinement la jeune femme ; comme chez Cranach sur la nymphe ci-dessus, le traitement de la coiffe et du voile transparent ajoute une aura de légèreté soyeuse qui renforce la sensualité de la représentation.
Dernier cadeau, mais non des moindres, et sans commentaire, je vous laisse sur cette allégorie de la justice, l’œuvre la plus fameuse sans doute produite par Lucas Cranach l’Ancien. Elle date de 1537 et comme la plupart des œuvres exposées a été peinte sur un support de bois.
17:07 Publié dans Blog, goutte à goutte, Loisirs, Sources | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lucas cranach et son temps, exposition, musée du luxembourg, peinture de la renaissance, arts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
14/02/2011
Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent
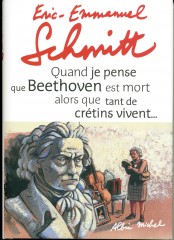 Albin Michel
Albin Michel
ISBN : 978-2-226-21520-8
Septembre 2010
Il nous arrive à tous d’associer viscéralement une musique à un moment de notre vie.
Les arts du spectacle nous ont familiarisés à l’intensification des émotions transmises par l’accompagnement sonore : À nos oreilles contemporaines, le cinéma y a tant excellé que n’importe quel cinéphile associera à tout jamais les images de l’Orange mécanique de Stanley Kubrick à la neuvième symphonie de Beethoven. Lors de mon premier mariage, il me souvient de moments très complices où nous jouions à apparier les œuvres picturales découvertes dans nos balades aux musées avec les morceaux de musique des compositeurs de notre discothèque… Il ne s’agissait pas de trouver les correspondances chronologiques, mais plutôt de tisser des liens entre les ressentis… Ce jeu nous a souvent permis d’ouvrir des portes étonnantes, voies royales d’appropriation ou chemin de traverses débouchant sur d’autres filiations…
Telles sont nées mes attentes quand j’ai remarqué et acheté l’essai qu’Éric Emmanuel Schmitt consacre à ses ressentis d’auditeur Beethovénien. Avec l’humour fin qui le caractérise, il s’appuie sur une remarque attribuée à sa professeure de piano pour mieux souligner combien il souhaite dégager son propos des jugements standards et des opinions convenues …
Partant du constat que ce héraut du romantisme musical est de plus en plus rarement au centre des programmations de concert, il nous propose de le suivre dans sa rétrospective personnelle avant de dégager les apports particuliers que le compositeur a légués à notre humanité.
N’ayez aucune crainte d’aborder ici un ouvrage trop savant, une nomenclature intégrale du répertoire ou une hagiographie lénifiante du Maître. À sa manière délicate, habillant sa sensibilité des atours de la simplicité, É.E Schmitt confie aux mots qu’il choisit la transposition de ses découvertes, émotions ou agacements, peurs ou rejets d’un trop plein d’émois.
En cela, la musique délivre davantage un message spirituel – affects, intensité, valeurs- qu’un message intellectuel. Ce qui explique sans doute notre difficulté, voire notre réticence, à traduire un concert en mots, car, toujours, la musique précède les phrases. ( P 34)
(Page 91) :
La musique touche, insinue. Elle fouille, tourneboule et modifie l’humain, l’atteignant au plus profond.
(Page 92) :
Le sens de la musique, c’est de ne pas avoir un sens précis mais d’être la métaphore de nombreux sens. Sinon, autant employer les mots.
Bâtis au long de l’écoute de six œuvres représentatives des talents de Beethoven, ÉE Schmitt ouvre nos réflexions sur la manière d’accepter, d’intégrer, de grandir à l’ombre ou en lumière des facettes musicales de ce génie particulier :
Des chocs, des silences, la mélodie qui gronde aux basses, qui hésite, qui se lance, qui s’étoffe, qui module. De source, le filet thématique devient fleuve, notre piano s’enfle aux dimensions d’un orchestre entier. Mon cœur bat à tout rompre. J’ai les oreilles rouges et gonflées d’émotion, je transpire avec peine, je m’enfonce dans l’harmonie, je fonds en musique, je suis heureux.
Derniers accords ! Nous laissons prospérer le silence. Nous tentons de reprendre notre souffle.
- Quand je pense que Beethoven est mort alors que tant de crétins vivent !
Madame Vo Than Loc avait lancé cette phrase farouche.
(Chapitre Ouverture de Coriolan, page 19)
Successivement, l’auteur nous livre les clefs de son écoute personnelle, révélant la fraîcheur d’une oreille attentive, exercée mais abandonnée volontairement au flux musical :
Au début, c’est un conflit. Deux entités s’opposent : les cordes violentes, dramatiques, et le piano doux. Celles-là fument, raclent, menacent,grondent ; celui-ci murmure. Leur antagonisme de timbre est poussé au paroxysme. (…) La lourde masse des cordes aux sons musclés, tenus, tendus, tente d’assommer le grêle et solitaire piano.
Entre leurs interventions, du silence.
Un silence double : le silence où quelque chose naît.
Le silence où s’évapore le fracas des cordes ; le silence où apparaît, fragile, le chant du piano.
Je commence à comprendre…
Choc d’énergies contradictoires. Goliath contre David. Le géant contre l’enfant. À première vue- ou à première oreille- on connaît le résultat. Or quoique les cordes cherchent à l’intimider, le piano ne hausse pas le ton, reste d’une étonnante sérénité, persiste.
Progressivement, le rapport des adversaires se modifie. (…)
(Page 85-86 quatrième concerto pour piano et orchestre, 2ème mouvement.)
Page 98 , à propos du quatuor n°15, EE poursuit:
Austères quatuors… Remisant sa palette symphonique, à mille lieux des gigantesques contrastes sonores, Beethoven renonce aux couleurs, à la variété des timbres, leurs oppositions, leur séduction. On a presque l’impression qu’il renonce aussi à la mélodie, qu’il y préfère de longues tenues de cordes, des frémissements, des attaques. C’est une méditation. Il se dépouille de ce qui charpentait son langage antérieur.
Bien évidemment, le mélomane est toujours tenté d’établir des choix, de dresser une table de comparaisons entre les différents compositeurs qu’il est amené à apprécier. Il se sent souvent alors obligé de situer la nature des œuvres dont il s’abreuve :
Lorsqu’on écoute du Mozart, on n’assiste pas à une besogne, on assiste à l’épiphanie de la grâce.
Inexplicable, la grâce. Ça descend, ça s’impose. C’est une aube, une naissance.
(Page 26)
La comparaison s’impose de fait et Schmitt, se souvenant qu’il est philosophe, développe les attributs supposés de ces deux génies fondateurs :
Mozart entend, Beethoven fabrique.
Chez les deux, le métier est ferme, supérieur, rigoureux, virtuose. Chez les deux, l’art triomphe.
Cependant, si Mozart efface son geste, Beethoven le met en avant. Mozart nous propose le produit de l’esprit, Beethoven l’esprit du produit.
Beethoven cherche, Mozart a trouvé.
Beethoven reste présent dans son œuvre, Mozart s’en absente.
Beethoven nous laisse avec sa musique, Mozart nous laisse avec la musique.
Dans la création, Beethoven se comporte en homme, Mozart en Dieu. L’un parade, l’autre s’écarte. Homme immanent, dieu caché.
Schmitt ne saurait cependant cantonner l’universalité de la musique à ce tableau comparatif. En réalité, ce qu’apporte un compositeur à la conscience de notre Histoire et de notre Humanité, ce qui établit Beethoven et les compositeurs dans l’Intemporalité, c’est l’essence de leur art, la musique (Page 36) :
Bach, c’est la musique que Dieu écrit.
Mozart, c’est la musique que Dieu écoute.
Beethoven, c’est la musique qui convainc Dieu de prendre un congé car il constate que l’homme envahit désormais la place.
(Page 40) :
Un souffle existe qui va s’épanouir, se tonifier, s’enchanter de lui-même, se développer en volutes infinies. Beethoven, de façon poignante, nous présente l’homme fragile, originellement convalescent. Quelle est sa faiblesse ? Sa force, c’est-à-dire la pensée. Débordant de tendresse et de compassion, Ludwig van souligne combien il aime cette bête inquiète, traversée de peurs, de questions, mais aussi tendue par l’idéal. Aussi pur que dans un de ses quatuors intimes, mais plus ample grâce à l’orchestre, il célèbre la condition humaine.
Ou encore ce développement pages 44-45 :
Quoique Beethoven accorde à Dieu le premier mot, il ne lui confie pas le dernier : cela se remet à foisonner, à grouiller, à fuser, à tambouriner, la joie s’ensauve, vire à la transe, c’est une danse dionysiaque, une explosion finale, une orgie cosmique.
Par la magie de la prose de Schmitt, j’entends pour ma part cette dernière phrase portée par le souffle enthousiaste d’un Fabrice Lucchini et je me dis que décidément, la Grâce accompagne en effet quelques rares élus et que nous sommes, quant à nous pauvres récipiendaires de leurs lumières, bien reconnaissants et bien heureux d’en recevoir le rayonnement.
Sous cet éclairage objectif, É E Schmitt s’attaque alors à démonter nos réflexes grégaires, nos références apprises par nos cheminements, la pression du temps, nos erreurs critiques. L’homme honnête nous invite à nous défaire d’idées préconçues et à retrouver la clarté d’une écoute rénovée. Sans fausse pudeur, il nous rapporte son expérience personnelle d’une représentation de Fidélio, où entré dans le théâtre engoncé dans ses préjugés, il s’est confronté à sa propre erreur…
Cédant à la prévention des philosophes qui estiment – à tort- que penser nécessite d’éloigner les affects, je me transformai en pur intellectuel. Dès lors, Beethoven m’apparut confus, brouillon, émotif, hystérique ; pas uniquement Beethoven d’ailleurs, car pendant ces années-là, je boudais aussi Mozart, Schubert, Chopin ; je ne m’intéressais plus qu’aux grammairiens de la musique, Schönberg, Webern, Berg ou Boulez dont j’allais suivre les cours au collège de France.
Pour l’intellectuel neuf que j’étais, tout sentiment relevait de la fièvre. ( Page 48)
(…)
Et alors, je commence à comprendre ce qui arrive… En me privant de la vue, je vois enfin le théâtre : il réside dans la musique. L’action a quitté la scène pour gagner la fosse. L’orchestre est le lieu où le drame s’élabore, chaque instrument y tient un rôle, et les voix qui en sortent à leur tour y participent. Les sentiments, les aspirations, les mouvements, les lumières, ils sont là, écrits par B. Au fond, il a raison : pas besoin de décor, un noir de fumée suffit ; au diable les attributs traditionnels du show, le vrai spectacle est celui des cœurs tourmentés. »( Page 55 chapitre Fidélio)
Cet essai d’une centaine de pages regorge de réflexions destinées à raviver nos propres ressentis. Quels que soient les sons dont nous colorons nos vies, chacun pourra entendre au fil de ce discours un écho à sa résonance personnelle. II ne m’appartient pas de rapporter l’intégralité du cheminement de l’auteur (É E Schmitt n’a nul besoin de moi !!!) mais je suis fort tentée de relayer ce point du discours qui apostrophe justement les préjugés dont souffre aussi la littérature :
En France, on répète à satiété la sentence : “ Ce n’est pas avec de bons sentiments qu’on fait de la bonne littérature“, une saillie amusante d’André Gide qui se pétrifia malheureusement en critère littéraire. Chez les petits marquis soumis aux diktats du cynisme ou du nihilisme ambiant, l’aphorisme vira à : “ les bons sentiments fabriquent de la mauvaise littérature.“ Adieu donc, Corneille, Goethe, Rousseau, Dickens, et tant d’autres – à coup sûr Gide lui-même, intellectuel militant ! À la trappe Bach ! Farewell Beethoven ! Dans les poubelles de la morale ! Certains amateurs de fausses fenêtres pour la symétrie, vont encore plus loin, arguant que “ les mauvais sentiments engendrent la bonne littérature “ ou que “ les mauvais sentiments améliorent la littérature“, comme si les sentiments, quels qu’ils soient, donnaient l’aptitude à écrire une phrase valable, à organiser une histoire, à créer une cohérence entre une pensée et son expression. Faut-il que notre époque soit désespérée pour qu’un simple trait d’esprit fonde un catéchisme, nous fournisse des repères. Quel naufrage… Pauvre Gide à qui l’on prête cette sottise, car la bêtise ne réside pas dans la boutade de cet homme intelligent, mais dans l’usage qu’en tirent les imbéciles.
Et avant de voir Fidélio, je lui appartenais à cette bande d’imbéciles, puisque j’avais débarqué lardé de préjugés à l’Opéra suisse.
Cette remarque n’a rien de gratuit dans l’organisation de l’essai. Concernant, non plus seulement Beethoven justement réhabilité dans l’urgence et l’Humanisme de son art, mais la perception et le flux de l’oeuvre de notre auteur, nous débouchons avec lui sur ce qui me touche à travers l’ensemble de ses compositions romanesques et théâtrales : Éric Emmanuel Schmitt développe, au grand dam de certains intellectuels cyniques, le positivisme volontariste. Il refuse que nous acceptions la laideur du monde et les calculs mesquins des Machiavels-au petit-pied sans opposer la chaleur de la compassion et la douceur du partage, la clarté de la compréhension et de la tolérance. Ce sont les leitmotivs qui traversent son Œuvre et réchauffent mon âme et mes convictions.
Se réjouir et jouir, telle s’avère la joie. Elle ne demande rien, elle ne déplore rien, elle ne se plaint de rien. Elle célèbre. Elle remercie. La joie est gratitude.
(Page 102)
Ce qui Schmitt tire de la fréquentation des musiciens (et j’attends avec l’impatience que vous devinez son essai promis à propos de Schubert) et qu’il nous transmet à son tour dans cette chaîne miraculeuse qui tisse un lien intergénérationnel et interplanétaire. Laissons –lui encore la parole pour conclure : ( Extrait page 46)
Plutôt que l’Hymne à la Joie, j’aurais envie d’appeler cette œuvre La Rédemption par le Joie car la musique de Beethoven offre une leçon. Nos vies sont dramatiques, tragiques, douloureuses, mais le drame ne constitue pas le but du drame, le tragique doit être accepté, la douleur surmontée. Libérons-nous ! Parce que nous subissons la tristesse, l’inévitable tristesse, nous ne devons pas la cultiver. Mieux vaut cultiver la joie. Que la liesse domine ! Beethoven nous emmène à l’école de l’énergie. Soyons enthousiastes au sens grec, c’est-à-dire laissons descendre les dieux en nous, délivrons-nous du négatif. La bacchanale plutôt que l’apocalypse.
L’ouvrage est complété dans cette édition attrayante par un texte originellement conçu comme un monologue destiné à la scène, mais qui se dévore comme une longue nouvelle. Il s’agit évidemment de Kiki von Beethoven* qu’Éric Emmanuel Schmitt avait déjà écrit avant son essai. Un CD comprenant un enregistrement des 6 morceaux analysés dans l’ouvrage illustre musicalement le propos, de sorte que l’acquisition du « package » constitue un cadeau très sympathique. Avis aux amateurs.
*La pièce se joue toujours à Paris en ce moment.
11:47 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric emmanuel schmitt, littérature, musique, essai, beethoven |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer