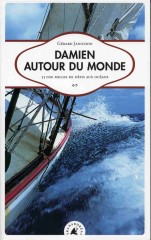23/02/2013
L'inespérée
L’inespérée, comme le titre du dernier des 11 textes qui composent ce recueil. N’allez pas en déduire que le lecteur s’ennuie, loin de là. Christian Bobin entretient une conversation intime et aérienne avec les lecteurs qui ouvrent leurs cœurs à l’ami. Les mots fraient ici, comme dans toutes ses œuvres, un sillon subtil que vous empruntez à votre tour, comme il vous convient. Jamais vous n’ouvrez un volume signé de ce poète pour combler un moment de désoeuvrement. Il en va de Bobin comme de Schubert, ce sont des enchanteurs du cœur, que l’on invite pour la couleur de l’âme dont il propose le partage. Si donc vous cherchez paillettes et dépaysement, passez votre chemin…
Or, si votre humeur est à l’écoute, vous entrez à mots de velours dans le murmure des confidences que l’auteur livre au fil des pages, comme autant de lettres adressées à l’Ami, celui ou celle qui comprend les nuances des émotions et la fragilité des aveux.
« La beauté, madame, n’a d’autre cœur que le vôtre, glisse –t-il dans sa lettre à la lumière qui traînait dans les rues du Creusot…, Nous ne cherchons tous qu’une seule chose dans cette vie : être comblé par elle— recevoir le baiser d’une lumière sur notre cœur gris, connaître la douceur d’un amour sans déclin. » ( Pages 11-12 de l’édition Folio.)
Le second texte, le mal, commence par une longue diatribe contre la télévision et son « règne en vertu d’une attirance éternelle vers le bas, vers le noir du temps.(…) On appelle ça une fenêtre sur le monde, mais c’est, plus qu’une fenêtre, le monde en son bloc, les détritus du monde versés à chaque seconde sur la moquette du salon. (…) Alors qu’est-ce qu’il faut faire avec la vieille gorgée d’images, torchée de sous ? Rien. Il ne faut rien faire. Elle est là, de plus en plus folle, malade à l’idée qu’un jour elle pourrait ne plus séduire »…
La traversée des images nous convie à poser notre regard sur la profondeur de nos motivations : « Vous arrivez là comme vous arrivez partout, avec l’impatience de repartir bientôt. C’est une infirmité que vous avez de ne pouvoir envisager un voyage autrement que comme un détour pour aller de chez vous à chez vous.(…)Vous n’avez jamais deviné vers quoi pouvaient aller les phrases écrites, l’encre répandue comme du parfum sur la chair de papier blanc. C’est pour parler de ça que vous alliez en Haute-Savoie, voir cet écrivain que vous aimez sans encore l’avoir rencontré. Et bien sûr les choses se passent autrement que prévu »…( Page 31)
Permettez-moi une halte prolongée sur ce texte, car bien sûr, voilà qu’il me parle du fond des choses : « Comment c’est, un écrivain, dans votre tête : étrange à dire, mais ce n’est pas d’abord lié à l’écriture. Un écrivain c’est quelqu’un qui se bat avec l’ange de sa solitude et de sa vérité. Une lutte confuse, sans nette conclusion.(…) Il vous est arrivé de rencontrer des personnes bouleversées par leur propre parole. Leur conversation irradiait une intelligence vraie, non convenue, et quand ces gens entreprenaient d’écrire, plus rien : comme si la peur de mal écrire et la croyance qu’il y a des règles leur faisaient perdre d’un seul coup toute vérité personnelle. Ces gens, vous les reconnaissez comme d’authentiques écrivains. Ce n’est pas l’encre qui fait l’écriture, c’est la voix, la vérité solitaire de la voix, l’hémorragie de vérité au ventre de la voix. » (Page 33)
De ces vérités personnelles et structurantes, il est question encore dans l’approche de l’innocence du thé sans thé et d’une fête sur les hauteurs. Bobin débusque toujours la part des faux-semblants et de l’ajustement nécessaire propre à ceux que ne guident aucun intérêt. Il a, pour décrire ces rencontres inattendues, des images ciselées inoubliables : « Elle parle et vous écoutez ce gravier d’étoiles crissant dedans sa voix. » L’auteur ne se dédit pas quand il poursuit sa réflexion dans j’espère que mon cœur tiendra sans craquelure : « « Parler de peinture, ce n’est pas comme parler de littérature. C’est beaucoup plus intéressant. Parler de peinture c’est très vite en finir avec la parole, très vite revenir au silence. Un peintre c’est quelqu’un qui essuie la vitre entre le monde et nous avec de la lumière, avec un chiffon de lumière imbibé de silence. » ( Page 63)
Observer et transcrire en poète n’empêche pas d’exercer son regard avec lucidité. Christian Bobin se fait plus incisif dès lors qu’il se penche sur le sort éphémère de l’amour, ou plutôt des amours communes auxquelles nous nous accrochons : « dans les histoires d’amour, il n’y a que des histoires, jamais d’amour. Si je regarde autour de moi, qu’est-ce que je vois : des morts ou des blessés. Des couples qui prennent leur retraite à trente ans ou qui font carrière dans la souffrance.( Page 83 la retraite à trente ans)
Alors, au bout du compte, arrive cette déclaration d’amour à l’Inespérée, à la présence plus forte que tous les éloignements : « Cela fait bien longtemps que je ne sors plus sans toi. Je t’emporte dans la plus simple cachette qui soit : je te cache dans ma joie comme une lettre en plein soleil. » La nature de l’amour réside dans une quête d’absolu, où il s’avère que « les mots sont en retard sur nos vies. Tu as toujours été en avance sur ce que j’espérais de toi. Tu as depuis toujours été l’inespérée. » Nous pouvons enfin comprendre la nature de la révélation, qui tient plus à l’aimant qu’à l’aimé : « L’enfer c’est cette vie quand nous ne l’aimons plus. Une vie sans amour est une vie abandonnée, bien plus abandonné qu’un mort. » (Page 115)
L’écriture de Christian Bobin n’est jamais docte. S’il touche à nos émotions, ce n’est pas par souci d’esthétisme, ses flèches sont décochées pour mettre à jour nos vérités profondes, que l’on se cache parfois par pudeur de soi ou peur des autres, peur du jugement ou de n’être pas à la hauteur… Le plus beau cadeau qu’un tel écrivain offre à son public ne se niche-t--il pas dans le pari de son authenticité ?
19:41 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian bobin, écriture, lecture, poésie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
11/02/2013
La guérison du monde
Frédéric Lenoir
Fayard (Janvier 2013)
ISBN : 978-2-213-66134-6
Écrivain de l’Optimisme, Frédéric Lenoir ?
Assurément, ce philosophe expert de la transcendance, œuvre depuis longtemps pour aider ses congénères à s’ouvrir à l’autre et accepter la part du religieux dans nos cultures.
Ses ouvrages antérieurs autant que la direction du Monde des Religions ont fondé son message de tolérance et de compréhension des aspirations de l’Homme à dépasser son quotidien.
Cette fois, Frédéric Lenoir prend un pari plus pragmatique. La proposition de son dernier titre engage un pronostic et une démarche. Est-ce dire que l’auteur entend nous livrer un protocole de médications propres à sortir nos sociétés du marasme où nous pensons patauger ?
Pour ce faire, en pédagogue avisé, Frédéric Lenoir dresse un tableau exhaustif des différents malaises recensés par la lecture des événements qui se bousculent au fil de l’actualité. Il donne à voir combien toutes les crises qui bouleversent nos existences sont liées, et ne sont en fin de compte que les multiples aspects d’un désaccord systémique entre l’Homme et la planète.
L’analyse devient limpide en suivant la logique de l’auteur, qui rappelle comment depuis les débuts de l’humanité, l’homme s’est adapté physiquement et mentalement aux conditions de son existence et de sa survie. Ce détour par la préhistoire et ce qu’il appelle la « révolution néolithique » ne paraît pas superflue, tant à lire ces lignes, ce raisonnement légitime la perception de nos recherches identitaires. La pertinence de la démarche s’illustre par le paradigme des « frontières » : au cours de son évolution, l’homme s’est délimité différentes frontières, celles qu’il définit comme verticales, positionnements individuels d’une connexion au monde qui le dépasse, mais dans lequel il se sent intégré. Puis avec l’aisance du progrès matériel, ce sont des frontières horizontales, la conquête de nouveaux territoires, le sens de la domination sur autrui qui le guide. Aujourd’hui, nous n’avons plus guère de perspectives d’expansion territoriale, mais nos besoins de puissance ne se sont pas pour autant atténués. D’où la quête d’un Ego civilisationnel, alibi collectif justifiant la course aveugle au « toujours plus ». Si l’Occident a réussi à imposer ses valeurs consuméristes, que nombres de pays émergents se sont également appropriés, cela ne suffit nullement à résoudre les problèmes que ce mode de vie engendre, dont les crises économiques, financières, écologiques, politiques et sociétales analysées en début d’ouvrage.
Frédéric Lenoir souligne à ce propos un aspect sociétal de l’argument des religions. Lui qui ne peut être suspect d’irrespect à l’égard des courants spirituels qui transcendent toutes les traditions, émet l’idée que le prosélytisme religieux sert plus souvent une volonté de domination qu’un réel élan idéaliste. ( référence aux évangélistes télégéniques autant qu’aux islamistes radicaux, sans oubli des terreurs de L’inquisition.) La mondialisation des idées sert plus la propagande que l’élévation des débats.
Reste donc à définir ce qui pourrait réellement permettre la guérison de nos plaies et le dépassement d’une société où l’injustice sociale et le repli individualiste ont remplacé les batailles de grands idéaux des siècles passés. Avant que ne s’achève le pillage inconsidéré de notre planète, il appartient à chacun de nous, autant qu’aux états que nous légitimons, de réinvestir une conduite autonome et responsable. « Pour que le mode guérisse, il nous faut ainsi passer de la logique quantitative dominante à une logique qualitative encore marginale. » (page 303). En cessant de se considérer comme victimes impuissantes de situations avérées, Frédéric Lenoir nous enjoint de nous « transformer (nous)—même » , de revenir à un nécessaire rééquilibrage entre nos vérités intérieures et les buts fixés par la société. L’auteur s’appuie sur la dualité de nos facultés et nous enjoint d’ouvrir notre mental à nos ressentis autant qu’à nos réalisations. « Pour s’épanouir, l’être humain a autant besoin d’intériorité que d’extériorité, de méditation que d’action, de se connaître lui-même que d’aller à la rencontre des autres. » (Page 292)
Citant les exemples de contemporains à l’œuvre comme Pierre Rabhi et son expérience d’autonomisation , Frédéric Lenoir prône un essor de l’individu global, aussi attentif à son bien-être physique dans un monde débarrassé des substrats qui l’empoisonnent que sa quiétude intellectuelle et mentale par le développement et le respect de sa dimension intime. Page 231, il nous renvoie à la perception de l’Homo universalis de la Renaissance, par lequel « l’homme affirme sa liberté dans la conscience qu’il a du fait qu’il contient en lui tout l’univers. Il est microcosmos.(…) de ce point de vue, la liberté équivaut à la prise de conscience du caractère relationnel de l’identité humaine . (…) Dans le cosmos, tout est relié, les choses visibles aux réalités invisibles, des couleurs aux étoiles, des plantes aux organes du corps, des métaux aux humeurs et aux saisons. » C’est par une hiérarchisation individuelle de ses valeurs que l’homme pourra conquérir à nouveau l’harmonie première indispensable à la sortie des impasses où notre inconséquence nous conduit depuis trop longtemps.
18:22 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
Waddine, ou la pratique du conte
Toutes nos lectures sont autant de rencontres, portes ouvertes sur des univers différents et spécifiques. Le hasard dépose parfois de minuscules balises sur nos chemins, jalons convergents vers des horizons insoupçonnés, des trouvailles insolites ou évidentes, des liens tissés à notre insu. Quelquefois l’aventure reste sans lendemain, mais il arrive qu’elle creuse son nid, flâne dans notre inconscient et finisse par émerger un beau jour sous une forme inattendue, île au trésor posée sur l’océan de nos imaginaires.
Cette remarque est doublement vraie.
D’abord, elle peut résumer ma rencontre avec l’auteur du conte que ma note souhaite vous inciter à découvrir. Mais cela, mes souris fidèles et discrètes, je vous en soufflerais peut-être quelques mots en d’autres occasions.
Pour l’heure, que vous cherchiez un conte pour enfant ou une fantaisie pour égayer un soir d’hiver un brin morose, partez avec moi dans l’univers d’un prince des mots, d’un magicien intemporel, d’un souffleur d’enchantements…
Waddine est à l’origine le nom d’un personnage imaginaire, mais à l’existence réelle, même si sa présence est restée occulte… Waddine était le compagnon secret d’un petit garçon à l’âme solitaire, il faut croire. Pour ma part, après avoir lu le conte écrit par Serge Casoetto, j’ai acquis une autre perception de cette transposition : il se pourrait que l’auteur ait un don de voir ce que nous autres, pauvres mortels, sommes incapables de reconnaître.
En pénétrant dans l’univers de Waddine, le conte, nous arrivons d’abord à Lamina, un village de montagne reculé et intemporel où parvient un beau jour un personnage sans attache ni référence, dont beaucoup commencent à se méfier, comme il est de mise dans les campagnes.
« En réalité, Waddine parle peu. Il arrive rarement qu’il prononce même un seul mot durant ces visites nocturnes. Le timbre de sa voix est comme celui des sirènes. Il s’évanouit au gré des vagues et du vent.… » ( Page 19)
Or le bel inconnu se joue des défiances. Waddine semble posséder un atout inné, un pouvoir de séduction qui s’exerce naturellement sur les différents membres de cette communauté, où habitent comme partout des personnes fort dissemblables.
Dans une langue colorée et parsemée d’images poétiques, Serge Casoetto présente peu à peu les habitants de Lamina. Car, si les villageois lui ouvrent leur coeur, nul ne parvient à connaître vraiment l’étranger qui s’est installé dans une misérable remise à l’écart du village.
Cependant un drame éclate et Gordjaev, chef d’une petite bande de gamins dépassés par leur propre jeu, se retrouve confronté à une terrible responsabilité. Un terrible enchaînement de violence, que l’auteur évoque en scènes saisissantes.
« Dans la rue silencieuse, Gordjaev est resté seul. Il s’approche lentement du corps de Samuel, étendu contre le trottoir. La pierre l’a atteint en pleine tempe. Incrédules, les yeux bleus de l’enfant contemplent le ciel et la cime des verts peupliers. Gordjaev se sent profondément seul. Le petit Russe s’écroule en pleurs sur le cadavre de celui qu’il voulait châtier. Puis, relevant la tête en hoquetant, Gordjaev le fier aperçoit à travers ses yeux obstrués de larmes une silhouette descendre la petite rue. Il la reconnaît. La longue cape noire efface l’habit blanc de lumière. Waddine s’arrête aux pieds de Samuel, mais ses yeux ne regardent que Gordjaev. Et Gordjaev ne voit plus que Waddine. Alors, Gordjaev Yemkov se lève. Il paraît implorer en une soumission la clémence du pèlerin. » (Page 29)
Ce paragraphe me paraît particulièrement explicite de l’intrusion du merveilleux dans une histoire humaine. Si le lecteur ne peut déceler immédiatement la quête qui se dessine dès ce moment, il se posera sans doute des questions: Quel est le sens de cette indifférence apparente envers la victime ? La première partie du conte ancre l’histoire et les personnages dans un monde réel où le merveilleux est implicitement distillé pour créer chez le lecteur ce chatouillement d’hésitation qui nous surprend au moment de franchir un passage défendu.
Les réponses se dessineront progressivement, au terme de multiples péripéties vécues par d’étranges personnages convergeant vers… Un lieu secret, île paradisiaque ou repaire bien gardé ? Je me garderais de développer plus avant les étapes et les portraits de ces nouveaux protagonistes, il suffit de les accompagner au long de leur quête, voyage fantastique entre deux mondes, où Serge Casoetto ménage de multiples clins d’œil: à la mythologie et à l’Histoire antique, certains personnages portent des patronymes évocateurs, Nabuchodonosor, Mnémosyne, Sémiramis… Mais aussi Mac Luke ou Gomina, manière humoristique de refuser de s’enfermer dans un genre trop codifié.
Naturellement, ce conte original s’adresse d’abord à de jeunes lecteurs prêts à s’affranchir de l’enfance, qui sauront s’amuser dans le dédale des mondes juxtaposés. En tant que lectrice adulte je me suis rafraîchi l’esprit en m’immergeant dans un univers simplement merveilleux qui, sous son aspect ingénu, offre une belle matière de réfléchir à l’authenticité et la sincérité de nos valeurs.
Waddine
Serge Casoetto
Tous les renseignements pour se procurer l'ouvrage, et bien d'autres oeuvres du même auteur, sont détaillés sur le site de Serge casoetto:
http://www.serge-casoetto.com/
15:41 Publié dans Conte-gouttes, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
22/12/2012
La Soprano et le cinéma…
En cette période bénie où nous nous échinons à chercher comment faire plaisir à nos êtres chers, comment leur procurer un moment de divertissement de qualité, j’ai envie de vous faire partager le clip youtube ci-dessous, qui vous donnera une bonne idée de l’enchantement que nous avons ressenti début décembre en assistant au récital Michel Legrand Nathalie Dessay.
J’espère que ce petit aperçu saura vous convaincre.
http://www.youtube.com/watch?v=etZ7hHQPi6M
La cantatrice française ne cache pas le plaisir qu’elle éprouve à ouvrir son répertoire à un genre tellement différent. Son public lyrique n’oubliera jamais la Lucia de Lamermoor qu’elle a incarnée ni la fantaisie détonante de la fille du régiment, mais la reconversion de la Soprano vous surprendra : pas d’afféterie, pas de mélange des genres, mais un ton juste qui touche et m’a émue, notamment quand elle reprend le succès de Barbra Streisand dans Yentl. Mieux encore, elle s’affirme dans le répertoire de Nougaro avec une véhémence qui n’aurait pas déplu au Toulousain. Nathalie Dessay possède un réel charisme quant à sa présence sur scène, le duo s’amuse et charme le public, et ce soir--là, celui de Marseille n’a quitté l’Opéra qu’à regrets, après moult rappels honorés avec grâce et générosité.
19:31 Publié dans Blog, goutte à goutte, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nathalie dessay, michel legrand, musique de film, nougaro, concert |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
02/12/2012
Donizetti à Marseille
… ou les enchantements du public marseillais.
Un Mistral sec glace les rues de la ville mais le public est resté chaleureux à l’écoute de cette version concertante du martyre de Polyeucte, livret fondé sur la pièce de Corneille.
De la tragédie à l'Opéra deux siècles se sont écoulés, mais la reprise du thème par le librettiste paraît inconsistante ô combien. On se dit souvent que les thèmes développés dans les oeuvres lyriques témoignent de leur époque. Et de fait, le choix du héros de Corneille semble largement dépassé, surtout dans la version du livret de Salvatore Cammarano, tel qu’il nous a été donné de l’entendre jeudi dernier à Marseille. Pas une once de psychologie, pas de pause amoureuse entre Paolina et Poliuto, hormis l’aria de la jalousie que Massimiliano Pisapia rend magistralement. Pour saisir l’ampleur du drame, la finesse du déchirement du personnage, entre l’amour trahi et la ferveur du nouveau converti, Donizetti a donné des accents intimes et poignants aux instruments, cordes et vents de l’orchestre.
Peut-être faut-il y voir la raison pour monter l’œuvre de Gaetano Donizetti dans la simplicité de la version concertante. Pas de mouvements de scènes pour prolonger l’émotion, pas d’effets de costumes et de décor pour mettre en valeur le manque de subtilité de l’intrigue. Les faiblesses du « scénario » sont ainsi englobées dans la fluidité musicale de la représentation. Et c’est tant mieux, car comme le public, j’ai pleinement savouré la musique et la fusion entre les chanteurs et les instrumentistes.
Le génie du compositeur s’impose d’ailleurs dès l’introduction : le premier violoncelle énonce le thème, solitaire, et l’on entre dans l’intimité du discours… La réponse progressive des vents et la reprise des cordes apportent tour à tour l’épaisseur et la variété des couleurs à la partition qui prend corps pour le plaisir de nos yeux autant que de nos oreilles. Qu’y a-t-il alors de plus beau qu’un orchestre en action ?
Le public s’est enthousiasmé pour Massimiliano Pisapia, le ténor interprétant Poliuto, mais il a surtout réservé un juste triomphe à Vittorio Vitelli, en Severo et Wojtek Smilek servant Callistène. Quant à Daniela Dessi, seule femme de la partie, elle semblait tout d’abord un peu hésitante à exprimer les tourments amoureux de Paolina, partagée entre sa fidélité envers Poliuto son époux et le retour de son amour premier, Severo, survivant d’une bataille où il était réputé péri. Curieusement, c’est dans la seconde partie du spectacle qu’elle s’implique davantage à défendre son rôle, alors même que le livret n’offre aucune prise pour le faire. Comme la vie des héroïnes tragiques est compliquée! Mais comme il est difficile au spectateur actuel de comprendre comment elle décide brutalement de se sacrifier au Dieu de son époux !
À moins que…
J’écrivais en introduction que les œuvres sont ancrées dans l’époque où elles naissent. Pardon pour ce qui semble un lieu commun du dimanche ou une planche savonnée pour lycéen en mal d’inspiration. Je ne suis pas (encore) retournée à l’œuvre initiale. Il me vient toutefois une réflexion glaçante à ce propos: ne relève-t-on pas ici et là quelques vocations de martyr sacrifié à l’autel d’une confusion entre foi et politique ? Le fourmillement social de notre époque a fait émerger certains conflits et drames appuyés sur des fondements d’apparence religieuse. Toute société charnière présente ce genre de blessures, vrais et faux débats qui cachent notre absence de vision. Alors, dépassé notre Corneille et son sens du devoir, son éloge de la vertu, son appel à l’abnégation, amoureuse ou religieuse ?
Gaetano Donizetti
1797-1848
18:50 Publié dans Courant d'O, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : donizetti, opéra, musique, marseille, corneille, polyeucte, poliuto, religion conversion, martyre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
27/11/2012
J'enrage de son absence
La semaine dernière, Catherine et moi nous sommes offert une petite escapade entre « filles »… Une petite journée à Aix, histoire de cumuler les petits plaisirs typiquement féminins auxquels nos hommes ne cèdent qu’en contrepartie de soupirs à fendre l’âme.
La journée était ensoleillée, l’air très doux sur le Cours Mirabeau, on a commencé par le shopping. Ah, prendre le temps d’un essayage, pour voir, sans se dire qu’il faut faire vite parce que Monsieur attend devant les caisses! Bien entendu, le fait d’être décontracté a suffit pour que je craque sur une petite jupe que je n’aurais pas imaginer chercher…
Le second argument qui avait présidé à ce besoin d’entre nous , c’était l’envie de voir un film qui parle à nos cœurs. Les maris, du moins les nôtres, ont tendance à l’évitement dès que l’affiche annonce « sentiments ». De plus, pour mon amie, voir un film français en Français était une vraie gâterie supplémentaire. Donc, entre Amours de Haneke et le dernier film de Sandrine Bonnaire, nous avons tranché.
À la séance de quatorze heures, nous étions peu nombreuses dans la salle, et justement, nous n’étions qu’entre femmes. C’est dire que ma théorie du sentiment repoussoir du public masculin n’est pas si farfelue. Et pourtant ! Sandrine Bonnaire aborde le thème du deuil sous de multiples aspects, elle sait confier à la caméra un regard intime sur les réactions individuelles. Tout le monde admet que le deuil le plus difficile à affronter est la mort d’un enfant, surtout s’il s’agit d’un petit enfant. Pourtant, elle prend le parti de nous montrer une mère ( excellente Alexandra Lamy dans un rôle à la hauteur de son talent) qui a su rebondir, refaire sa vie de couple et de mère. Mais Jacques, lui, s’est perdu dans les brumes de son deuil. On comprend assez rapidement qu’il porte en plus la culpabilité de l’accident fatal. Voilà un second aspect du deuil. La fuite au loin n’a évidemment pas comblé ce double deuil, et la mort de son père ramène Jacques en France. Il revient à William Hurt de porter la détresse de ce père que la perte du sien replonge dans la vivacité de son chagrin. Ce qui est bien vu, c’est qu’un second deuil devient le déclencheur qui ranime la détresse que l’on a fuie. La caméra dès lors ne quitte pratiquement pas le visage de l’acteur. Le spectateur suit le poids de cette infinie tristesse qui travaille ce solitaire, de la maison paternelle qu’il faut vider, symbole de la perte par excellence, à la nostalgie qui le pousse à pister son ex-épouse. Sandrine Bonnaire s’attache à montrer comment cet homme dénudé de ses amours va glisser lentement vers une addiction terrible en substituant à l’image du petit garçon perdu un lien avec le nouvel enfant de son ex-femme. Cet attachement devient d’autant plus fort qu’il est construit sur le secret. Cet enfouissement intérieur est révélé par la cave où Jacques s’enferme. Il devient ainsi un clandestin de la vie, et nous frémissons du risque où il entraîne le petit Paul, bientôt écartelé entre ses parents et ce personnage fantomatique qu’il entreprend de protéger…
Je ne vous en dirais pas davantage, de crainte de déflorer un film qui mérite vraiment de trouver son public. Ne serait-ce que pour la performance de William Hurt, terriblement poignant, quand bien même son personnage suscite une réaction de réprobation. Ce film fourmille de thèmes à débattre sur les différentes façons de surmonter nos manques et nos épreuves et montre une fois de plus les multiples talents de Sandrine Bonnaire.
19:51 Publié dans Blog, goutte à goutte, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, sandrine bonnaire, j'enrage de son absence, william hurt |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
04/11/2012
L'homme qui offre la joie
L'homme- joie figure en haut de ma PAL, depuis la rentrée, comme une gourmandise promise.
Malheureusement pour moi, le soir du passage de Bobin à la Grande Librairie, j'étais occupée ailleurs. Je viens de découvrir ce passage à l'adresse ci-dessous, et la possibilité de partage. Je tente donc la passation technique, qui sait, ce sera peut-être votre cadeau de cette soirée dominicale?
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&a...
19:34 Publié dans Blog, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : christian bobin, la grande librairie, l'homme joie, poésie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer
13/10/2012
"Damien" autour du monde
Gérard Janichon
Édition Transboréal, collection sillages.
Réédition 2010
Première parution 1998
ISBN : 978-2-913955-86-8
Envie de vous évader un peu de la grisaille ambiante, des embouteillages routiers, des perspectives misérabilistes dont on nous rebat les oreilles ? Ménagez-vous alors un bon moment car l’embarquement sur le « Damien » est un voyage au long cours : « 55 000 milles de défis aux océans » selon le sous-titre que Gérard Janichon a donné à son récit. Sans compter les 50 pages d’appendices techniques qui ne manquent pas d’intérêt une fois que l’on s’est accroché aux aventures du binôme, le récit de Janichon s’étale sur 609 pages … Le temps ne compte pas quand on aime !
En réalité, l’entreprise n’est pas récente et cette troisième édition nous offre l’occasion de remonter dans le temps, pour constater in petto que malgré les avancées technologiques qui ont marqué les quarante années qui nous séparent de leur départ mythique, le décalage entre les partants et les restants n’a rien perdu de son acuité, de sa véracité. C’est pourquoi Gérard Janichon ajoute en guise de post-face ces vers de Paul Fort :
Ils ont choisi la mer,
Ils ne reviendront plus.
Et même s’ils reviennent,
Les reconnaîtrez-vous ?
La mer les a marqués
Avant de vous les rendre.
C’est l’aveu final qui conclut effectivement la relation de ce voyage extraordinaire.
Et l’on mesurera d’abord la teneur du défi en suivant l’élaboration du projet : Ces copains grenoblois n’étaient pas prédisposés à se retrouver en équipage sur les mers du monde, entre les deux pôles ! Mais les rêves poussent certains avec une force insoupçonnable. Les garçons ont conçu leur dessein au cours de leurs années lycée, et c’est planche par planche qu’ils ont conquis à la sueur de petits boulots annexes le droit de réaliser l’épopée. Il leur a fallu quelques années pour fabriquer leur voilier, grâce à certaines amitiés gagnées par la ténacité du trio de départ. Ils se sont donné des contraintes de raison, ont étudié la faisabilité (l’affreux vocable), ont cherché maints et maints soutiens, ont osé innover, ont beaucoup lu, et se sont quand même entraîné entre la Rochelle et les îles vendéennes à la maîtrise des manœuvres.
Vint le jour J. Je n’ambitionne pas de vous rapporter leur périple par le menu… C’est autrement captivant de suivre ces aventures par les mots de celui qui les a vécus. Mais une fois embarqués vers le Spitzberg et les premières glaces, attendez-vous à partager les veilles des quarts solitaires sous les aurores boréales, à découvrir l’hospitalité des gens de mer et les rencontres hasardeuses. Étonnez-vous des difficultés de navigation lors de la remontée de l’Amazone, constatez les bienfaits du rhum qui coule abondamment à bord et surtout, sautez de joie et de soulagement quand les deux rescapés du Cap Horn sortent enfin du chavirage au large de la Géorgie du Sud, territoire hostile dont je n’avais même pas idée avant de plonger dans les péripéties de ce tour du monde.
Voilà un récit de voyage qui ne sent pas l’esbroufe et l’appel des caméras. L’édition est agrémentée de cartes « à main levée » et de quelques photos au centre de l’ouvrage, comme une respiration entre les deux hémisphères, le temps de reprendre souffle par cette escale visuelle.
Bonne lecture et bon vent…
19:59 Publié dans Blog, Livre, Sources | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : voyage, récit, voilier, tour du monde, lecture, gérard janichon, jérôme poncet, édition transboréal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us | ![]() Facebook | |
Facebook | |  Imprimer
Imprimer